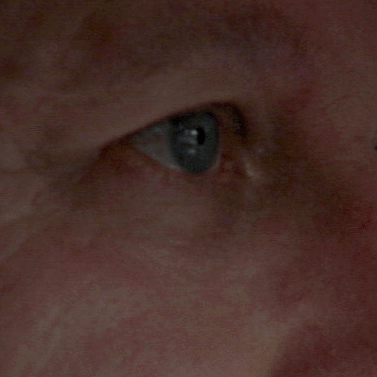Nicolas Philibert
Positif n° 771
2025
Pour avoir filmé de très nombreuses situations d’apprentissage, la transmission est explicitement au cœur de plusieurs de mes films : je pense notamment au Pays des sourds, à Être et avoir, ou à De chaque instant…
Pourtant, ce sur quoi j’aimerais m’aventurer ici, ce n’est pas tant sur les films eux-mêmes que sur le travail d’accompagnement qu’ils engendrent, et auquel je consacre, comme nous le faisons nous autres cinéastes, beaucoup d’énergie et de temps.
Depuis mes débuts j’ai fait des centaines et des centaines de présentations et de débats dans des salles de cinéma bien sûr mais parfois également dans un amphi universitaire, un lycée, une école, une médiathèque, dans l’auditorium d’un musée, un temple, une chapelle, une grange, un hôpital, sous un chapiteau, en prison, en psychiatrie, dans un pré, un parc, un semi-remorque réaménagé, sur un terrain de foot… sans compter à la ménagerie du Jardin des Plantes, où j’ai montré mon film Nénette à Nénette et aux trois orangs outans avec lesquels elle partageait sa captivité, devant un parterre de scientifiques du Muséum National d’Histoire Naturelle curieux de voir comment elle réagirait. Hélas, passées les premières images du film, Nénette nous a fait comprendre qu’elle avait mieux à faire. Elle est allée dans son nid et elle s’est couchée.
En 1993, année de sa sortie, accompagner Le Pays des sourds exigeait un soin tout particulier puisqu’il fallait que les échanges avec le public puissent être traduits en langue des signes. Or la langue des signes était quasi inexistante, du moins très balbutiante encore dans la sphère publique. Les sourds la pratiquaient entre eux, mais elle ne dépassait pas l’espace privé. Interdite depuis 1880 dans toutes les écoles spécialisées d’Europe au prétexte qu’il fallait impérativement oraliser les enfants sourds, elle commençait tout juste à refaire surface. La France venait de reconnaître officiellement le droit au bilinguisme. Autant dire que les interprètes étaient très peu nombreux et que les exploitants de salle peinaient à en recruter. Ils étaient à peine une quinzaine dans toute la France, alors qu’ils sont aujourd’hui plusieurs centaines. Il fallait faire venir quelqu’un de Paris ou Toulouse. C’était coûteux, et beaucoup d’exploitants s’en seraient volontiers passé. Heureusement, les salles étaient pleines. Les sourds de la ville et des villes voisines se donnaient le mot.
Les débats qui suivaient ces projections étaient extraordinaires. Ils pouvaient durer une heure et demi, et se prolongeaient longtemps encore sur le trottoir. Les sourds étaient nombreux à intervenir et à témoigner. Pour être visibles de tous, puisqu’ils « signaient », ils grimpaient prestement sur la scène et une fois leur intervention terminée, ils restaient là, prêts à intervenir de nouveau. Les suivants montaient à leur tour sur l’estrade, où nous finissions par être douze, quinze, vingt… C’était la première fois qu’ils voyaient un film dans « leur » langue, et c’était très émouvant. Certains disaient : Jamais jusqu’ici je n’avais osé signer en public. Mes parents m’ont toujours interdit de le faire. On m’a toujours dit que c’était laid, disgracieux, que c’était des grimaces. Aujourd’hui, pour la première fois, j’ose signer au grand jour !
Un verrou était en train de sauter et j’étais heureux que le film y contribue.
L’accompagnement de ce film m’a mobilisé plus d’un an. Celui d’Être et avoir deux années pleines, en France d’abord, puis à l’étranger. Un animal, des animaux, dont la sortie en salle remonte à 1995, circule toujours ;
il est dans les dispositifs scolaires. La Moindre des choses, sorti en 1997, me vaut aujourd’hui encore de nombreuses sollicitations. Sur l’Adamant poursuit toujours son parcours dans les salles… Je devrais m’en réjouir sans limite : ce n’est pas donné à tout le monde ! Mais voilà : je traîne parfois mes films comme des boulets.
Pourquoi ai-je accepté de faire tout ça ? Certains cinéastes y rechignent. On les comprend, c’est éreintant, répétitif, la plupart du temps non rémunéré, et pour se faire payer – quand ça l’est – si vous n’avez pas votre propre structure, c’est une galère sans nom !
Quelquefois, cette dépense d’énergie devient un chemin de croix. Vous faites 600 bornes, cinq heures de train suivies d’une heure trente de voiture et à l’arrivée… ils sont dix-neuf ! Le lendemain, vous avez beau vous dire que le débat était riche, vous rentrez chez vous la tête basse.
Pourquoi nous donnons-nous cette peine ? Pourquoi, à titre personnel, ai-je fait tout cela avec une telle constance depuis 45 ans au prix d’y laisser quelques plumes, de repousser la mise en chantier du film suivant, d’avoir souvent le sentiment de stagner, quand je pourrais avancer ?
Est-ce que les films ne devraient pas garder leurs secrets ? Ne peuvent-ils pas vivre dans le cœur ou la tête des gens sans qu’il faille leur dire pourquoi on a placé la caméra ici plutôt que là ? A-t-on déjà vu une troupe de théâtre ou une compagnie de danse, sitôt le rideau retombé, venir expliquer le pourquoi du comment ?
« La transmission, dit Alain Bergala dans L’Hypothèse cinéma[1], n’a-t-elle pas besoin, parfois, de silence et de partage tacite ? » Ce même Bergala qui dit aussi que « L’art cela ne s’enseigne pas, cela se rencontre, cela s’expérimente, cela se transmet par d’autres voies que le discours du seul savoir, et parfois même, sans discours du tout ».
Avec les films documentaires, distributeurs et exploitants s’efforcent de mobiliser les publics spécifiques.
On ne saurait le leur reprocher bien sûr, mais c’est à double tranchant. Déjà que les documentaires, puisqu’on y montre de vraies personnes et de vraies situations, sont souvent disqualifiés en tant que films, c’est à double tranchant, oui ! Car ce faisant, le risque est grand de les enfermer dans le carcan de leur sujet. Les spectateurs les plus directement concernés n’ont pas toujours le recul qui leur permettra de voir un film dans sa dimension artistique. Il arrive qu’ils prennent le film pour LA réalité, oubliant que la réalité n’existe que dans la mesure où on la regarde, et que regarder le monde c’est déjà le reconstruire. Oubliant que ces images, leur durée, l’angle sous lequel elles ont été prises comme la manière dont elles s’enchaînent n’en donnent qu’une lecture parmi d’autres.
Je garde en mémoire une séance de La Moindre des choses destinée à des professionnels de la profession et autres « psychistes » qui avait un peu tourné au vinaigre. Ils étaient sur la défensive :
– C’est bien gentil, mais votre film mais n’est absolument pas représentatif !
En effet, la clinique de La Borde, où je l’avais tourné, incarnait et incarne toujours une place très singulière dans le paysage de la psychiatrie. Plus tard, certains de ceux qui m’invectivaient deviendront de farouches partisans du film, mais sur le moment, ils s’étaient sentis attaqués.
Être et avoir a parfois été critiqué pour des raisons semblables. Pour beaucoup de gens, documentaire rime avec sociologie. L’image de l’école que donnait le film n’était pas représentative, elle non plus. En France, une école, aujourd’hui, se situe majoritairement en zone urbaine et non dans le monde rural. Pire, celle que j’avais choisie était tenue par un maître, quand la profession est très largement féminine. J’avais donc commis « un double délit de non ressemblance – je cite Frédéric Sabouraud[2] – comme si le documentaire devait répondre, avant même de savoir s’il est bon ou mauvais, à des critères de représentation de la réalité d’ordre sociologique (…) respecter des pourcentages, représenter un archétype, un portrait-robot, un instantané du présent, informer comme une sorte de sondage en images. »
Alors oui, j’y reviens… Pourquoi nous donnons-nous cette peine ?
Il doit bien y avoir quelque chose…
Pour « booster » les entrées ? Je veux bien, mais c’est marginal. Pour le plaisir narcissique d’être sur le devant de la scène ? Pourquoi pas. Narcissique ou masochiste ? Parce qu’à force de se répéter, on finit inévitablement par enfermer son propos – et son film – dans des réponses toutes faites, on sait les formules qui frappent, qui font mouche, et on finit par s’en vouloir de ces facilités.
Pour transmettre ?
ça y est, le mot est lâché ! Mais d’abord, sait-on si l’on transmet ? Et pour transmettre quoi ? Sait-on bien quelles traces on laisse derrière soi ? Car un film dit toujours autre chose et d’autres choses que ce que l’on a dit, voulu dire, désiré lui faire dire, ou cru avoir dit.
Transmettre ? A-t-on seulement pour objectif de transmettre ? Fait-on un film pour transmettre ? Est-ce que je fais des films pour transmettre ? Assurément NON. Ce n’est ni mon intention première, ni mon but affiché.
Les films naissent souvent dans la brume, et ils y demeurent parfois longtemps. Chez moi ils se font souvent à tâtons, à l’aveuglette ; à caméra nue, comme on dit « à mains nues ».
– C’est sur quoi, au juste ? De quoi ça parle ? Qu’est-ce que ça va raconter ? vous interroge-t-on. Mais le sait-on toujours lorsque débute le tournage ? Sait-on bien ce que l’on veut dire lorsqu’on fait un film ? Sait-on même toujours pourquoi on le fait ? Est-ce qu’on ne le ferait pas pour essayer de le savoir ? Pour comprendre pourquoi on voulait le faire ?
– Qu’est-ce que vous avez voulu dire avec ce film ? S’entend-on régulièrement demander.
– Rien. Je n’ai rien voulu « dire ». J’ai voulu faire un film, et ce faisant, j’ai voulu me mettre à l’épreuve.
Comme si faire un film consistait à mettre en image un discours ! Comme si un film devait être porteur d’un message. Comme si un cinéaste était là pour dire ce qu’il a à dire sur telle ou telle question.
Ce qui, dans le cinéma, dit le cinéma, c’est ce qui échappe au discours, aux programmes et aux prévisions.
Les plus belles scènes sont souvent celles qui naissent à l’improviste, sans préméditation, par effraction, au débotté ; qui ne cherchent pas à produire du sens.
Se soustraire à l’emprise, au carcan du sujet. Le cinéma ne sort pas forcément grandi d’un film qui a un grand sujet.
Le monde n’est pas là à attendre paisiblement, passivement, que le cinéaste vienne cueillir ses images.
L’arrivée d’une caméra rebat toujours les cartes. La caméra ne capte pas le réel, elle le transforme, le provoque, le bouscule, le fait surgir.
Qui transmet ? À qui ? Quand ? Comment ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre tant on ne sait pas toujours ce que l’on dit en le disant, ce que l’on fait en le faisant.
Ce qu’on laisse derrière soi n’est ni quantifiable ni mesurable ; encore moins prévisible.
Est-ce qu’il n’y a pas aussi une part d’intransmissible, d’irréductible ?
Transmettre ? Oui, pourquoi pas, mais plutôt transmettre sur ce que l’on cherche, non sur ce que l’on sait.
« Un cinéaste ne devrait montrer que ce qu’il ne sait pas encore » disait Marcel Hanoun.
Et Julien Green : « J’écris mes livres pour savoir ce qu’il y a dedans ».
Je lui ai emprunté la formule. Je fais mes films pour savoir ce qu’il y a dedans. Ou plutôt : j’accompagne mes films pour savoir ce qu’il y a dedans.
Lors d’un des toutes premières projections publiques d’Être et avoir, une femme avait levé la main et dit :
-Vous avez fait un film sur la séparation. J’étais resté sans voix : c’était si vrai ! Et dire que je n’avais pas vu cette dimension du film, si éclatante pourtant.
Que ce soit en faisant des films ou en les accompagnant, le cinéma est ce qui m’a permis et me permet encore d’aller inlassablement à la rencontre de l’autre, des autres ; de l’altérité. Rien de plus beau peut-être, pour le cinéaste que je suis, que d’apprendre quelque chose sur un film que j’ai fait de la bouche d’une spectatrice ou d’un spectateur.
André S. Labarthe disait : « J’ai fait le film. Il ne me reste plus qu’à l’inachever ».
[1] Éditions Cahiers du cinéma, 2002
[2] Revue Images documentaires n°45-46, 2002