Fieles a lo que ahora es una tradición, los internos y el personal médico de la clínica psiquiátrica de La Borde se reúnen durante el verano de 1995 con el fin de preparar la obra de teatro que interpretarán el 15 de agosto.
A través de los ensayos, la película sigue los altibajos de esta aventura. Pero más allá del teatro, cuenta la vida en La Borde, la cotidiana, el tiempo que pasa, los pequeños detalles, la soledad, el cansancio… pero también los momentos de alegría, las risas, el humor que adoptan ciertos internos y la profunda atención que cada cual le pone al otro.
Cámara Katell Djian, Nicolas Philibert • Sonido Julien Cloquet • Música original André Giroud • Montaje Nicolas Philibert, asistido por Julietta Roulet • Ayudente dirección Valéry Gaillard • Dirección de producción Patricia Conord • Productor ejecutivo Serge Lalou • Una coproducción Les Films d’Ici, La Sept Cinéma • Con la participación de Canal + y del Centre National de la Cinématographie • Con el apoyo del Conseil Régional du Centre • En asociación con Channel 4, WDR, VPRO, International Film Circuit, Filmcooperative (Zurich).
Selección oficial al Festival Internacional de Locarno, 1996 • Premio del público, Rencontres Internationales de Cinéma à Paris, 1996 • Premio del público, Festival International du Cinéma et des Nouveaux Médias, Montréal, 1997 • Mejor Documental, Festival du Film de Potsdam, 1997 • Premio special del Jurado, Festival du Film anthropologique de Pârnu (Estonie), 1997 • Gran Premio, Festival Amascultura (Lisbonne), 1997 • Golden Spire, Festival international de San Francisco, 1998.
Distribución en Francia & ventas internationales : Les Films du Losange
Estreno en cines franceses : marzo de 1997
“¿Cómo evitar caer en lo folclórico, en lo pintoresco de la locura?”
Entrevista Nicolas Philibert por Patrick Leboutte, noviembre de 1996.
¿Cómo surgió la idea de la película?
Como punto de partida, fueron varias las personas que me sugirieron que visitara La Borde. Yo había oído hablar mucho de esa institución tan frecuentemente asimilada – sin razón – a la corriente antipsiquiátrica y, fundada, en realidad, en una visión muy particular de la locura, pero hasta entonces la idea de rodar una película en el entorno psiquiátrico nunca se me había pasado por la cabeza y necesité meses antes de decidirme a ir allí. La perspectiva de enfrentarme al mundo de los locos me asustaba y no veía cómo rodar una película en un lugar así sin pecar de intrusismo. Al fin y al cabo, ¡la gente va esos sitios para que la dejen en paz!
Sin embargo, ya durante mi primera visita, me impactó el ambiente del lugar: el recibimiento, el respeto por cada uno de los internos… No es moco de pavo verse en un manicomio, aunque sea como visitante: el sufrimiento, el desamparo de algunos no te dejan indiferente… Pero había un no sé qué de tranquilizador, ni batas blancas, ni tapias altas, un sentido comunitario muy fuerte, un sentimiento de libertad… Jean Oury, director de La Borde desde sus comienzos, me recibió y me interrogó a fondo sobre mis intenciones. Entonces carecía de intenciones y, por el contrario, le expuse mis reticencias ante la idea de filmar a locos. ¿Cómo evitar caer en lo folclórico, en lo pintoresco de la locura? ¿En nombre de qué interés superior podría yo filmar, con toda tranquilidad, a personas débiles, desorientadas, fragilizadas por el sufrimiento? Personas de las que quizá nunca supiera si eran conscientes o no de la presencia de la cámara y, menos aún, del impacto de las imágenes? U otras, incluso, para las que el hecho de que las filmaran podría alimentar un sentimiento de persecución o causar delirio o provocar un número ante la cámara?
Luego, curiosamente, durante las visitas siguientes, algunos internos y cuidadores empezaron a animarme. Si yo tenía tantos escrúpulos, decían ellos, era buena señal… Según ellos, las cuestiones que me planteaba tenían respuestas mucho más matizadas. No había que creer, decían algunos pacientes, que por el hecho de que sufrieran trastornos psíquicos o enfermedades mentales, iban a dejar que la cámara los instrumentalizara. En fin, mis prejuicios se desvanecieron poco a poco y los temores producidos por mis interrogantes se convirtieron en deseos de afrontarlos… Como si ese lugar, por la vigilancia que ejerce sobre sí mismo, hiciera posible, de repente, lo que en cualquier otro sitio hubiera sido claramente una impudicia.
¿Cuáles fueron las directrices iniciales que guiaron su trabajo?
Para cada una de mis películas busco una historia, una metáfora que me permita “trascender” la realidad. Siempre se trata de conseguir que surja un relato a partir del lugar que ocupo y de evitar el enfoque pedagógico del documental que muy a menudo condena por anticipado su lado más cinematográfico. Yo necesitaba ir más allá de la simple descripción de lo cotidiano y la aventura teatral que se preparaba me venía que ni pintada. Indudablemente eso sólo era un pretexto, un medio para llegar a algo más esencial, pero al menos ya había encontrado un auténtico hilo conductor. Además, a través del teatro tenía la oportunidad de estar cerca de la gente sin inmiscuirme en su intimidad. Por último, gracias al teatro podía darle a la película un toque de ligereza, incluso una cierta alegría, lo que me parecía muy importante. Evidentemente, la obra elegida tenía mucho que ver en ello.
¿Cómo se eligió la obra?
Eso es tarea de Marie Leydier, una actriz de teatro que forma parte del personal sanitario de La Borde. Ella había montado obras clásicas los veranos anteriores: Molière, Shakespeare… Aquel verano quería probar suerte con una obra contemporánea. Una mañana llegó con el texto de “Opereta”, de Witold Gombrowicz, y a pesar de la complejidad de la obra, su opción no tardó en imponerse.
He de confesar que, para mí, al menos al principio, la elección de la obra era algo secundario. Lo que me interesaba era más el trabajo que iba a realizarse que la obra en sí: teniendo en cuenta que no mostraría más que pequeños extractos, no me preocupaba que se siguiera la trama.
Sin embargo, desde los primeros ensayos, me pareció que “Opereta” resonaba de forma extraordinaria en el contexto de La Borde, como si la exuberancia de ese texto adquiriera una mayor amplitud en el escenario de la locura. Y en la película todo ocurre como si la parte más extravagante, la más loca, fuera cosa de la obra y no de los locos.
La música ocupa un lugar preponderante tanto en la obra como en la película ¿Cómo se elaboró?
En la obra, muchos pasajes están escritos para ser cantados, pero no hay una música predeterminada. Al principio, Marie pensaba utilizar aires de opereta conocidos para adaptar estas partes cantadas. Enseguida me opuse porque me iba a tener que enfrentar a enormes problemas de derechos de autor. Le propuse que habláramos con un amigo músico, André Giroud, que suele trabajar para el teatro. Por suerte, André estaba disponible… Vino varios días antes del rodaje y empezó a componer libremente a partir de los textos de Gombrowicz. Algunos internos sabían tocar un instrumento. André les propuso que formaran una pequeña orquesta para acompañar las canciones del espectáculo. Todas las mañanas se instalaban en un rincón del parque con guitarras, percusiones y, a veces, un pequeño órganos eléctrico y, cómo no, el acordeón. Todos los internos que pasaban por ahí podían tocar el instrumento que quisieran… Entre los más asiduos, dos o tres tenían una auténtica formación musical pero los demás eran principiantes. Desde la perspectiva de la representación teatral, cabe decir que era algo muy arriesgado, aunque sumamente ambicioso. ¡Pero qué más da! El proyecto estaba abierto a todos…
André no bajó nunca el nivel de exigencia y resultó ser increíblemente paciente. Durante las primeras semanas, aún no se planteaban empezar a ensayar la música del espectáculo, primero los músicos tenían que aprender a tocar juntos y a escucharse mutuamente, en resumen, cada uno, sin importar su nivel, tenía que encontrar su lugar en el grupo. André dirigía su “taller musical” todas las mañanas y por las tardes venía a los ensayos de la obra para ensayar las canciones con los actores. Los dos grupos – músicos y actores – sólo trabajaron juntos durante los últimos días.
¿El teatro tiene una función terapéutica?
Es una pregunta compleja. La noción de “cura”, como se concibe en La Borde, no se limita en absoluto a los medicamentos. Curar es ante todo tratar de vivir juntos, aunque preservando la singularidad, la identidad de cada uno. Desde esta perspectiva, las distintas actividades, incluso las más cotidianas, tienen un papel esencial: limpieza, preparación de las comidas, lavado de vajilla, planchado, centralita telefónica, danza, música, tertulias, contabilidad… o el teatro, por supuesto, son medios que se les dan a los internos para mantener un nexo con la realidad, ya que suelen tratar de evadirse de ella. Se trata de inventar objetos que permitan “crear ese nexo”. A estos efectos, el teatro es una aventura colectiva un tanto excepcional: el hecho de tener que ensayar diariamente durante dos meses, de meterse en la piel de un personaje, de memorizar el texto, de actuar con los demás, de aparecer ante el público es un desafío, cada cual tiene que abandonar su isla de soledad y dar lo mejor de sí mismo…
A veces, el aprendizaje de un texto se convierte en una lucha contra la fatiga o las neurolépticas. Algunos lo dejan en los primeros ensayos: tratamos de repescarlos. Otros, por el contrario, están mucho tiempo apartados; pero, de repente, en el último momento, a pocos días del espectáculo, quieren «formar parte» imperativamente: hay que inventar a toda prisa un papel para ellos, o se lo inventan ellos… Puede explicarse por qué, cada verano, que salga adelante la representación es un milagro. Sin embargo, sería un error creer que el teatro, como se utiliza en La Borde, está basado en una teoría de tipo “arte-terapia”: si hacemos teatro, es ante todo porque nos apetece. Es una de las muchas maneras de compartir algo.
Siguiendo este proyecto teatral – locura o no – primero muestra que se trata de un trabajo. Esta preocupación por el “trabajo” es un elemento común en todas sus películas. Estoy pensando, en particular, en “El País de los Sordos”, con esas largas escenas de aprendizaje de la palabra y, sobre todo, en “La Ciudad Louvre”…
Ante todo, la dimensión del trabajo interviene como proceso narrativo: se trata de mostrar que algo avanza, se va transformando a lo largo de la película. El trabajo siempre aparece como una prueba que los personajes tienen que superar, una especie de reto, de dificultades por resolver. Es lo que nos acerca a ellos. En este caso, cuanto más nos acercamos a la fecha de la representación, más nos implicamos y preocupamos por ellos: ¿cómo van a salir de ésta? De hecho, la cuestión de la locura pasa a un segundo plano, porque todos sabemos que cualquiera de nosotros, enfrentado a un texto así, no las tendría todas consigo.
El trabajo es lo que da una dignidad a las personas que filmo, porque exige que den lo mejor de sí mismas. Pero, incluso aún diría más: durante el rodaje, precisamente porque trato de captar esta exigencia, podemos establecer un intercambio con ellos. Porque rodar también es un trabajo… De ahí que no perciban la cámara como una intrusión en lo que están haciendo. Compartimos – por un tiempo – el mismo espacio, estamos inmersos en el mismo movimiento.
Paralelamente a la preparación del espectáculo, la película contempla situaciones muy cotidianas…
En primer lugar, había que mostrar que el teatro no era una finalidad en sí misma, sino que formaba parte de un contexto más amplio y que La Borde no era un establecimiento vacacional tipo Club Mediterranée sino un lugar de sufrimiento y de cura. Con teatro o sin teatro, en el fondo se trata de lo mismo: se trata de prestar atención a gestos aparentemente ordinarios, sin importancia; se trata hacerle un sitio al otro con los pequeños detalles de la vida cotidiana. De ahí el título: “Lo de menos”… La escena en la que Claude se corta la barba, la del dibujo de Sophie, o la de los zancos, todas inspiran un mismo sentimiento: que lo esencial se esconde a menudo detrás de las evidencias, de los hechos más anodinos. La atención que se presta a las cosas pequeñas refleja bien el espíritu que reina en La Borde y también es un elemento constante en mis películas.
Usted nunca muestra crisis, ni conflictos. Está claro que su película no trata de hacer crítica social, pero me imagino que estos conflictos se dan en La Borde como en cualquier otra parte… ¿No teme se le tache de dar una imagen un poco idílica del lugar?
La Borde, como tal, no es el tema de la película, sino el marco que la ha hecho posible. Es un lugar probablemente criticable desde muchos puntos de vista, pero no me interesaba tratar con detalle su funcionamiento, que es muy complejo… Apoyándome en una historia verdadera, he tratado de hacer, si puedo decirlo, una verdadera historia. Teniendo en cuenta que lo esencial era que resultaran atractivos los personajes que la encarnan, me he apoyado en La Borde para tratar de conseguirlo, matizando, de paso, algunas ideas recibidas.
Siempre habrá gente que opine que la película ofrece una visión demasiado plana de la locura o de un manicomio; gente para la que un “loco” debería sufrir 24 horas al día; gente que no se atreve a reírse cuando es gracioso, o que se siente culpable después de haberlo hecho… Puedo entender todo eso porque antes de llegar a La Borde yo quizá pensaba lo mismo… En cuanto al hecho de mostrar o no situaciones de crisis, confieso que no intenté explotar esa vena espectacular cuando las personas eran aún más vulnerables que de costumbre.
Al comienzo de la película, con esas siluetas que deambulan por el parque, no estamos muy lejos de los estereotipos…
Es verdad que uno puede sentirse “voyeur”: los personajes están filmados “a distancia”, en su soledad; son unos extraños para nosotros, como nosotros lo somos para ellos. Todos los clichés de la locura nos vienen a la mente en ese momento. Pero la película dibuja una trayectoria: poco a poco nos vamos acercando los unos a los otros, se produce un encuentro y los clichés se esfuman para dejar paso a las personas. Soy consciente de que estas primeras imágenes pueden parecer agresivas y violentas, pero es como si, para acabar con los estereotipos, primero hubiera que afrontarlos…
Y al final, se repiten las mismas imágenes…
Son unas imágenes muy parecidas, es verdad, pero creo que las vemos con un sentimiento muy distinto, porque, entre tanto, los personajes se han convertido en algo más cercano para nosotros. El hecho de volver a lo que hemos visto al principio sirve para subrayar el camino recorrido.
¿Cómo aceptó cada cual que le filmaran?
Salvo en las consultas médicas, nos dijeron que podríamos filmar libremente en la institución. A partir de ahí, dependía de las personas. Nosotros teníamos que saber hasta dónde llegar con cada uno.
Éramos un equipo pequeño, cuatro personas en total. Decidimos que no rodaríamos la primera semana. Queríamos conocer a la gente tranquilamente, explicarles nuestros métodos de trabajo, sin olvidar precisarles que la película se iba a estrenar en los cines: si algunos no querían que les filmaran, estaban en su derecho; todos tenían que sentirse libres y nosotros no les íbamos a pedir que se justificaran.
A pesar de haber tomado esas precauciones, el asunto no quedaba zanjado. Se siguieron planteando las mismas cuestiones con la misma agudeza, con la misma incertidumbre hasta el último día de rodaje. No porque hubiera una desconfianza particular hacia nosotros sino porque la mayoría de la gente sólo se manifestaba en un instante preciso, dependiendo de la situación, de cómo se sintiera en cada momento. Era muy variable y, a menudo, imprevisible: un interno podía autorizarnos para que lo filmáramos y cambiar de opinión o desaparecer un minuto después.
Con algunos era aún más complicado, porque resultaba imposible mantener una conversación coherente con ellos. El ejemplo de Claude es bastante significativo. Claude es ese hombre al que filmé mientras le pelaban la barba y que siempre da la impresión de encontrarse en un lugar muy lejano… Hasta ahí, solía ir a verle y me quedaba a su lado. Me resultaba muy conmovedor… Quería rodarle pero tuve que esperar cinco o seis semanas antes de que me hiciera entender, a su manera, que no se oponía.
De una escena a otra, y en función de cada uno, había que encontrar, por tanto, el dispositivo adecuado. Cuando filmaba una reunión, establecíamos un ángulo muerto, un fuera de campo, para que todo el mundo pudiera asistir. Con los ensayos de teatro era más difícil, por los movimientos; sobre todo porque “Opereta” tiene muchas escenas de grupo. Por suerte, los que querían actuar en la obra solían aceptar la cámara. Con una excepción: uno de los músicos no quería que le rodáramos. En todos los ensayos conseguí que dejarle «off»; y el día de la representación, decidimos que todos los músicos llevaran máscaras.
En la película usted no hace distinción entre internos y personal sanitario…
En primer lugar, es una de las particularidades de La Borde. No hay ninguna señal distintiva, al menos no instituida como tal. Casi siempre, por supuesto, la locura se lee en las caras y en los gestos. Pero La Borde también recibe a gente como usted y yo, que simplemente está pasando una mala racha en un periodo de su vida. Además, como los internos tienen responsabilidades en la institución, uno nunca sabe a qué atenerse. De hecho, al cabo de los años, alguno de los «atendidos” se ha convertido en “atendedor”…
Yo nunca traté de saber quién era quién y tampoco preguntaba a nadie por su pasado. Nunca se filma a la gente en función de sus antecedentes o de su patología. Admito que algunas secuencias, sobre todo los ensayos teatrales, dejan que planee una duda sobre la identidad de algunos… ¿Pero qué? ¿Acaso tenía que añadir un subtítulo – esquizofrénico, paranoico, psiquiatra, enfermero – cada vez que una cara nueva aparecía en la pantalla?
No voy a fingir que creo que no hay fronteras entre unos y otros, pero la película no entra en eso. El hecho de no poder clasificar a ciertos personajes evita justamente que se les juzgue a priori. ¡Si eso desconcierta a algunos espectadores, cuánto lo siento! Ya sé que es cómodo y tranquilizador para uno mismo introducirse en el sufrimiento ajeno. Pero, al fin y al cabo, la frontera no es siempre tan clara, porque hay algo del otro en nosotros.
¿Los protagonistas han visto la película? En caso afirmativo, ¿cuál fue su reacción?
El pasado mes de septiembre, organizamos una gran proyección en un cine de Blois – la ciudad más cercana – para todos los “labordianos”, sus familias y amigos y, evidentemente, el equipo de rodaje. Había un ambiente muy festivo, era muy emocionante volvernos a ver todos. La película fue muy bien acogida, me sentí muy feliz por no haber traicionado su confianza.
Obviamente, durante toda la proyección, estaba impaciente por descubrir las reacciones de unos y otros. Me esperaba que los personajes de la película, impresionados por su propia aparición en la pantalla, o por los recuerdos personales que tenían de esta aventura, reaccionaran un poco como si descubrieran una película familiar, sin darse cuenta, obligatoriamente, de la medida del conjunto. Pero, pasados los primeros minutos, las reflexiones, las risas se acallaron… Y cuando se encendió la sala, me impresionó constatar, sobre todo en los internos, que su atención no se había limitado a su propia persona.
¿Ha pensado en dar el salto algún día a la ficción?
No excluyo esa posibilidad pero no tengo la impresión, porque mis películas pertenezcan al género documental, de hacer un cine de “saldos”. No me interesa rodar siguiendo un guión escrito completamente con antelación, en donde todo vaya sobre raíles. Prefiero una cierta fragilidad, ese puntito de riesgo que caracteriza a lo que se inventa día tras día sin saber cuál será la salida. En el cine, la belleza no se convoca con cita previa. Cuando ésta se desliza en una película, muy a menudo es por efracción…
¿Documental? ¿Ficción? Para mí, esa pregunta no necesariamente tiene gran interés. Desde hace tiempo pienso que, si hay dos maneras de hacer películas, la frontera no está a ese nivel, sino entre dos actitudes en la manera de confiar en el relato. Están los cineastas que creen en el encuentro con el otro y los que no creen en él. Ficción o no, una película siempre es una interpretación, una reescritura del mundo. Por desgracia, a los documentales les persigue la noción de “cruda realidad”, es así como mucha gente los descalifica como películas, es decir como metáforas, capaces de narrar el mundo como cualquier ficción. Es un prejuicio tenaz. Por eso trato de no decir, cuando hablo de la película: “es un documental sobre locos”. No es que no quiera llamar al pan, pan, pero dicho así, de manera brusca, ese tipo de fórmulas pueden espantar al público. La gente podría pensar que es una película para despertar un sentimiento de piedad, pensar: “Es una película con moralina o de esas que buscan la lágrima fácil”.
Para concluir, ¿cómo definiría el tema de la película?
El hecho de que, desde el comienzo de esta entrevista, no haya dejado de evocar la relación con los que he filmado, no es una casualidad: creo que es el tema de la película. ¿Una película sobre la locura? Por supuesto que no. ¿Sobre la psiquiatría? Aún menos. ¿Sobre el teatro? Ésa es más bien la excusa… En vez de rodar una película “sobre”, hice una película “con y gracias a”: con locos, y gracias a La Borde. Si tuviera que definir el tema, diría que es una película que habla de lo que nos une al otro, de nuestra capacidad – o incapacidad – para hacerle un sitio. Y, para terminar, de lo que el otro, en su extrañeza, puede revelarnos sobre nosotros mismos…







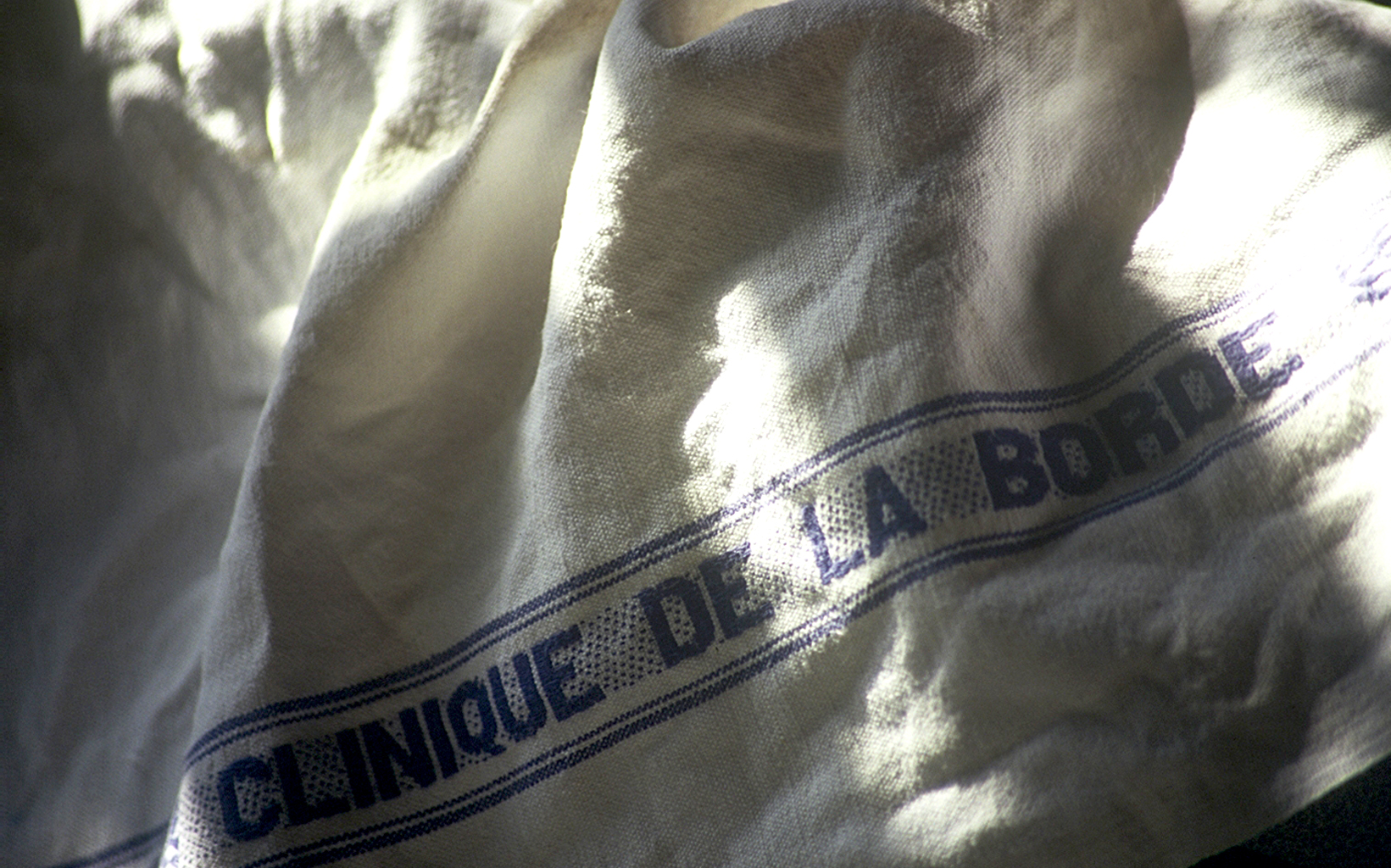


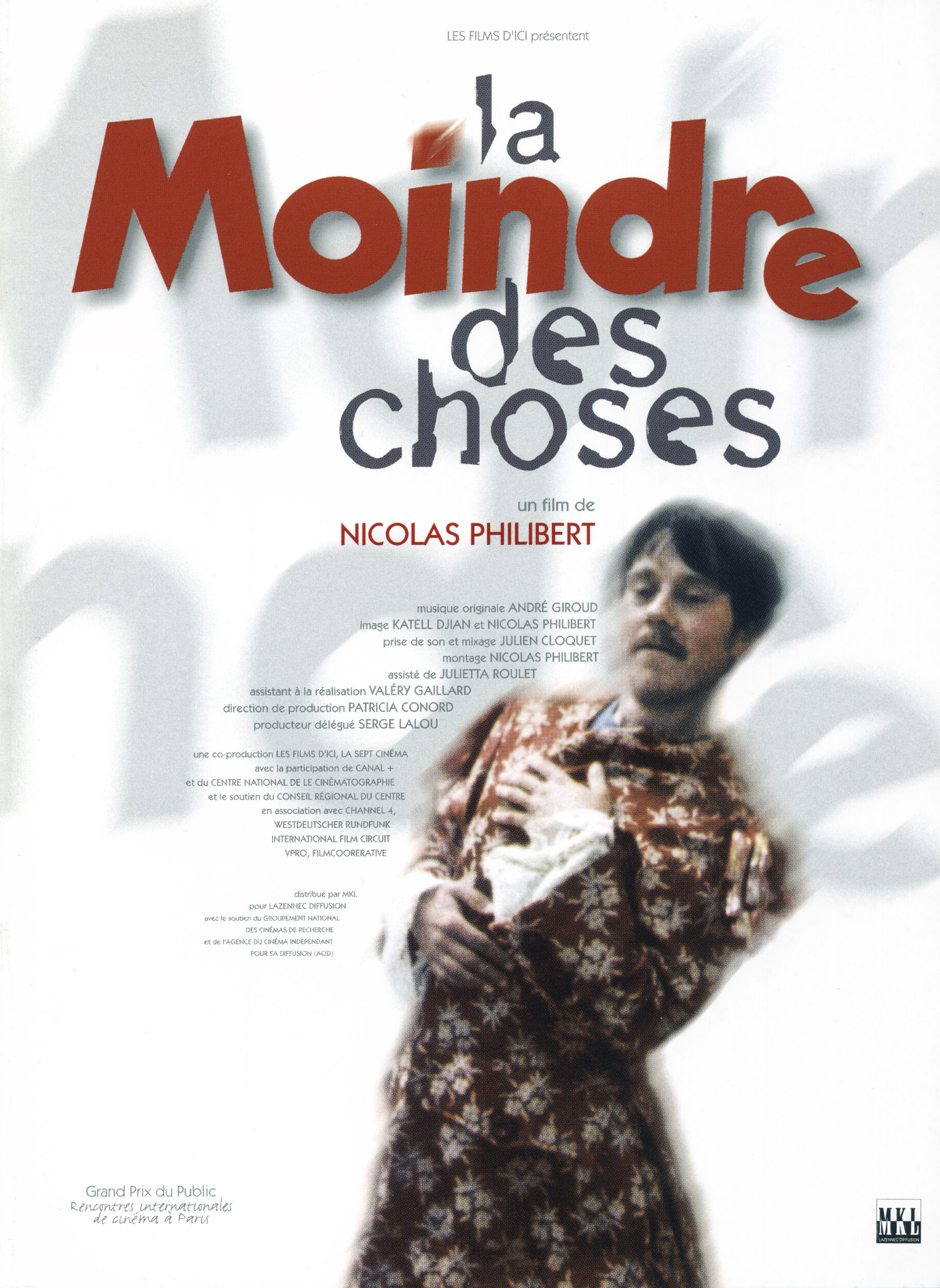
Dossier de presse - Novembre 1996
Comment est née l’idée du film ?
À l’origine, plusieurs personnes m’ont suggéré d’aller à La Borde. J’avais souvent entendu parler de cette institution si fréquemment assimilée – à tort – au courant anti-psychiatrique, et néanmoins fondée sur une approche très singulière de la folie ; mais jusque-là je n’avais jamais eu la moindre envie de tourner dans le milieu psychiatrique, et il m’a fallu des mois avant de me décider à y aller : la perspective de me confronter au monde des fous m’effrayait, et je ne voyais pas comment faire un film dans un endroit pareil sans être intrusif. Après tout, les gens qui sont là y sont venus pour qu’on leur fiche la paix !
Dès ma première visite, pourtant, j’ai été frappé par l’ambiance qui émane de ce drôle de château perdu au milieu des bois : cet effort d’accueil, de respect envers chacun… Ce n’est pas rien de se retrouver à l’asile, fut-ce comme visiteur : la souffrance, la détresse de certains vous sautent à la figure ! Mais il y avait là quelque chose d’apaisant, ni murs ni blouses blanches, un sens communautaire très fort, un sentiment de liberté… Jean Oury, qui dirige La Borde depuis ses débuts, m’a reçu et longuement questionné sur mes intentions. À l’époque je n’en avais aucune, et lui ai fait part, au contraire, de mes profondes réticences à l’idée de filmer des fous. Comment éviter le folklore, le pittoresque de la folie ? Au nom de quel intérêt supérieur pourrais-je filmer, en toute quiétude, des gens en situation de faiblesse, désorientés, fragilisés par la souffrance ? Des gens dont je ne saurais peut-être pas toujours s’ils sont ou non conscients de la présence de la caméra, du moins de l’impact des images ? Ou d’autres encore, chez qui le fait d’être filmé risquait d’alimenter un sentiment de persécution, de provoquer un délire, voire un numéro devant la caméra ?
Et puis curieusement, au cours des visites suivantes, alors que je réaffirmais mes réticences, des pensionnaires et des soignants se sont mis à m’encourager. Si j’avais de tels scrupules, pensait-on, c’était bon signe… À leurs yeux, les questions que je me posais appelaient des réponses beaucoup plus nuancées. Il ne fallait pas croire, disaient eux-mêmes certains pensionnaires, que sous prétexte qu’ils sont atteints de troubles psychiques ou de maladie mentale, ils se laisseraient instrumentaliser par la caméra ! Bref, mes préjugés sont peu à peu tombés, et les craintes nées de mes interrogations ont fini par se transformer en désir de les affronter… Comme si ce lieu, par la vigilance qu’il exerce sur lui-même, rendait soudain possible ce qui, ailleurs, aurait été certainement impudique.
Quels ont été les choix de départ qui ont guidé votre travail ?
Pour chacun de mes films, je suis à la recherche d’une histoire, d’une métaphore qui me permettra de « transcender » la réalité. Il s’agit toujours de faire naître du récit à partir du lieu que j’investis, et d’échapper à cette approche pédagogique du documentaire qui condamne par avance sa portée cinématographique. J’avais donc besoin d’aller au-delà d’une simple description du quotidien, même si cette dimension est très présente ici. Et avec l’aventure théâtrale qui se profilait, je ne pouvais pas mieux tomber ! Sans doute n’était-ce qu’un prétexte, un moyen pour atteindre quelque chose de plus essentiel ; mais du moins j’avais là un vrai fil conducteur, et puis le théâtre m’offrait d’emblée la possibilité d’être proche des gens, sans pour autant faire intrusion dans leur intimité. Enfin, le théâtre allait me permettre de donner au film une part de légèreté, voire une certaine gaîté, ce qui me semblait très important. Évidemment, la pièce y est pour beaucoup !
Comment cette pièce a-t-elle été choisie ?
ça c’est le domaine de Marie Leydier, une comédienne qui est soignante à La Borde depuis quelques années. Les étés précédents, elle avait monté des classiques : Molière, Shakespeare… Cette année, elle voulait s’aventurer du côté du théâtre contemporain. Plusieurs pensionnaires aussi. Un matin, elle est arrivée avec le texte d’Opérette, et malgré la complexité de la pièce, son choix s’est vite imposé.
J’avoue que pour moi, du moins au début, la question du choix de la pièce était un peu secondaire. Ce qui m’intéressait, c’était davantage le travail qui allait se faire que la pièce en tant que telle : sachant que je n’en montrerais que de courts extraits, je n’avais pas le souci d’en faire comprendre l’intrigue.
Pourtant, dès les premières répétitions, j’ai trouvé qu’Opérette résonnait de façon extraordinaire dans le contexte de La Borde, comme si l’exubérance de ce texte prenait plus d’ampleur encore sur la scène de la folie ! Du même coup, dans le film, tout se passe comme si la part la plus extravagante, la plus folle était prise en charge par la pièce et non par les fous eux-mêmes.
La musique a une part prépondérante dans la pièce comme dans le film. Comment a-t-elle été élaborée ?
Dans la pièce, de nombreux passages sont censés être chantés, mais il n’y a pas de musique préexistante. Au début, Marie avait envisagé d’adapter ces parties là sur des airs d’opérette connus. J’ai aussitôt objecté que j’allais me trouver confronté à des problèmes de droits musicaux ! Je lui ai donc proposé de rencontrer un ami musicien, André Giroud, qui travaille fréquemment pour le théâtre. Par chance, André était disponible… Il nous a rejoints quelques jours avant le tournage et s’est mis à composer librement sur les textes de Gombrowicz. Certains pensionnaires avaient déjà joué d’un instrument. André leur a proposé de former avec lui un petit orchestre pour accompagner les chansons du spectacle. Chaque matin, dans un coin du parc, il installait des guitares, des percussions, parfois même un piano électrique ; et bien sûr, son accordéon. Les pensionnaires qui passaient là pouvaient à leur gré s’emparer d’un instrument…
Parmi les plus fidèles, deux ou trois avaient une vraie formation musicale, mais les autres étaient débutants. Dans la perspective de la représentation théâtrale, autant dire que c’était fragile, extrêmement ambitieux ! Mais qu’importe ! Le projet était ouvert à tous.
André n’a jamais baissé le niveau de ses exigences, et s’est montré infiniment patient. Les premières semaines, il n’était pas question encore de s’atteler aux airs du spectacle : il fallait d’abord que les musiciens apprennent à jouer ensemble, à s’écouter les uns les autres, bref que chacun, quel que soit son niveau, ait sa place dans le groupe. Chaque matin donc, il animait un « atelier musique »; et les après-midi, il venait aux répétitions théâtrales pour faire chanter les acteurs. Ce n’est que dans les derniers jours que les deux groupes – musiciens et comédiens – ont travaillé ensemble.
La pratique du théâtre a-t-elle une fonction thérapeutique ?
C’est une question complexe : la notion de « soin », telle qu’elle est conçue à La Borde, est loin de se limiter aux médicaments. Soigner, c’est d’abord essayer de vivre ensemble en préservant la singularité, l’identité de chacun. Dans cette perspective, les différentes activités, voire les plus quotidiennes, jouent un rôle essentiel. Ménage, préparation des repas, vaisselle, repassage, standard téléphonique, danse, musique, discussions, comptabilité… ou théâtre, en effet, sont autant d’occasions offertes aux pensionnaires de garder un lien avec la réalité, alors qu’ils ont bien souvent cherché à la fuir. Il s’agit d’inventer des objets qui permettent de « créer du lien ». À ce titre, le théâtre constitue une aventure collective un peu exceptionnelle : le fait de devoir répéter quotidiennement pendant deux mois, d’entrer dans la peau d’un personnage, d’apprendre son texte, de jouer avec d’autres, d’apparaître devant un public constitue un défi, chacun étant appelé à quitter son îlot de solitude et à donner le meilleur de soi…
Parfois, l’apprentissage du texte prend l’allure d’un combat contre la fatigue ou les neuroleptiques. Certains abandonnent dès les premières répétitions : on essaie de les repêcher. D’autres, à l’inverse, restent très longtemps à l’écart ; mais voilà qu’au dernier moment, à quelques jours du spectacle, ils veulent « en être » impérativement : dans l’urgence il faut alors leur inventer un rôle, à moins qu’ils ne l’inventent eux-mêmes… Autant dire que, chaque été, la représentation tient du miracle !
Ceci étant, il serait faux de croire que le théâtre, tel qu’il s’inscrit à La Borde, repose sur une quelconque théorie du genre « art-thérapie ». Si on fait du théâtre, c’est avant tout parce qu’on en a envie ! C’est un moyen comme un autre de partager quelque chose.
En suivant ce projet théâtral – folie ou pas – vous montrez d’abord qu’il s’agit d’un travail. Cette inscription du « travail » est un trait commun à tous vos films. Je pense en particulier au Pays des sourds, avec ces longues séquences d’apprentissage de la parole, et bien sûr à La Ville Louvre…
Avant tout, la dimension du travail intervient comme processus narratif : il s’agit de montrer que quelque chose progresse, se transforme au cours du film. Le travail apparaît toujours sous la forme d’une épreuve que les « personnages » devront surmonter, une suite d’enjeux, de difficultés à résoudre. C’est ce qui nous rapproche d’eux. Ici, plus nous avançons vers la date de la représentation, et plus nous prenons fait et cause pour eux : comment vont-ils s’en tirer? Dés lors, la question de la folie passe au second plan, parce que nous savons bien que n’importe qui d’entre nous, confronté à un texte pareil, n’en mènerait pas large !
Le travail est ce qui donne une dignité aux personnes que je filme, parce qu’il exige le meilleur d’eux-mêmes. Mais j’irais plus loin : au cours du tournage, c’est précisément parce que je cherche à saisir cette exigence que peut s’établir un échange avec eux. Car filmer, c’est aussi un travail… Dés lors, ils ne perçoivent pas la caméra comme une intrusion dans ce qu’ils font. Nous partageons – pour un temps – le même espace, nous sommes dans le même mouvement.
Parallèlement à la préparation du spectacle, le film s’attarde sur des situations très quotidiennes…
Tout d’abord, il fallait montrer que le théâtre n’est pas une fin en soi, qu’il s’inscrit dans un contexte plus large ; et que La Borde n’est pas un village du Club Med, mais un lieu de souffrance et de soins !
Théâtre ou pas, il s’agit au fond de la même chose : une attention portée à des gestes apparemment ordinaires, sans importance ; une façon de faire une place à l’autre qui passe par des petits détails de la vie quotidienne ! D’où évidemment le titre : La Moindre des choses. La scène où Claude se fait couper la barbe, celle du dessin de Sophie, ou encore celle des échasses inspirent toutes un même sentiment, à savoir que l’essentiel se cache souvent derrière les évidences, les faits les plus anodins. Cette attention aux petits riens traduit bien l’esprit qui anime La Borde, mais c’est aussi une constante dans mes films.
Vous ne montrez jamais ni crises ni conflits. Il est clair que votre film n’est pas situé sur le terrain de la critique sociale, mais j’imagine qu’à La Borde cela existe comme partout ailleurs… Ne craignez-vous pas qu’on vous reproche d’en donner une image un peu idyllique ?
La Borde en tant que telle n’est pas le sujet du film, mais le cadre qui l’a rendu possible ! C’est un lieu sûrement critiquable sur bien des points, mais je n’ai pas cherché à entrer dans les détails de son fonctionnement, qui est infiniment complexe… En m’emparant d’une histoire vraie, j’ai plutôt essayé, si j’ose dire, d’en faire une vraie histoire ! L’essentiel étant de rendre attachants les personnages qui l’incarnent, je me suis appuyé sur La Borde pour tenter de le faire, en écornant au passage quelques idées reçues.
Il y aura toujours des gens pour qui le film offre une vision trop lisse de la folie ou de l’asile ; des gens pour qui un « fou » devrait souffrir 24 heures sur 24 ; des gens qui ne s’autoriseront pas à rire quand c’est drôle, ou qui se sentiront honteux après l’avoir fait… Tout cela, je peux le comprendre, d’autant plus qu’avant d’arriver à La Borde, je pensais à peu près la même chose… Quant au fait de montrer ou non des situations de crises, j’avoue ne pas avoir cherché à exploiter cette veine spectaculaire, où les gens sont plus vulnérables encore que d’habitude.
Au début du film, avec ces silhouettes qui déambulent dans le parc, on n’est pas loin des stéréotypes…
C’est vrai qu’on peut se sentir voyeur : les personnages sont filmés à distance, dans leur solitude ; ils nous sont étrangers, comme nous le sommes pour eux. Dès lors, tous les clichés de la folie viennent à l’esprit. Mais le film dessine une trajectoire : peu à peu, on se rapproche les uns des autres, une rencontre a lieu, et les clichés s’effacent là où apparaissent des personnes. J’ai bien conscience que ces premières images peuvent sembler agressives et violentes, mais c’est comme si, pour renverser les stéréotypes, il fallait d’abord les affronter.
À la toute fin, ces mêmes images reviennent…
Ce sont des images très semblables, c’est vrai, mais je crois qu’on les perçoit avec un sentiment bien différent, parce qu’entre temps les personnages nous sont devenus plus proches. Le fait de revenir à ce qu’on a vu au début permet de mettre l’accent sur le chemin parcouru.
Comment les uns et les autres ont-ils accepté d’être filmés ?
À l’exception des consultations médicales, il était admis que nous pourrions filmer librement dans l’institution. Au-delà, c’était une question de personnes. A nous de voir avec chacun.
Nous étions une très petite équipe, de quatre en tout. La première semaine, nous avons décidé de ne pas tourner. Nous voulions prendre le temps de rencontrer les gens, d’expliquer nos méthodes de travail, sans oublier de préciser que le film était destiné à sortir en salles : si certains ne voulaient pas être filmés, ça leur appartenait, nous n’irions pas leur demander de se justifier.
Ces précautions étant prises, la question n’était pas réglée pour autant. Elle s’est posée avec la même acuité, le même poids d’incertitude jusqu’au dernier jour de tournage ! Non pas qu’il y ait eu une méfiance particulière à notre égard, bien au contraire… Mais parce que la plupart des gens se prononçaient dans l’instant, selon la situation, leur forme du moment. C’était très variable, souvent imprévisible : un pensionnaire pouvait très bien nous donner son accord et changer d’avis, ou s’éclipser un instant plus tard !
Avec d’autres, c’était plus compliqué encore, parce qu’il était impossible d’avoir une conversation cohérente avec eux. L’exemple de Claude est significatif. Claude, c’est cet homme que j’ai filmé lorsqu’on lui taille la barbe, et qui donne perpétuellement l’impression d’être dans un ailleurs très lointain… Jusque-là, il m’arrivait souvent d’aller le voir et de rester à ses côtés. Je le trouvais très émouvant… J’avais envie de le filmer, mais j’ai dû attendre cinq ou six semaines avant qu’il me fasse comprendre, à sa manière, qu’il n’y était pas opposé.
D’une séquence à l’autre, et vis à vis de chacun, il fallait donc trouver le dispositif adéquat. Quand je filmais une réunion, nous déterminions un angle mort, un hors champ, de sorte que tout le monde puisse y assister quand même. Avec les répétitions théâtrales, c’était plus difficile, à cause des déplacements ; d’autant qu’Opérette comporte de nombreuses scènes de groupe. Par chance, ceux qui voulaient jouer dans la pièce acceptaient généralement la caméra. À une exception près : l’un des musiciens ne voulait en aucun cas être à l’image. A chaque répétition j’ai donc veillé à ce qu’il soit « off » ; et le jour de la représentation, nous avons décidé que tous les musiciens porteraient des masques.
Dans le film vous ne distinguez pas les pensionnaires des soignants…
Avant tout, c’est une des particularités de La Borde. Il n’y a aucun signe distinctif, du moins formalisé en tant que tel. La plupart du temps, bien sûr, la folie se lit sur les visages et dans les gestes. Mais La Borde accueille aussi des gens comme vous et moi, simplement fragilisés à un moment de leur vie. Par ailleurs, comme les pensionnaires ont des responsabilités dans l’institution, on ne sait pas toujours à quoi s’en tenir. D’ailleurs, au fil des années, certains soignés sont devenus soignants…
Pour ma part, je n’ai jamais cherché à savoir précisément qui est qui, ni interrogé quiconque sur son passé. Les gens ne sont jamais filmés en fonction de leurs antécédents ou de leur pathologie. J’admet que plusieurs séquences, en particulier les répétitions théâtrales, laissent planer un doute sur l’identité de certains… Mais quoi ? Fallait-il que j’ajoute un sous-titre – schizophrène, paranoïaque, psychiatre, infirmier – chaque fois qu’une nouvelle tête apparaît à l’écran ?
Je ne veux pas faire semblant de croire qu’il n’y a pas de frontière, de différence entre les uns et les autres ; mais le film ne se situe pas sur ce terrain-là. Le fait de ne pas pouvoir mettre une étiquette sur certains personnages interdit précisément de les juger a priori. Tant pis s’il y a des spectateurs que cela déroute ! Je sais qu’il est confortable, rassurant pour soi-même d’habiter la souffrance de l’autre. Mais après tout, la frontière est parfois ténue, parce qu’il y a de l’autre en nous.
Vos protagonistes ont-ils vu le film ? Et si c’est le cas, comment ont-ils réagi ?
En septembre dernier, nous avons organisé une grande projection dans un cinéma de Blois, la ville la plus proche, pour l’ensemble des « Labordiens », leurs familles et amis, et bien sûr l’équipe de tournage. Il y avait une atmosphère de fête, c’était très émouvant de nous retrouver tous. Le film a été accueilli avec beaucoup de chaleur, et je me suis senti heureux de ne pas avoir trahi leur confiance.
Bien entendu, tout au long de la projection, j’étais impatient de découvrir les réactions des uns et des autres. Je m’attendais à ce que les personnages du film, happés par leur propre apparition à l’écran, ou par les souvenirs personnels qu’ils gardaient de cette aventure, réagissent un peu comme s’ils découvraient un film de famille, sans forcément prendre la mesure de l’ensemble. Mais passées les premières minutes, les réflexions, les rires se sont tus… Et quand la salle s’est rallumée, j’ai été frappé de voir, notamment parmi les pensionnaires, que leur attention s’était portée bien au-delà de leur propre personne.
Avez-vous l’intention de passer un jour à la fiction ?
Je ne l’exclus pas, mais je n’ai pas le sentiment, sous prétexte que mes films appartiennent au genre documentaire, de faire un cinéma au rabais. L’idée de tourner selon un scénario entièrement écrit d’avance, et où tout irait de soi, ne m’intéresse pas. J’incline pour une certaine fragilité, cette part de risque liée à ce qui s’invente au jour le jour sans qu’on en connaisse toujours l’issue. Au cinéma, la beauté ne se convoque pas sur rendez-vous. Lorsqu’elle se glisse dans un film, c’est presque toujours par effraction.
Documentaire ? Fiction ? Pour moi, la question n’a plus grand intérêt ! Je pense depuis longtemps que s’il y a deux manières de faire des films, la frontière ne se situe pas à ce niveau, mais plutôt entre deux attitudes dans la manière de faire confiance au récit. Il y a les cinéastes qui croient à la rencontre avec l’autre, et ceux qui n’y croient pas. Fiction ou non, un film est toujours une interprétation, une réécriture du monde. Malheureusement, les documentaires sont poursuivis par la notion de «réalité brute», de sorte que beaucoup de gens les disqualifient en tant que films, c’est à dire en tant que métaphores, capables de raconter le monde comme le fait n’importe quelle fiction. Ce préjugé est tenace. C’est pourquoi j’évite de dire de mon film : « C’est un documentaire sur les fous ». Non que je ne veuille pas appeler un chat un chat, mais parce qu’aussi abruptement énoncée, ce type de formules risque de faire fuir le public. Les gens pourraient penser qu’on cherche à susciter leur pitié, se dire : « On va nous faire la morale, ou nous extorquer des larmes ! »
Pour conclure, comment définiriez-vous, justement, le sujet de votre film ?
Depuis le début de cet entretien, si je n’ai cessé d’évoquer la relation à ceux que j’ai filmés, ce n’est pas un hasard : je crois que c’est le sujet même du film ! Un film sur la folie ? Certainement pas. Sur la psychiatrie ? Encore moins ! Le théâtre ? Un prétexte… Plutôt qu’un film sur, j’ai fait un film avec et grâce à : avec des fous, et grâce à La Borde. Alors, s’il fallait en définir le sujet, je dirais que c’est un film qui parle de ce qui nous relie à l’autre, de notre capacité – ou incapacité – à lui faire une place. Et finalement, de ce que l’autre, dans son étrangeté, peut nous révéler de nous-mêmes.
Les Cahiers du Cinéma n° 511 - Mars 1997
Votre cinéma, même s’il met en scène des lieux institutionnels comme le Louvre ou La Borde, n’a visiblement pas pour projet d’interroger le mécanisme de ces institutions, contrairement par exemple aux films de Wiseman. Avez vous choisi La Borde pour son aspect faiblement institutionnalisé, parce que cela vous permettait de parler d’autre chose que de l’institution ?
Contrairement à ce qu’on peut croire, la clinique de La Borde n’est pas « faiblement institutionnalisée ». Depuis sa création, en 1953, c’est un lieu qui fait un effort permanent de réflexion sur son propre fonctionnement, en partant de l’idée que la notion de « soin » doit s’appliquer à elle même autant qu’aux pensionnaires. D’où des mécanismes institutionnels très complexes, malgré les apparences. Bien sûr, cette dimension n’apparaît qu’en filigrane dans le film, parce que mon propos, à l’inverse de celui de Wiseman, n’avait pas pour objectif premier de mettre à nu ces rouages. Si j’avais tourné dans un lieu classique, je me serais certainement situé sur le terrain dc la critique sociale, mais ce n’est pas le cas. Je suis plutôt du côté de la fable, presque de la fiction. C’est tout juste, en voyant le film, si l’on sait où on se trouve…
Le film donne le sentiment que vous entretenez une grande familiarité avec ce lieu, alors que cette proximité n’est pas du tout antérieure à la préparation du film, je crois.
J’avoue que jusqu’ici, l’idée de faire un film sur l’univers psychiatrique ne m’avait jamais attiré. De peur d’être intrusif, d’ériger malgré moi la souffrance en spectacle, de troubler le fonctionnement d’un lieu où les gens qui sont là, viennent pour être en paix. Mais en arrivant à La Borde, j’ai été frappé par cette façon de transformer un asile en lieu d’accueil et de liberté. Les gens y ont droit à être ce qu’ils sont, ils y ont droit à la folie. J’étais séduit, mais ça ne suffisait pas. Au fur et à mesure que j’exposais mes réticences, les gens autour de moi, les pensionnaires, les soignants ont commencé à m’encourager. Et c’est en apprenant l’existence, chaque été, d’un spectacle de théâtre, que je me suis décidé à faire le film, je n’aurais pas pu m’en tenir à une chronique au quotidien. J’avais besoin d’un élément narratif, d’une médiation. Le film traduit cette rencontre qui s’opère petit à petit. Dans les premières images, on est à distance, on est voyeur, mais peu à peu l’espace se resserre.
En même temps, un certain nombre de scènes sont extérieures à ce fil narratif des répétitions théâtrales. Quels choix ont présidé à la composition du film?
Je suis rentré du tournage avec un vif sentiment de désespoir. J’avais accumulé des heures et des heures de film, mais c’est comme si j’avais couru après quelque chose qui m’échappait en permanence. Naturellement, je n’avais plus aucun recul ! Je me suis alors installé au montage, j’ai visionné deux fois l’ensemble des rushes, et j’ai commencé à reprendre confiance, à recentrer les choses. D’emblée, j’ai écarté une très grande part de mon matériel pour ne conserver, comme base de travail, que trois heures de rushes. Avec les répétitions théâtrales, j’avais un fil conducteur, une chronologie. Mais je voulais que le film fasse des allers retours entre le théâtre et les situations plus quotidiennes. J’ai monté le film d’une manière très intuitive, sans faire de plan général de la structure. J’ai réfléchi à la première scène, je l’ai montée, puis j’ai cherché ce qui devait venir juste après, et ainsi de suite jusqu’à la fin. Tout le film s’est construit par associations, d’une scène à l’autre, de façon empirique. Aujourd’hui, je m’aperçois que le résultat final est très fidèle à la note d’intention que j’avais rédigée avant le tournage.
Est ce qu’il avait déjà eu des tournages à La Borde?
Oui, dans les années 60, il y avait eu une émission de télévision d’Igor Barrère et Etienne Lalou, mais je ne l’ai pas vue. En revanche, j’ai vu un film assez court mais extraordinaire sur un danseur japonais qui évolue au milieu du parc, entouré par les gens de La Borde. Et puis, ces dernières années, les spectacles estivaux ont été filmés en vidéo pour qu’il en reste une trace.
On a l’impression dans le film que les pensionnaires sont tout à fait conscients de la présence de la caméra, qu’ils en jouent, et que vous tenez à ce que cette présence soit inscrite dans le film.
L’une de mes réticences, avant de me lancer dans ce projet, était précisément liée au fait de ne pas savoir si certains pensionnaires seraient conscients ou non de la présence de la caméra, du moins de l’impact des images. Je ne savais pas encore que la réalité allait me prouver le contraire, et que cette crainte reposait sur une vision erronée du monde des fous. Exception faite des quelques plans du début, où l’on voit des pensionnaires déambuler dans le parc de la clinique, je n’aurais pas pu filmer les gens à leur insu. Le vrai sujet du film, c’est la rencontre qui s’opère progressivement entre les pensionnaires et la caméra. C’est à dire entre eux et nous, spectateurs.
Si La Moindre des choses n’est pas un film sur l’institution, ce n’est pas non plus un film sur les mécanismes de la folie. Rien n’interroge les raisons pour lesquelles les pensionnaires sont là, le film est d’une grande discrétion là dessus.
C’est vrai que je n’ai jamais cherché à savoir pourquoi ils étaient là, quelle était leur pathologie, ni même s’ils étaient pensionnaires ou soignants. Quand on arrive à La Borde, on ne sait pas toujours qui est qui, parce qu’il n’y a pas de signes distinctifs, pas de blouses blanches, rien qui permette de situer les gens d’un côté ou de l’autre. Bien sûr, chez la plupart des patients, la folie se lit sur leur visage, dans leurs gestes. Mais pour certains, on ne sait pas très bien à quoi s’en tenir, parce que ce lieu accueille aussi des gens comme vous et moi, simplement fragilisés à un moment de leur vie. Aujourd’hui encore, pour quelques uns, je ne sais pas de quel côté ils sont. Je ne leur ai pas demandé.
De toute façon, je n’avais pas l’intention de traquer les gens dans leurs moments d’effondrement, ou de fouiller dans leur passé. Dans le film, lorsqu’il m’arrive de poser une question, je ne sors pas du cadre du travail qui est en train de se faire, au présent.
Il y a malgré tout une scène où passe une grande violence, celle du dessin. Elle peut sembler en rupture avec le reste du film. Avez vous hésité à la garder?
Pour moi, les situations quotidiennes comptaient autant que les répétitions théâtrales. Après tout, le théâtre n’était peut être qu’un prétexte. Il m’a servi de fil conducteur, et m’a donné la possibilité d’être rapidement proche des gens sans avoir à faire intrusion dans leur intimité. La scène dont vous parlez peut sembler en rupture avec le reste parce que je m’y attarde longuement, mais c’est l’une de celles qui incarnent le mieux l’esprit de ce lieu, cette attention de chaque instant que l’on accorde à des petits riens, à des faits, des gestes apparemment sans importance. Ce qui est beau, c’est de voir comment Sophie parvient à imposer son projet : dessiner le portrait d’une autre. Cela passe d’abord par une phase très violente, puis le calme s’établit peu à peu autour d’elle, parce qu’on fait une place à son désir singulier. Théâtre ou pas, il s’agissait au fond de montrer comment on entoure les gens, comment on essaie d’accueillir le désir de chacun, de créer du lien, d’offrir aux pensionnaires l’occasion de garder un contact avec la réalité.
Comment des personnages ont émergé à partir de tout ce que vous avez filmé? Comment avez vous fait pour choisir certains pensionnaires et les construire comme des personnages?
Comme dans n’importe quel lieu, il y a des personnes qui vous touchent, d’autres moins. Il y a des gens qu’on a envie de filmer, d’autres pas. Certains se sont offerts très rapidement. Michel, cet homme que je questionne et qu’on voit souvent, est quelqu’un avec qui une forme de connivence s’est très vite établie. Dès les premiers jours, il nous a accordé sa confiance, et nous a donné quelque chose de lui. Avec d’autres, la rencontre a aussi été forte, mais beaucoup plus lente. Comme Hervé, ce jeune homme blond qui vient regarder timidement, du coin de l’oeil, les premières répétitions, puis qui finira par se faire happer par le théâtre, jusqu’à râler à la fin parce qu’il n’a pas un rôle assez important dans la pièce. Hervé, c’est donc un « personnage » qui évolue considérablement au cours du film, et dont j’ai soigneusement construit la trajectoire au montage, en dosant chacune de ses apparitions. La transformation du rapport que le spectateur entretient avec le film passe beaucoup par lui. À mesure qu’il évolue, qu’il s’ouvre à ce qui l’entoure, notre propre regard se modifie. Peu à peu, une barrière tombe, notre peur s’estompe. Au départ, on a tous des clichés sur la folie. Elle est synonyme de violence, d’incohérence, d’irrationnalité. Le film bat en brèche ces a priori. La folie ne s’oppose pas forcément à la raison. On voit bien que Michel choisit ses mots avec une grande maîtrise. Son discours est parfaitement articulé.
Concernant la pièce de Gombrowicz mise en scène à La Borde, le rapport au texte produit, de ce point de vue, un effet assez sidérant. On pense a priori que les gens qui sont là n’ont aucune prise sur la raison, or ils sont capables de fournir un travail très cohérent de comédiens (apprendre un texte, le jouer…) sur un texte qui, lui, est justement totalement incohérent et irrationnel…
Dans le film, tout se passe comme si la part la plus exubérante, la plus pittoresque de la folie était prise en charge par la pièce. Les pensionnaires, eux, apprennent leur texte, le répètent… Ils entrent de plain-pied dans l’espace du travail et du jeu, et partagent soudain les mêmes difficultés que n’importe quels acteurs. Ce à quoi on pouvait s’attendre dans un asile, comme voir des gens qui disent n’importe quoi, c’est plutôt à Gombrowicz qu’on le doit.
Si la scène du dessin ou la scène de la barbe sont surprenantes, c’est parce que dans la plus grande partie du film, les pensionnaires semblent maîtriser ce qu’ils donnent au film. Ils disposent de la caméra plus qu’elle ne dispose d’eux. Là, dans ces deux scènes, au contraire, vous enregistrez quelque chose qui leur échappe.
Dans les scènes de répétitions théâtrales, ils sont effectivement tenus par la discipline du jeu et par l’ambiance du groupe. Alors que dans les deux scènes dont vous parlez, quelque chose en eux se relâche et s’abandonne. Quand on filmait les répétitions, la caméra amenait les gens à plus de tenue encore. Ils voulaient nous donner une image digne d’eux mêmes.
Y a-t-il une forme de direction d’acteurs dans votre méthode?
Au cours des repetitions théâtrales ou musicales il m’est souvent arrivé de demander aux « acteurs » d’attendre quelques minutes, le temps de nous préparer, ou même de recommencer telle scène, telle chanson, pour en filmer une deuxième prise. C’était accepté par tous. Mais je n’appelle pas ça de la direction d’acteur, d’autant que ce rôle là incombait à Marie, qui mettait en scène la pièce, et à André, le musicien. Hors du théâtre, il y a des situations que j’ai provoquées, ou réorganisées. Dans ces cas là, il ne s’agit pas de demander aux gens de faire quelque chose qui leur est étranger, ni de leur faire rejouer à l’identique une situation qu’ils auraient déjà vécue. Si je filme Michel au standard, c’est parce qu’à l’époque, il assumait cette fonction une heure chaque jour. Quand je filme la scène de la cuisine, où pensionnaires et soignants s’affairent à préparer le repas, je l’annonce dès la veille. Cela permet à ceux qui ne veulent pas être filmés de ne pas y venir ce jour là. A l’inverse, je vais solliciter certains, leur demander s’ils acceptent d’y venir, dans l’idée de donner plus de poids à leur « personnage ». Pour reprendre la comparaison que vous faisiez entre la démarche de Wiseman et la mienne, j’ai le sentiment que sa position est beaucoup plus neutre, à distance, moins interventionniste que la mienne. Il incarne pleinement le documentaire, version réalité brute. Chez moi, il y a davantage d’interactions avec les personnes que je filme, une forme de proximité, une confiance nécessaire. « Capter le réel », pour moi, ça ne veut pas dire grand chose. Le réel n’est qu’une reconstruction, une relecture du monde, quelque chose dont on s’empare et que l’on questionne avec sa sensibilité, ses fantasmes, les histoires qu’on a en soi et qu’on projette.
Il y a de toute façon une dimension de récit dans le film.
Mon désir était de raconter une histoire et je voulais, peut être pour conjurer ma propre frayeur, que cette histoire contienne une part de gaieté. Pour chacun de mes films, il s’agit d’aller du côté de la narration, et d’échapper à cette approche pédagogique qui condamne presque toujours sa portée cinématographique. Je m’empare d’une histoire vraie, celle des gens que je filme à un moment précis, et la leur restitue sous une autre forme, à travers ma vision personnelle, en essayant de ne pas trahir au passage la confiance qu’ils m’ont faite en me livrant une part d’eux mêmes.
On est également frappé par la mélancolie du film. Cette mélancolie n’est pas spécialement liée à la folie des gens qui sont filmés, ni à leur vie à La Borde qui semble d’une grande douceur, mais réside plutôt dans le rythme du film, son rapport au temps. A travers le rythme d’une saison, il transmet de façon très forte le sentiment du temps qui passe et on sent sourdre une mélancolie très profonde derrière la douceur.
Ce sentiment vient sûrement du temps qui passe, mais peut être aussi de la nature… L’une des premières choses qu’on remarque à la Borde, c’est la forte présence des arbres. Si les pensionnaires ont fui la société, ils n’en ont pas moins un rapport au monde, à la nature, au temps, à l’espace… Je voulais que le film traduise cet espace temps différent. D’où ces longs plans sur les arbres agités par le vent. D’où également la scène de l’orage. C’est beau, un orage, mais ça remue au plus profond. Et le tonnerre qui s’éloigne, c’est un instant de pure mélancolie, comme une chose qui n’en finit pas de mourir. La mélancolie est peut être aussi le propre du théâtre, avec l’euphorie liée à la préparation d’un spectacle, et la retombée qui suit la représentation.
N’avez vous pas eu peur de donner une image idyllique de la folie?
Je crois qu’il y aura toujours des gens pour qui le film ne montre pas assez de souffrance, ni cette part de pittoresque à laquelle on s’attend dans un film sur les fous. Ça fait partie des clichés. Je n’ai pas cherché à montrer cet endroit sous un jour paradisiaque, mais c’est vrai qu’à La Borde, on est frappé par l’ambiance, ce côté hâvre de paix, à l’abri de la violence du monde. Par ailleurs, c’est un lieu de soins, et les médicaments créent une certaine torpeur, un ralentissement général qui contribue à ce sentiment d’apaisement. Il se peut que le film esquisse la question de savoir si un lieu comme celui là n’est pas aussi un piège pour ceux qui y viennent. S’ils s’y sentent protégés, auront ils envie d’en sortir un jour ? Je crois que cette question n’appelle aucune réponse. Tant mieux, après tout, si les gens y sont traités.
II n’y a dans le film aucune présentation du lieu, aucun souci pédagogique; n’est ce pas courir le risque de perdre le spectateur?
Au contraire. C’est ce qui lui donne un petit air de fiction. On ne sait pas trop où on est. Il y a ce château, ces bois, ces corps tordus par la folie, la musique, ces costumes de théâtre faits de bric et de broc… On est à l’écart du monde, un peu comme dans les contes. En même temps, tout y est bien réel. C’est un endroit doux et violent. Un lieu de souffrance, de détresse, mais aussi de réconfort et de soins. Ce n’est pas tant un film sur La Borde qu’un film grâce à La Borde. Il est probable qu’en allant voir le film, une partie des spectateurs saura où il s’est tourné. Mais pour les autres, cela n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est que l’on voie que ça existe.
Tout le film travaille sur l’indiscernable : les patients qu’on confond avec les soignants, ce lieu dont on ne comprend pas trop comment il fonctionne, enfin la folie dont on n’est plus très sûr de savoir ce qu’elle est à l’issue de la projection.
C’est sûrement ce qui rend le film dérangeant. Certains pensionnaires n’ont pas l’air malades. Ils ne hurlent pas leurs angoisses. En plus, je ne dis pas aux gens ce qu’il faut penser de cet endroit, ou de la psychiatrie. Je ne dénonce rien. Je m’en tiens à faire un film avec des gens, en espérant que l’épaisseur singulière des êtres humains prendra le pas sur les a priori qu’on peut avoir sur eux. J’essaie aussi de faire rire. On rit beaucoup, avec les fous. Depuis quand ces gens là n’auraient ils pas d’humour, y compris sur eux mêmes ? Le Pays des sourds obéissait à une démarche semblable. On part tous du préjugé selon lequel un sourd est un triste handicapé. Mais le film opérait un renversement, il venait nous montrer, entre autres, leur extraordinaire richesse linguistique.
Qu’est ce qui a changé dans votre méthode depuis votre premier film, à la fin des années 70, La Voix de son maître ? Qu’avez vous le sentiment d’avoir appris?
Dans La Voix de son maître, il s’agissait, pour Gérard Mordillat et moi, de porter un regard analytique et critique sur ce que l’on montrait. Le film visait à décortiquer le discours patronal, et reposait sur un dispositif théorique. C’est un film réalisé à deux, et dans ce genre d’entreprises, il y a un côté dénominateur commun, chacun reste un peu sur son quant à soi. Aujourd’hui, j’avance bien davantage avec mes sentiments. La première fois que j’ai atterri à La Borde, Jean Oury et plusieurs soignants ont entrepris de m’expliquer certaines choses. Je les ai arrêtés très vite, je ne voulais pas m’embarrasser de notions théoriques sur la folie ou je ne sais quoi. Je préférais découvrir les choses par moi-même, me faire ma petite idée. J’aime bien me mettre dans cette position là. Si on s’appuie sur de la théorie, on n’est plus du côté du cinéma mais de la pédagogie et du didactisme.
Le film est tourné en super 16 et gonflé en 35. Si vous n’aviez pas eu un budget relativement confortable, vous auriez pu faire le film en vidéo?
Je ne crois pas. Même si j’avais dû le faire pour la télé, j’aurais choisi le support film. Je n’aime pas la vidéo. Ça s’efface. C’est peut être idiot mais, même pour le montage, je préfère rester en pellicule plutôt que de monter en virtuel, comme on le fait de plus en plus. C’est parfois un peu fastidieux, mais j’aime ce côté artisanal. Le cinéma, c’est la mémoire, tandis que la vidéo, c’est l’effacement. La télévision, ça sert à faire le vide. C’est une machine à écerveler, à effacer la mémoire par couches superposées : chaque image y recouvre la précédente en un flot ininterrompu. Il faudrait arrêter ça… Quand il m’arrive de faire un film directement pour la télé, comme Un animal, des animaux, mon approche ne change pas. Je ne vais pas me mettre à faire des plans plus serrés. Je crois que mes films sont atypiques à la télé, parce que très silencieux, en plans larges… La télé a horreur du vide et du silence. Elle est plus proche de la radio que du cinéma. Il ne faut jamais que ça s’arrête, ça doit parler tout le temps. D’ailleurs, la radio crée plus d’images que la télé. Au moins, elle laisse une place à l’imaginaire.
Dans le domaine du documentaire, même si vous n’êtes pas attaché à cette désignation, se pose le problème de trouver les moyens de faire du cinéma en dehors des lois de la télévision. Vous avez la chance que vos films soient faits comme des films de cinéma, Pensez vous que cette façon de produire des documentaires soit menacée?
Depuis quelques années, on assiste en effet à un retour des films documentaires en salles. A côté de Marcel Ophuls et Depardon, il y a Robert Kramer, Claire Simon, Denis Gheerbrant, et maintenant Hervé Le Roux… Au total, une dizaine de films par an. Est ce que ça va continuer? Je le souhaite ardemment, mais ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Pour la plupart des décideurs, le documentaire doit rester un genre télévisuel, ce n’est pas du cinéma, puisqu’il n’y a pas d’acteurs. C’est nul ! Prenez Coûte que Coûte : c’est l’un des plus beaux films à suspense que j’ai vus ces dernières années ! Ce qui est frappant, c’est que du côté de la fiction, il y a tout un courant qui se rapproche du cinéma documentaire. Regardez La Promesse, ou ce que fait aujourd’hui Alain Cavalier… Le cinéma qui m’intéresse le plus travaille souvent sur ces zones frontalières entre fiction et documentaire.
Avez vous déjà imaginé poursuivre votre démarche par le biais de la fiction, avec des acteurs et des personnages inventés?
Ça me tente parfois, et ça me fait peur. Je crois que si je me retrouvais avec un scénario dialogué entre les mains, je serais un peu bloqué. Ou je deviendrais aveugle ! Je crois que je suis un peu comme le coucou, cet oiseau qui vient pondre ses oeufs dans d’autres nids que le sien et les fait couver par d’autres oiseaux. J’ai besoin des autres pour parler de moi même. Il faut que je m’empare de leurs histoires pour raconter un peu des miennes. Je ne sais pas si je pourrais le faire de manière frontale.
Votre film a t il été montré à La Borde?
Avant le mixage, j’ai montré le film à Jean Oury et quelques soignants pour m’assurer qu’il n’y avait pas des scènes qui pourraient se retourner violemment contre tel ou tel patient. Oury m’a tranquillisé. On a organisé deux projections à Blois, la ville la plus proche, pour les pensionnaires, leurs familles, les soignants. Passées les dix premières minutes, où les gens étaient tout à la découverte de se voir sur l’écran et de se reconnaître les uns les autres, ils sont vraiment entrés dans le film et m’ont donné l’impression de le voir dans son entité. Ils ne se sont pas arrêtés à leur propre image. A l’issue de la projection, Hervé était là, dans son coin. Je suis allé le voir, et je ai lui demandé ce que ça lui avait fait de se voir sur l’écran. Il m’a répondu que ce n’était pas ce qui l’avait le plus frappé, parce qu’il s’était déjà vu dans un miroir. Je lui ai donc demandé ce qui l’avait le plus frappé. II m’a dit : « Dans le film, il y a de l’échange ». « Entre quoi et quoi ? », ai je demandé. « Entre la souffrance et les moments de gaieté ».
Télérama n° 2460 - 5 mars 1997
Télérama : Vous connaissiez la clinique de La Borde avant d’y aller réaliser votre film ?
Nicolas Philibert : Je la connaissais de nom, on en avait beaucoup parlé dans les années 70. Des amis m’ont suggéré d’y aller voir. Mais j’ai mis huit à neuf mois avant de franchir le pas. J’avais peur de me confronter au monde de la folie, d’y laisser des plumes. J’avais surtout peur de troubler la tranquillité d’un lieu que son fondateur, Jean Oury, a défini comme un asile, au sens premier du mot : un abri contre le danger.
Quelle a été votre première impression ?
J’ai été frappé par le respect et l’accueil des gens et, aussi bizarre que cela puisse paraître, par l’atmosphère de liberté. On a vraiment le sentiment d’être dans un lieu de tolérance. Sans murs et sans blouses blanches. Les « fous », eux mêmes, sont tolérants vis à vis des autres.
Vous avez décidé aussitôt de faire le film ?
Non, pas tout de suite. J’y suis retourné cinq ou six fois. J’avais encore des réticences. J’en ai parlé. Les pensionnaires me disaient: Ce n’est pas parce qu’on est “fous” qu’on va faire n’importe quoi. On est fous, mais on n’est pas idiots ». Cela me confrontait à mes propres préjugés, et, finalement, j’ai eu envie de faire le film à partir de ça.
Vous privilégiez les répétitions de la pièce de théâtre de Gombrowicz. Pourquoi ?
Dans une simple chronique au quotidien, la caméra serait venue troubler une intimité. Là, ces gens participaient à une représentation théâtrale : c’est qu’ils voulaient bien se montrer. Un film devenait possible. On a commencé par filmer les répétitions, dans un coin du parc. Après seulement, on a élargi le champ d’action…
Quoi qu’il en soit, vous « volez » un peu de cette intimité ?
Oui, mais, en faisant du théâtre, les pensionnaires se trouvent dans un espace de travail et, donc, acquièrent une forme de dignité. Ils s’engagent, ils donnent quelque chose : la réplique, une gestuelle, le meilleur d’eux mêmes. Pour un temps, on partage ce même espace de travail : moi, je tourne, eux, répètent. Un lien se crée.
La folie incluse dans la pièce de Gombrowicz relativise la folie des pensionnaires.
Dans cette pièce, on découvre la part la plus pittoresque de la folie. Et, face au texte, beaucoup réagissent avec un certain humour, une ironie étonnante. Michel, par exemple, manifeste une grande lucidité quand il dit : « J’aime surtout le troisième acte parce que les réparties sont complètement déboussolées, ça me console ! » Peut être qu’avec une autre pièce le film aurait eu une tonalité différente.
Vous demandiez à chacun s’il voulait être filmé ?
N.P. : Très vite, il a été admis qu’on serait tous les jours aux répétitions. Le sachant, les pensionnaires venaient ou non, selon leur forme, leur envie, leur peur du moment… Pour les scènes d’intérieur, on indiquait sur la « feuille de jour » de La Borde où tournerait l’équipe ciné le lendemain. Chacun pouvait donc éviter l’endroit s’il le souhaitait.
Y a t il eu des refus ?
N.P. : Oui, mais la plupart des pensionnaires m’ont fait comprendre que cela ne les dérangeait pas. En fait, cela se décidait au jour le jour. Il y avait ceux qui, le lendemain, regrettaient : il fallait leur parler… Et puis d’autres qui ont mis longtemps avant de se décider. Je me souviens en particulier d’une jeune femme qui faisait des détours incroyablement longs dans le parc pour nous éviter. J’ai été la voir pour la rassurer, lui donner ma parole que je ne la filmerais pas. Petit à petit, elle a osé s’approcher. Et le dernier jour de tournage, elle est venue, droit dans l’axe de la caméra. J’ai aussitôt coupé. On s’est regardés. In extremis, elle voulait être filmée pour une déclaration. Elle s’est assise dans l’herbe et a commencé à parler. C’était très émouvant.
Dans le film, vous ne présentez personne. Il n’y a aucun commentaire, ni sur le lieu ni sur ses habitants..
C’est un parti pris que j’avais déjà dans mes précédents films. J’essaie de raconter une histoire avec des personnages auxquels je m’attache. Chaque fois qu’on investit un lieu, on découvre des hommes et des femmes, fous ou non, qu’on a envie de filmer plus que d’autres. Mon propos n’était surtout pas de présenter des « échantillons » de pathologie. J’ai choisi les personnages de manière intuitive, en fonction des liens qui se sont créés.
Faute de repères, le spectateur risque d’être parfois perdu. Il arrive même qu’on confonde soignants et pensionnaires…
Cette incertitude peut dérouter, en effet, mais c’est un risque que j’ai pris délibérément. Quand la souffrance de l’autre est désignée, elle a quelque chose de rassurant pour soi même : on se dit qu’on n’est pas comme ça. S’il y a doute, cela signifie que la frontière est parfois fragile ; que chacun de nous peut basculer. Cela veut dire aussi qu’il y a de l’étranger en chacun de nous.
Cependant, vous ne défendez aucune thèse dans votre film.
Non, il n’y a pas de théorie. Et j’ai tenté d’éviter aussi bien la pitié que la glorification des fous. Si à La Borde des pensionnaires sont d’anciens soignants et des soignants, d’anciens pensionnaires, si on a parfois une impression de frontière floue, cela ne veut pas dire, cependant, qu’il n’existe aucune différence entre les fous et nous. La différence est bien réelle. Aujourd’hui, un certain discours consiste à nier les différences ou, au contraire, à les idéaliser. Pour cette raison, je n’aime pas beaucoup Le Huitième Jour (1). Quand Pascal Duquenne dit sa douleur de ne pas être comme tout le monde, Auteuil lui répond : « Non, tu n’es pas comme les autres, tu es mieux que nous. » Sous-entendu : les trisomiques sont dans la pureté ou la vérité. C’est inacceptable.
On voit certains personnages évoluer au cours du film.
Oui, Hervé, par exemple, celui qui est sur l’affiche. Au début du film, il paraît très lointain, sur une autre planète. Il s’exprime par onomatopées ou par borborygmes. Et, peu à peu, il se fait happer par le spectacle des répétitions. Sa première parole articulée vient au bout d’une heure de film. Tout d’un coup, il se tourne vers moi et demande : « C’est du noir et blanc ou de la couleur? » Jusque là, le spectateur pouvait se demander s’il était capable de parler.
Avec Claude, autre « personnage » fort, l’approche paraît très difficile…
Au début, je ne savais même pas s’il avait conscience que je tournais un film. Et puis, un jour, il s’est approché de moi avec une extrême lenteur, s’est arrêté et m’a dit : « C’est de la Kodak ? » J’étais bouleversé : c’était la première fois qu’il s’adressait à moi de manière cohérente. J’ai eu alors envie d’en faire un des personnages centraux.
On peut vous reprocher de montrer une réalité sans crises graves, en somme, d’idéaliser un peu la vie à La Borde.
La violence ne se traduit pas toujours par des grands gestes ou des hurlements. Elle est contenue, certainement, par les médicaments et aussi par la présence de la caméra. Mais elle est perceptible. Je ne voulais pas ériger la souffrance en spectacle. Je ne suis pas rentré dans les chambres, je n’ai pas enregistré les cris, je n’ai pas filmé de crise. C’était un principe éthique, si l’on veut : si je l’avais fait, j’aurais détruit la confiance qui m’était accordée.
Mais cette réserve, cette pudeur peuvent apparaître comme une forme de neutralité un peu « lâche »…
J’avais certainement envie que le film dégage une impression de gaieté. Pour autant, je n’ai rien occulté. La violence se perçoit sur des choses très ténues. Ce n’est pas un hasard si le film s’appelle La Moindre des choses. La scène où Claude se fait couper la barbe ou celle avec la pensionnaire en train de dessiner sont pleines de mille détails, avec des moments d’apaisement, de violence saugrenue puis, de nouveau d’accalmie…
La fin du tournage a dû être douloureuse pour tout le monde. Comment l’avez vous vécue ?
Il était convenu de ne pas arrêter brutalement. On est restés encore une semaine, après la représentation. Je suis revenu pour préparer les gens à recevoir le film, à accepter la dure loi du montage. J’y suis retourné ensuite pour l’affiche. On en a parlé ensemble et j’ai gardé certaines idées : par exemple, les contours flous autour du personnage. Un pensionnaire m’avait suggéré d’écrire, en guise de slogan : « On n’est pas fous, on est flous. » Et un autre a renchéri : « On est tous un peu flous…»
Les pensionnaires ont vu le film. Comment avez vous analysé leurs réactions ?
Ils ont regardé le film sans plus ni moins de narcissisme que n’importe qui. Ils m’ont dit des choses très belles. Ils m’ont aussi offert un cahier où chacun avait écrit quelque chose. Les premiers mots sont : « Pour toi, Nicolas, de la part de ceux qui sont un peu trop fous, vers ceux qui ne le sont pas assez. »
(1) Film de Jaco Van Dormaël, avec Daniel Auteuil et Pascal Duquenne qui ont obtenu le prix d’interprétation ex aequo au dernier festival de Cannes.
(2) Télérama n° 2448 du 11 décembre 1996.
Les Cahiers du Cinéma n° 511 - Marzo 1997
Lo de menos. Un prado a la orilla de un bosque. Están ahí, salvajes y como ausentes de todo, zombis bajo un sol de justicia, inmortalizados en la luz aplastante de una especie de terrible eternidad. Es así como los descubrimos y así les dejaremos, con esta imagen, a los locos. Entre tanto, habrá habido una película, como un paréntesis, abierto y cerrado sobre esta certeza: la locura, ese bloque de tiempo, de luz petrificada y cegadora, está ahí donde no se puede entrar, con la intención (malsana) de ver a qué se parece o con la esperanza (generosa) de suavizar el dolor. Es un peso que no podemos llevar por los que lo soportan. O estamos fuera o estamos dentro. Pero, abrir un paréntesis en esta certeza, es lo de menos. Para Nicolas Philibert, Lo de menos es, por tanto, un carril de vía estrecha. En un primer momento, rechazado por la locura, que le devuelve su carácter infilmable en forma de cliché a la vez impresionante, paralizante y desesperante (los zombis), el cineasta hace frente a esta imposibilidad, no trata de salvarla filmando, por ejemplo, el marco de la locura. La clínica de La Borde, en donde se ha rodado Lo de menos, es, sin embargo, el lugar en donde la cuestión de los cuidados psiquiátricos encuentra diferentes respuestas, más allá de los clichés precisamente, y abandera ideas que sería apasionante ver en la práctica. Las veremos, de hecho, pero fuera de contexto, casi fuera de campo, sin comentario y sin que el “seguimiento de los pacientes” juegue un papel eje en la mirada. Lo de menos empieza, por tanto, ahí donde el cine ha perdido sus marcas y ya no puede caminar siguiendo sus propias huellas: ni documental sobre la locura, ni documental sobre la institución psiquiátrica, la película tiene que encontrar otra razón de ser frente a los que han perdido la razón. Magnífico proyecto, modesto y ambicioso a la vez, y que se desarrollará así, con una humildad que marca la más alta aspiración y con fe en esta humanidad cuyo cine puede revelar la belleza.
En La Borde, Nicolas Philibert abre un espacio posible para la película, centrándose en una cosa sencilla que, tocada por la mirada, se convierte en una hermosa victoria: la presencia. La presencia, es lo que escapa a la locura, y la locura está ahí donde se escapa la presencia de los internos de La Borde, ahí en donde se pierden sin previo aviso. Poco les importa entonces que les filmen en este exilio que imaginamos como un abismo de angustia y desolación, ya no están allí. Nicolas Philibert combate esta indiferencia, esta impasibilidad, porque pone, en el gesto de filmar, más que cualquier otro cineasta quizá; es precisamente la voluntad lo que importa, de ambos lados de la cámara, eso es lo que da presencia. Lo de menos, guiado por esta exigencia mínima y esencial, sigue el movimiento continuo, cada vez más amplio y extremadamente hermoso, de una victoria ganada, instante por instante, a la ausencia, a este haberse ido de la locura. Cada rostro mirado aparece cada vez más habitado, cada persona que surge ante nosotros lo hace en un momento dado frente a sí misma. Toda la película narra este advenimiento de la presencia, como una historia que se escribe con pena, con felicidad. Del hombre barbudo con el pelo de punta, nos preguntaremos hasta el final si estaba o no estaba presente, si estaba encerrado en sí mismo por mal humor crónico, o si seguía encerrado fuera de sí mismo por el dolor. La escena en la que le recortan la barba aporta una intensidad terrible a este enigma: Philibert capta el momento en el que la máscara del hombre está a punto de caer, en donde se va a descubrir quién es realmente, pero este momento es fugitivo o fugaz, inescrutable. Y cuando un chico joven, al que siempre hemos visto lejos de todo y de todos, se vuelve de repente hacia la cámara y le pregunta a Philibert si está rodando en blanco y negro o en color, vuelve a caer la máscara de la locura, por un momento sólo. Este espacio, que la película abre una y otra vez; este momento, que hace durar cada vez más, hasta recibir la realidad de vuelta, a través de las palabras de Michel: le dice «flota un poco» (pero que no tenga miedo porque “en La Borde, estamos entre nosotros y tú estás entre nosotros ahora.” En esta estrecha vereda, Lo de menos trabaja la mirada en profundidad para revelar, entre la locura, protegida de ella, el lugar ocupado por esta presencia compartida “entre nosotros”.
(…)
Lo que más desconcierta, continuamente, en Lo de menos, es la sensación de que los habitantes de este mundo de la locura no tienen nada, ni puntos de referencia que les pertenezcan (la «estructura» de La Borde les proporciona algunos), ni refugios propios (salvo el mismo para todos, esta “estructura”), ni bienes (tan poco centrados en la idea de la propiedad, desposeídos de sí mismos), ni nada. Por este motivo, oyendo sus propias palabras, la película se niega a ejercer su poder: se pertenecen a sí mismos, nunca se ven acuciados por preguntas, nunca se ven atrapados en la lógica de una investigación, nunca se ven forzados a una confesión, nunca obligados a hacer cosas con sentido o invitados a no hacerlas (la película nunca está al acecho de ninguna «poesía del lenguaje», por mínima que sea, de los «iluminados»). Las palabras son suyas y ellos son ellos mismos. Cuando habla Michel, sus palabras le constituyen como persona, y otros, a su lado, no pueden decir tanto, pero cada vez, es bello, de una belleza primordial porque, una vez más, es la presencia de cada uno la que consigue afirmarse en sus palabras. Cuando Nicolas Philibert abre la comunicación durante el rodaje, siempre es para alcanzar esta presencia, tan voluble. Así, en esta extraordinaria escena en que trae al presente a la chica que, frente a él, se ha callado de repente, como atrapada por la locura familiar, trayéndola a sus propias palabras a través de las suyas. El dirigirse al otro, aquí, tiene vocación de dirección, de localización y de denominación posible. No estamos hablando de la vocación de un terapeuta que se expresa, sino de la de un cineasta cuyo proyecto es hacernos escuchar, de película en película, otro tipo de lenguaje. El de los signos en El País de los sordos, el de las palabras arrancadas al silencio en este país de locos. La fuerza de Nicolas Philibert consiste en no creer que el documental necesita de la palabra (sobre todo de la buena palabra), sino que va hacia ella, hacia una palabra que no es la nuestra y que dice lo que no sabemos ver.
Por una milagrosa casualidad, en la que hay que reconocer la necesidad que lleva a que se cumplan los deseos más fuertes, Nicolas Philibert encuentra en La Borde su propio proyecto de cine a pie de obra. Ese verano, en el parque de la clínica, como cada año, se está montando una obra de teatro, Opereta de Witold Gombrowicz, una maravillosa fantasía a la que todo el mundo está invitado a participar. Nicolas Philibert, al filmar los ensayos y una parte de la representación, se ha encontrado en pleno corazón de este trabajo de la representación, que es siempre el reto de su quehacer de cineasta. Apropiarse de un texto, articular sus palabras, estar atento a la réplica, sincronizar los gestos con el ritmo de la música para golpear un tamboril, todo lleva, en ese esfuerzo colectivo, a la inscripción de cada uno en el presente, al dominio del momento en el que, como se dice en el teatro, le toca entrar a uno. Lo más hermoso es que esta presencia, que aleja el espectro de la locura hasta el punto de que muchas veces no se distinguen los pacientes del personal sanitario, todavía se puede jugar con ella, arriesgarla a esta libertad de la imaginación en la que se une con el otro, el personaje de ficción como el que disfruta del espectáculo. Nicolas Philibert lo filma como un placer vital, yendo más allá de la medida del beneficio terapéutico: Lo de menos también es un día de fiesta y de alegría, poblado de figuras que tienen el poder de ser burlescas sin reírnos de ellas, porque en la risa la mirada de Philibert retrata al hombre y no a la singular extrañeza de la locura. La obra de Gombrowicz le ayuda mucho – «muy adaptada a La Borde o, si no, muy bien traducida”, como dice Michel. Este texto de espíritu casi surrealista, el cineasta no lo utiliza, sin embargo, como un pretexto para la extravagancia, para el delirio tranquilizador (por marcado como literario, cultural), sino como un eco de su propia investigación del mundo, que hace resonar en el plano del castillo de La Borde esta frase de Opereta que parece la fórmula mágica de todas sus películas: “Cuando las cosas humanas se sienten prisioneras de las palabras, el lenguaje estalla”. Lo de menos viene detrás de esta explosión y da la medida para la recomposición de la verdad humana a la que apela. Lo más bello que se ha ofrecido al cine desde hace mucho tiempo.
Le Monde - 5 mars 1997
Dans une allée ombragée, une femme chante: « J’ai perdu mon Eurydice, rien n’égale mon malheur. » Au plan suivant, un fou passe, profilant dans le champ une étrangeté plus radicale encore. Mais où se trouve t on ? Au théâtre de verdure ? A l’asile psychiatrique ? En tout cas, au début d’un film qui, à défaut de donner d’emblée la réponse, se livre à un insolite et passionnant travail de familiarisation. Entre ce lieu et ces gens, entre les personnages et la caméra, entre le spectacle et le spectateur.
De fait, on se trouve à la clinique psychiatrique de La Borde, durant l’été 1995. Mais le film se défie des évidences, il procède d’une manière plus suggestive, sur un thème, la folie, auquel le cinéma documentaire s’est diversement confronté, depuis Regard sur la folie (1961) de Mario Ruspoli jusqu’à Histoires autour de la folie (1993) de Paule Muxel et Bertrand de Solliers, en passant par Titicut Follies (1966) de Frederick Wiseman. Il n’y a aucune trace du mot « folie » dans La Moindre des choses. Comme si, justement, la moindre des choses consistait à ne pas faire un film « sur » la folie mais avec elle. Deux voies s’offrent dans ce cas : la verticale toujours un peu factice de l’abîme, ou l’horizontale de l’accompagnement, signe plus modeste mais plus honnête de reconnaissance.
Nicolas Philibert a choisi la seconde, et en privilégiant une approche singulière : la préparation d’une pièce de théâtre interprétée par les patients et les soignants. Parti pris de cinéaste qui, filmant les répétitions, les mises en place et la partition orchestrale, interroge la notion de représentation sans pour autant délaisser le quotidien, de la distribution de médicaments à la cuisine collective. Quelques personnages (de la pièce et du film) émergent ainsi dans des séquences inoubliables, marquées par l’humour lorsque Michel est au standard téléphonique, l’effroi lorsque Claude se fait tailler la barbe, ou la violence quand Sophie s’efforce de dessiner. Tout est filmé puis monté avec un sens accompli du rythme, de la composition des plans et des cadrages, de l’alternance des silences et du brouhaha, des gestes ébauchés et des regards caméra. Mais l’essentiel tient aux curieuses correspondances qu’on attribue au hasard et qui relèvent en vérité du génie de celui qui sait les percevoir et les relier. La première de ces correspondances concerne le choix de la pièce adoptée cette année là à La Borde: Opérette (1966), de Witold Gombrowicz, est fondée sur le grotesque et le délire d’un monde qui court à sa propre perte. Ce texte suscite chez Michel, qui y incarne un des rôles principaux, ce jugement très sage : « Les réparties sont complètement déboussolées, ça me console. » Surtout, l’esthétique de Philibert peut se réclamer de celle de Gombrowicz, dans son refus des hautes formes de la culture et de l’art : « Pour moi, la “sous valeur”, l’“insuffisance”, le “sous développement” sont plus proches de l’homme que toutes les valeurs », notait l’écrivain polonais dans la préface de La Pornographie.
La seconde correspondance concerne le rapport conjugué que cette pièce « déjantée » et le film qui l’utilise intelligemment comme principal ressort dramatique entretiennent avec La Borde. II ne s’agit, ni plus ni moins, sous les oripeaux du dérisoire et les masques du théâtre, que d’une relation de profonde vérité. Celle d’un lieu où l’on accorde valeur aux désirs de chacun, refuge à la souffrance et liberté au vagabondage. Par mille et un détours, ce n’est pas le moindre mérite de La Moindre des choses de l’avoir suggéré.
Libération - 5 mars 1997
Après Le Pays des sourds et le monde des animaux empaillés, c’est le pays des fous que Nicolas Philibert est allé arpenter. Plus précisément, accompagné d’une équipe technique ultralégère de quatre personnes en tout, il est allé partager la vie des pensionnaires et du personnel soignant de la fameuse clinique psychiatrique de La Borde, nichée dans les bois des environs de Blois. Là, comme c’est la tradition, le petit peuple de La Borde prépare chaque été une pièce de théâtre, dont une représentation est proposée le15 août.
L’été dernier, c’était Opérette de Witold Gombrowicz, et c’est donc aux répétitions préparations de cette pièce, troublante par les résonances particulières qu’elle offre avec l’univers de la folie, que le cinéaste assiste.
Parmi la myriade de problèmes particuliers qui concernent la représentation de la folie, il en est un dont le film de Nicolas Philibert témoigne souverainement et qui concerne le regard toujours un peu malaisé, malhabile, gêné ou dégoûté que l’on porte sur elle, quelle que soit la bonté de nos intentions. C’est que dans l’esprit des gens «normaux» la folie a toujours à voir avec une certaine laideur, parce qu’elle s’accompagne souvent d’une distorsion du corps et d’une déformation des traits. Si La Moindre des choses n’avait qu’une seule qualité, ce serait celle là : le film interroge durablement notre rapport à cette laideur spécifique, et, dans la durée installée avec patience parle cinéaste, surgit progressivement une grâce folle, pour le coup, où la laideur devient une éloquence supérieure, qui nous transmet des vérités à la fois terribles et terriblement belles. Bien sûr, cette question de la « laideur », sensible dans à peu près toutes les représentations de la folie depuis au moins Jérôme Bosch et sa Nef des fous, ne concerne qu’assez peu les fous eux mêmes. C’est au contraire typiquement le problème de celui qui regarde la folie. Mais dans la mesure où le cinéma est précisément affaire de regard, c’est à cette aune là que l’on peut considérer la qualité morale du cinéaste et de son film : lorsque La Moindre des choses s’achève, les catégories du beau et du laid sont renvoyées à leur superficialité impatiente et les fous de Philibert sont devenus les magnifiques personnages d’une superbe aventure artistique. En ce sens, La Moindre des choses est à rapprocher de Tango, le très beau film des Bruxellois Frans Buyens et Lydia Chagoll, documentaire personnel et singulier qui montrait la préparation d’un spectacle par une troupe de jeunes trisomiques belges, mais auquel aucun distributeur français ne s’est encore intéressé.
À bien des égards, tout le charme de La Moindre des choses repose ainsi sur les curieux allers-retours d’une identification malmenée, sur la façon dont nous nous sentons tour à tour proches et lointains de ces fous, sur l’absurdité hilare qui ne manque pas de jaillir à la faveur de répliques inoubliables (et le simple fait de finalement oser rire là où, au départ, on aurait jugé déplacé de le faire est une des victoires incontestables de Philibert) : « Rappelez dans une demi heure, explique un pensionnaire improvisé standardiste à son interlocuteur, c’est à dire que vous appelez une deuxième fois dans la moitié d’une heure. » L’émotion ou l’inquiétude ne sont pourtant jamais loin derrière le rire, par exemple lorsque fuse un « conseil » dement : « Ne parlez jamais de votre santé à un médecin, il pourrait vous asservir », ou lorsque, parfaitement lucide sur le chemin mental et affectif que nous venons de parcourir, un pensionnaire vient, en fin de film, s’adresser à la caméra: « Ici, on est protégé par l’extérieur. On est entre nous. Et vous êtes entre nous aussi maintenant. » C’est exactement ça.
Télérama - 5 mars 1997
Ses bras invoquent le ciel, puis se ferment autour de son corps comme une camisole volontaire. A pleins poumons, Violaine respire l’air le plus pur de la campagne, pour expirer l’air d’opéra le plus désespéré: « J’ai perdu mon Eurydice… Quel tourment déchire mon coeur ! » Son chant glace le sang. Soudain, Violaine sort du champ de la caméra et laisse sa voix déchirée envahir l’écran, avec les arbres pour seul auditoire. Puis elle revient dans le cadre, pour hurler a capella les derniers mots de sa complainte : « Ma douleur… », comme si Gluck l’avait composée pour elle…
Abrupte et mystérieuse, cette première séquence de La Moindre des choses résume à merveille la méthode Philibert. Règle n°1 : ne jamais suivre du regard celui qui refuse d’être vu. Règle n° 2 : débusquer l’essentiel qui se cache toujours derrière l’insignifiant. Depuis ses débuts, le documentariste se glisse patiemment dans des mondes très fermés. Pas pour les dynamiter de l’intérieur. Simplement pour changer le regard extérieur. Cette fois, il a poussé la grille de la clinique de La Borde, un établissement psychiatrique pas comme les autres, qui aurait aussi pu s’appeler le Château du fou au bois dormant. C’est un castel féerique perdu dans un parc arboré, où les malades viennent se mettre à l’abri d’un monde réel devenu trop anxiogène. Ils ne végètent pas, ils poussent librement, à leur rythme et en tous sens. Les soignants ne portent pas de blouses blanches, et les portes ont des poignées des deux côtés. En jargon médical, on nomme cela « psychothérapie institutionnelle ». Jean Oury, le psychiatre qui dirige La Borde depuis sa création en 1953, a trouvé une expression plus humble. Il préfère parler de la moindre des choses.
Nicolas Philibert a pris l’expression au pied de la lettre. Il n’a pas voulu filmer le folklore de la folie, avec ses crises de démence et ses larmes d’angoisse. De son vol au dessus d’un nid de coucou, il n’a rapporté aucun cliché spectaculaire. Il a eu raison. La moindre des choses, l’infiniment petit, en disent aussi très long sur ces humains à la dérive : une boutade, un geste, un soupir.
Pour observer ces trois fois rien en toute discrétion, Nicolas Philibert a profité de l’effervescence d’une répétition théâtrale. Chaque année, le 15 août, les pensionnaires de La Borde jouent une pièce dans le parc du château. L’été dernier, ils ont monté Opérette, de Witold Gombrowicz, fantaisie grinçante et joyeusement foutraque. Pour obtenir ce résultat échevelé, il a fallu canaliser les énergies contradictoires, et souvent invisibles de chaque patient. Energies qui, subrepticement, ont fini par nourrir le documentaire de Nicolas Philibert, véritable miroir de cerveaux en désordre. « Je n’ai aucun air en tête ! », se plaint un sosie du général de Gaulle à qui l’on demande de chanter ce qui lui vient à l’esprit. Qui sait si ce grand barbichu au regard noir avait déjà exposé le malheur de sa vie à travers une phrase aussi limpide ? Et cette jeune fille qui dessine le visage d’une malade et finit par lâcher, dans un moment de panique, « J’ai peur de rater… » Elle s’apprête à dire autre chose, mais s’interrompt en plein élan, le souffle coupé par un bouleversant rictus de souffrance. Comme si l’ampleur de sa confession spontanée venait d’accéder à sa conscience… Il y a encore cet adolescent aux cheveux roux qui mastique une madeleine pendant que tous chantent en choeur autour de lui. Les yeux mi clos comme un nourrisson encore méfiant du monde, il semble refuser de sortir de sa coquille. Pourtant, écoutez bien le refrain que les autres ont entonné : « On lèche, on lape, on suce, on salive, à coups de langue, à coups de langue… » Et si, tout simplement, la dégustation bruyante d’une pâtisserie restait pour lui l’interprétation la plus juste de cette chanson gourmande ?
En permanence, Nicolas Philibert nous force à fouiner au delà de l’apparence des visages comme de la nature. Car le cinéaste ne se contente pas de sonder les hommes. Il s’imprègne aussi de leur environnement, filmé sans eux, dans de longues séquences silencieuses. Respirations salutaires ou bouffées d’angoisse, ces plans d’arbres agités par le vent et la pluie rappellent que les malades de La Borde sont des êtres humains, habitants de la planète Terre. Leurs angoisses renvoient aux nôtres, comme dans une pièce de Samuel Beckett. La Moindre des choses a des allures d’En attendant Godot. Dans le jardin de La Borde, un patient hagard marche péniblement jusqu’à un arbrisseau, en se massant le front, comme pour calmer les pensées insoutenables qui cognent sous son crâne. Et l’on croit voir le personnage d’Estragon, qui souffre le martyre à cause de ses chaussures torture, sous un arbre esseulé.
Soignants ou malades, sains d’esprit ou psychotiques ? Devant la caméra égalitaire de Nicolas Philibert, les gens normaux ont parfois l’air bizarre. Prenez l’animatrice qui met en scène Opérette. Qu’est ce qu’il lui prend tout à coup de valser seule sur l’estrade, avec un danseur imaginaire?
Parmi tous les visages croisés à La Borde, Nicolas Philibert a trouvé un allié. Aussi lucide que lui sur cette maigre frontière qui sépare la folie de l’ordinaire. Il s’appelle Michel Parent et séjourne régulièrement à la clinique depuis 1969. Les tics nerveux, la révolte exténuée, la diction appliquée, le discours poétique : tout, chez lui, évoque Antonin Artaud. « Ne parlez jamais de votre santé à un médecin, parce qu’il pourrait vous asservir… », dit il au spectateur, le regard à la fois rieur et abyssal. En terminant son documentaire sur cette confession testament (1), Nicolas Philibert dénoue le dernier cordon de sécurité qui nous séparait des fous. On sort de son film avec cette étrange impression qu’Artaud décrit dans Le Pèse nerfs: « Une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité. »
(1) Michel Parent est décédé après le tournage.
- Février / mars 1997
Je vous le dis tout cru, je ne sais pas par quel bout prendre les choses : j’ai tourné 77 fois 7 fois ma plume dans mon encrier, et j’ai une trouille terrible de ne pas savoir vous dire la beauté de ce film capital, cette extraordinaire douceur, cette fantastique tolérance, cette façon de se glisser sans rien déranger dans les pas incertains de ces autres, fragiles, douloureux et beaux qui nous inquiètent un peu et pourtant nous ressemblent. Comment vous donner envie d’y venir… Plus un film vous touche, plus il vous semble essentiel, et plus il est difficile de l’aborder.
Comment avec mes mots minables vous dire ces moments d’état de grâce où le temps semble ne plus nous être compté, les frémissements longs des arbres filmés avant l’orage, cette respiration unique des choses, cette capacité à capter en tout visage ce qui le rend touchant, aimable et beau… Et puis il y a cette confiance entre ceux qui sont filmés et ceux qui filment, qui transparaît dans les moindres des mots, et nous rend les personnages si bons à regarder, nous communique le désir de les entendre :
« On est entre nous », dit l’un d’entre eux à la fin du film, parlant de cet endroit, et ajoute « et vous êtes entre nous, à present »… résumant ce sentiment de connivence qui nous est venu tout doucement. Le plan final est quasi le même que celui du début du film, mais notre regard a changé. C’est un drôle de cadeau, et Philibert un incroyable virtuose qui nous fait oublier qu’il y a pu avoir des contraintes techniques, une caméra… Croyez moi sur parole, nom d’une trottinette en bois! vous ne regretterez pas une seconde d’être venus goûter à La Moindre des choses.
C’est un drôle de château perdu au milieu des bois. Le film s’ouvre sur la déambulation d’hommes et de femmes de toute évidence profondément perturbés. Leur corps, leur visage, leur allure sont marqués par une longue histoire où la souffrance semble prendre une grande part. Nous sommes dans la Clinique Psychiatrique de La Borde. Mais attention, pas d’interprétation hâtive : ce film n’est pas un reportage sur les milieux psychiatriques, pas un reportage sur La Borde …. Les doigts jaunis par la nicotine des mégots épuisés jusqu’à se brûler la peau, la langue pâteuse, les impatiences musculaires… on a parfois le sentiment que chacun à perdu le goût du regard de l’autre, enfermé dans une indifférence douloureuse, comme si plus rien d’heureux ne pouvait leur redonner plaisir et envie de communiquer. Et pourtant, il émane comme une paix, une forme d’harmonie. Ce lieu est un refuge et les gens qui sont là souhaitent avant tout qu’on leur foute la paix. Personne ne les oblige à une quelconque rentabilité, pas de pression, seulement cette sensation d’une vigilance, d’une écoute respectueuse.
Une fête se prepare : tous les quinze août, les habitants de La Borde donnent un spectacle de théâtre. Cette année ce sera Opérette, une pièce de Witold Gombrowicz, pas de la tarte : un texte plein d’écueils, des chansons drôlement complexes… L’apprentissage du texte prend parfois l’allure d’un combat contre la fatigue, les neuroleptiques, une victoire remportée sur soi, sur ses angoisses, jour après jour, répétition après répétition. On se demande par quel miracle ils vont arriver au bout de ce travail qui est autant un jeu, un plaisir, qu’une lutte terrible. Le fond de l’air est doux… et chacun reprend goût au collectif en tentant de se réaccorder avec les autres jusque dans les gestes les plus simples. Dessiner, préparer les costumes, chanter. Parfois l’épuisement gagne, et on n’en revient pas qu’ils arrivent au bout. Chaque année, la représentation finale tient du miracle. « Le regard des autres peut vous écraser ou vous faire renaître », dit quelqu’un: il peut donner l’envie se surpasser, et cette année encore le miracle aura lieu.
La Moindre des choses n’est pas non plus un film sur une pièce de théâtre qui se monte: les repas, le ménage, les déambulations solitaires, les conversations…, chaque moment compte, et pour important qu’il soit, le spectacle n’est au fond qu’un fil conducteur, un prétexte qui nous aide à communiquer avec les habitants de La Borde, à nous glisser, sans brutalité dans leur quotidien. C’est comme un pont, une passerelle fragile jetée entre leur univers et nous mêmes, une façon de découvrir cet « autre » vulnérable qui nous ressemble et d’en être heureux.
Revue Synapse n° 135 - Avril 1997
Un orage d’été. De grands plans fixes, les peupliers se tordent sur le ciel. Un déluge de pluie. A l’abri du château, enfin, nous respirons. Nous sommes à l’asile, nous aussi. Dans ce lieu où les vagabonds de l’âme viennent se reposer. Un mois ou des années. Sans obligation de parole, sans avoir à choisir entre la société ou ses marges. Une croisée de chemins.
Nicolas Philibert a t il voulu ainsi suspendre un instant son film pour rappeler que la clinique de La Borde a été créée voici plus de quarante ans, pour redonner ses lettres de noblesse à ce vieux mot d’asile?
La pluie cesse. L’eau se glisse et s’écoule le long des gouttières disjointes et, de son improbable parcours, renaît un rythme, une musique. Et le film reprend, rythme lui même.
Le rythme est la sous jacence de la vie, sa condition même. La compagnie des fous nous repose car ils se tiennent là, dans cet espace temps un peu machinique, non humain. Ils nous protègent des embarras de la névrose, de ses bonnes intentions, de sa manie de tout expliquer. De la pédagogie.
Le film de Nicolas Philibert n’est pas bavard, il laisse naître un récit hasardeux, multiple, plus proche d’une musique que d’un discours.
Il a pour sujet entre autres l’apparition comme prouesse. Les gens qui y apparaissent ont pour la plupart quelque chose de particulier, de rare, par les temps qui courent. Leur Moi n’insiste pas. Il passe. Il passe même à travers l’écran. Nous voici donc, et peut être pour la première fois, devant un film projeté sur écran poreux, écran traversé par la fugacité même, celle des voix, des regards, des gestes, de la vie humaine dans toute sa fragilité et sa dignité. Les fous sont des gens pour qui l’humour est chose sérieuse, on ne s’étonnera donc pas qu’ils aient été à la hauteur de leur tâche.
Filmer la folie dans l’intimité de sa vie quotidienne, Nicolas Philibert s’y refusa d’emblée et ce fut aux fous de l’apprivoiser. Cela leur prit des mois. Heureusement, comme chaque année, ils montaient une pièce de théâtre pour l’été : Opérette de Gombrowicz, un texte exubérant, exigeant de nombreux comédiens, des costumes baroques, de la musique. Un texte plus fou que tous les fous. Les cinq semaines de répétitions permettaient de ne filmer que ceux qui avaient choisi librement de se donner « en spectacle ». La partie musicale restait à inventer. Nicolas Philibert fit venir André Giroud, son copain compositeur et accordéoniste. Ils s’installèrent sur les pelouses de La Borde pour travailler les textes, les percussions, le chant, la guitare, la danse. Et c’est de ce bonheur labeur quotidien avec les fous que le film est né. Il nous emporte au rythme des répétitions de théâtre jusqu’à la représentation ; finale, magnifique désastre sauvé des eaux par la grâce.
Le théâtre constitue une aventure collective extraordinaire que le texte de Gombrowicz pousse à ses extrêmes.
Il permet de prendre appui sur les mots, de toucher le sol, mais surtout, il autorise toutes les fantaisies, les lignes de fuites, les dérives. C’est dans ce double mouvement que le film aussi s’engage. Une course maîtrisée.
Le travail quotidien sur le texte ou la musique, assure une dignité à chacun. Les plus indifférents s’approchent peu à peu de ce lieu de désir à l’état naissant. Ils prennent un instrument ou rejoignent les choeurs. Et nous, du fond de nos fauteuils, nous prenons parti, nous sommes transformés en supporters : « Comment vont-ils s’en tirer le jour de la représentation ? ». C’est sur ce fond que surgissent Michel, Philippe, Sophie et les autres. Ils ne sont tout d’abord que des silhouettes, des vieux fous traînant dans les allées. Puis, ces clichés s’effacent pour laisser place à des singularités vives, radicales, à une humanité quasi insupportable dans son extrême justesse.
Pour ceux qui, comme moi, ont travaillé à La Borde, il est difficile d’admettre qu’en moins de deux heures, un film puisse capter ce que des années de vie, des nuits de rêves, ont tissé d’irréversible entre ces fous et nous, eux qui nous habitent comme nous les habitons, dans le hors temps.
Pour tenter d’élucider ce miracle, j’avancerai deux suppositions :
Première supposition. L’alchimie s’est produite grâce à la rencontre d’exigences professionnelles poussées à l’extrême, celles de Nicolas et André d’une part, et celle de La Borde d’autre part. La Borde est sans doute l’endroit où l’on travaille le plus, fou ou pas, le jour ou la nuit, en dormant debout. Tout y passe : l’analyse collective ou individuelle, la théorie ou l’ouverture sur le monde, l’accueil de l’insolite ou l’effet des médicaments. Et surtout, cette manière d’être, ce mélange d’humour et de tendresse : l’amitié.
Seconde supposition. Nicolas Philibert est profondément joyeux. Il n’a pas le culte de la souffrance. Son film éclate de gaieté. A La Borde, on n’est pas non plus très judéo chrétien. La souffrance, on s’en méfie comme de la peste car, comme elle, on la sait contagieuse. Les fous souffrent s’il n’existe aucun dispositif collectif d’accueil susceptible de les capter, d’engager leur créativité. Il s’agit d’inventer constamment, de prêter attention à tous les détails de la vie quotidienne. Chaque jour on fait ses gammes. On travaille l’art de faire ensemble le ménage, la vaisselle, l’infirmerie, le standard téléphonique, le repassage ou la musique. On se réunit à tout propos. Chacun doit décider, prendre des responsabilités, faire l’apprentissage progressif de la parole. Tout est toujours raté, toujours à recommencer. Alors, mieux vaut en rire. C’est comme un pli. Une manière d’être. La moindre des choses.
Revue Trafic n° 21 - Printemps 1997
Jacques le « banquier », à Nicolas Philibert : « Au revoir Nicolas, merci d’avoir pris notre mal en patience ».
Nicolas Philibert est arrivé à La Borde un soir d’hiver. Il avait apporté plusieurs télévisions (on dit des moniteurs, je crois), s’est affairé à les brancher, et il a projeté Le Pays des sourds. Façon de se présenter, la moindre des politesses, en somme.
On était beaucoup à s’être déplacés dans le froid, jusqu’à la salle culturelle, longue baraque à l’entrée du parc, pour voir un film qu’on disait beau. Nicolas se tenait devant nous, tranquille, répondant aux questions. Avec sa manière un peu sèche, sa droiture qui semble toujours, quand il répond, poser une question nouvelle.
Il n’a pas dit qu’il venait faire un film sur La Borde. Il ne le savait pas encore. C’est du moins ce qu’il croit. Je n’ai pas assisté à ses autres visites, où, dit il, plus il exprimait ses réticences, plus il rencontrait d’encouragements. Et avec une rationalité attendrissante, il insiste. « Et moins je… et plus ils… » Comme un chevalier avance dans une forêt moyenâgeuse où tout, même les arbres, l’attend.
L’été, il était là, dans la clairière où l’on répétait, comme chaque année, la pièce de théâtre. C’est comme si on ne l’avait pas entendu arriver. Avec deux garçons souples aux yeux fatigués qui tenaient de longues perches à partir des épaules sans jamais se prendre les pieds dans les racines, et une petite boudeuse dont le travail semblait être de diagnostiquer la lumière avant que les autres ne la recueillent dans leurs machines. Ils ressemblaient à des danseurs, dans l’enchaînement silencieux de leur fausse immobilité.
On ne pouvait longer la clairière sans s’arrêter.
J’y suis venue comme les autres. Il y avait le théâtre, la gaieté du théâtre, le corps bondissant de Marie, la petite femme dont la voix au bord de la cassure hurle chaque année des vérités aussi folles qu’indiscutables « Non, alors toi, Patrick, tu es général, tu as l’air hautain, désinvolte, attention à la marche, elle va exister, tu te diriges vers la princesse en chantant, pour l’instant. Quoi ? N’importe quoi, mais articule. – “Auprès de ma blonde”? Ça te regarde. » La chaleur était grande. Patrick était très pâle et disait : « Non, je vais me coucher », en passant la main sur son visage de cire.
La chaleur et les médicaments ? Régulièrement, il s’endormait, ou s’évanouissait, sur l’herbe. On le réveillait doucement. Il vacillait, tout rouge. Avec l’eau de la fontaine, il redevenait blanc. Un jour, il vacille sur son tabouret, je le rattrape : « La chaleur, Patrick », je murmure. « Non, Marie, la folie. Je suis fou, c’est cela qui me fatigue, les voix. » La petite femme continuait – folie hurlant plus fort qu’une autre, voix contre voix. « Tu viens de derrière les arbres, droit comme un général, attention à la marche, et tu t’inclines devant le prince et la princesse, dont tu baises la main. Elle est où, la princesse ? Là » et Marie indique un tronc d’arbre.
Le cinéma ? C’était une présence silencieuse, attirante. Les machines, à force de voisiner avec les arbres, étaient dépourvues de malignité. Il y avait aussi la séduction des corps, de ceux qui effaçaient en quelque sorte leur âme derrière elles ou derrière les arbres, on ne savait plus, la séduction pleine de ces corps d’une puissance innocente, animale. Monique, qui tournait autour de la clairière avec ses yeux de minéral astral, très inquiétants, et ses bouteilles de Coca Cola chaud auxquelles chacun de nous essayait d’échapper, regardant ces garçons me dit un jour : «Ils sont bien, ils ont effacé en eux les objets hétéroclites.»
Ils filmaient tout. C’était leur règle, une règle aussi légitime qu’un cérémonial, un rêve. Je pensais à Beckett disant : « J’aimerais qu’on me prête un théâtre, pendant un an, par exemple, avec ses habitants professionnels, techniciens, acteurs, je noterais ce qui arrive. »
Peu à peu les yeux des acteurs devenaient plus clairs. Comme si à ces machines non sélectives, patientes, tenues par des corps amicaux, ils pouvaient parler, comme ils n’avaient jamais pu le faire, au monde.
Comme si les machines finissaient par leur offrir la lumière, la ligne d’horizon du monde. Eux qui, dans ce gentil château, étaient dans le dehors du monde.
Michel Parent avance son doigt vers la caméra, l’écran, nous, comme je l’ai vu faire une seule fois, à Marguerite Duras, quand on lui demandait, à la télévision, si elle buvait encore. Elle a tendu son verre en direction de la caméra, a traversé l’écran, et dit : « Voyez vous même, c’est de l’eau, non ? »
Michel parle d’une voix lente, en perpétuelle recherche d’une articulation parfaite. Compte tenu des dents qui glissent un peu, de la pensivité, d’une essentielle courtoisie, c’est une voix éloignée d’elle même, dépourvue d’humeur, qui dit : « D’abord, c’est vous qui m’avez rendu malade. La société en général, je fais pas de cadeau, la société en général. Et maintenant je vais mieux, grâce à la société aussi, je vais mieux et… Oui, je voulais vous donner un conseil, si vous permettez ne parlez jamais de votre santé à un médecin, parce qu’il pourrait vous asservir. Je suis pas asservi ici, mais je suis offert aux médecins. Mon frère s’y prend différemment. Quand on lui parle de psychiatrie, il prend un prétexte et il va à la cave. Voilà ce que j’avais à dire… »
Oury, en l’entendant, a éclaté d’un rire magnifique. Il était d’accord, le grand psychiatre, avec le fou qui, depuis, est mort. D’ailleurs, souvent, lui même, Oury, donne l’impression, quand on l’interroge sur la psychiatrie, d’avoir envie de descendre à la cave.
Cet été là, Marie avait choisi une pièce de Gombrowicz qui n’avait été jouée qu’une fois. Nous, on serait la deuxième. Le thème, audacieux mais obscur, était la traversée de l’histoire depuis le temps vague des châteaux jusqu’à l’après guerre mondiale, sous l’angle de la mode vestimentaire. Un personnage, le maître de la mode, invité par des châtelains pour régler les détails d’un bal costumé, se voyait vite dépassé par les inventions atroces, en matière de mode, de l’Histoire.
Beaucoup d’entrées et de sorties de personnages multiples, ayant peu de choses à dire, quelquefois seulement des miaulements à pousser, mais à des moments d’une précision infernale.
Très vite, on comprenait pourquoi la pièce n’avait été jouée qu’une fois. Exemple: au début, trois personnages, un général en mauve, une marquise en mauve, et un petit banquier en habit noir, vont saluer le prince et la princesse qui donnent un bal dirigé par le maître de la mode.
Dix scènes plus tard, le général en uniforme déchiqueté de seconde classe de la dernière guerre, le banquier dépenaillé, la gueule recouverte d’un masque à gaz, et la marquise, dans le vague uniforme défraîchi d’une Waffen SS, courent dans tous les sens pour essayer d’échapper à la sévérité de l’Histoire. Le maître de la mode, les découvrant, est hagard. D’autant que Patrick, le général, habitué aux grands rôles, continue à gueuler : « A l’assaut! », que la remplaçante de la marquise, moi, vêtue d’un vague tablier d’école gris, ne trouvant pas la motte de terre prévue pour se cacher, hurle : « Heil Hitler » au maître de mode épouvanté. Une musique est là pour soutenir les enchaînements difficiles. Mais le musicien, André, a composé une musique si belle, si savante, qu’il faut arriver à passer d’un demi ton à l’autre dans les passages les moins articulés, ce qui amène à modifier légèrement le texte. Exemple, André le musicien chantant :
« Djiaoui djiaou djiaou,outou voui voui voui, youyou you you, ah ah ah ah... »
Jacques, le banquier : « Pour obtenir ça, ça va pas être coton ! »
Marie D. : « On essaie. »
André : « Réessayez le. »
(Rires.)
Marie D. : « Il rajoute un «voui», et puis il rajoute un «you». »
Jacques, inquiet : « Ça fait trois «you» ? »
Marie D. : « Ça fait quatre «you» et trois «voui». »
Jacques : « Et des «djiaou», y en a deux ? »
André : « Oui! C’est comme ça. »
Jacques, très sombre : « Outou… outou… voui… voui… ? »
André : « Outou voui voui voui. »
Marie D. : «Il rajoute un «voui». »
Jacques: « D’accord. »
Marie D. : « Et «you you you you» ? »
Jacques : « Il rajoute un «you» ? »
Marie D. : « Il rajoute un «you». »
André : « Oui ! »
C’est comme cela que j’ai commencé à aider. On était bien, dans la clairière, le musicien était doux, la musique difficile. On a toujours un prétexte pour aider, à La Borde.
Le 15 août, jour de la représentation, on est venu me dire que la vraie marquise ne voulait pas jouer, qu’elle avait peur des marches, de se faire mal. Je hurlai: « Non ! » Mais elle fut inflexible; elle était une extraordinaire marquise, née pour ce rôle, elle faisait des Pfuit pfuit, en agitant ses mains fines, d’une grâce méchante que j’étais incapable d’imiter. Mais à La Borde, quand on joue à aider, il faut savoir, à certaines heures, s’exécuter.
Le lendemain de la représentation, j’étais inquiète pour la marquise. Après deux mois de labeur, d’une telle grâce, deux mois où elle avait assis son corps élégant et un peu cassé sur des troncs d’arbres durs dans une chaleur équatoriale, être privée de son rôle. Je lui offris un verre de grenadine. Elle me sourit très gentiment et dit : « Je suis navrée, Marie, de ne pas avoir pu t’aider, hier, mais j’étais assise trop loin de la scène. »
Peu à peu la musique gagnait du terrain, se glissait dans la salle à manger, dans les infirmeries, le soir, donnant une forme, une aimantation, aux heures. « Ah, ah, ah, ah, quel bal, ce bal, ah, ah, ah, ah, ça c’est un bal ! » Une ritournelle, aurait dit Félix, qui n’était plus là pour le dire.
Son obstination à lui, à varier d’un demi ton, pendant des années, avec son complice Oury, les musiques fragiles, monotones, de la vie à La Borde, avait permis le bal.
Il faisait très chaud. On fondait ensemble, en direction les uns des autres. Les répétitions exténuantes s’étiraient dans la clairière. On partageait l’épuisement, les douleurs dorsales, la soif. Quelle chierie, ce texte !
On attendait la pause goûter. Un jour, comme on était serrés tous, à faire la queue devant le bar, la petite preneuse de lumière, de moins en moins boudeuse, demande à Ginette, la princesse, qui, en dépit de sa maigreur aristocratique, ne plaisante jamais avec les choses matérielles : « T’as ton numéro? »
On riait, et puis on repartait « Galopons, galopons, éperonnons, cravachons, du galop dans la tête. »
Les gens vont demander à Nicolas :« Mais le théâtre, c’est thérapeutique ? » Il va avoir un moment difficile. Qu’il songe à ce que Michel dit du temps, dans la pièce… Il le dit de sa voix appliquée, lente, hésitante, un peu distraite, comme s’il luttait avec la difficulté extrême de penser : « Le fond de l’air est frais… mais le soleil n’est pas tellement.., chose, enfin pas trop…, pas trop chose machin chouette, le soleil… »
Le fond de l’air est thérapeutique, à La Borde, mais le théâtre n’est pas tellement chose, enfin pas trop, pas seulement thérapeutique, le théâtre…
Le film commence avant les répétitions, dans les allées du parc. Il continue après. On suit la promenade, le mot est un peu trop joli, le déplacement de quelques uns, leurs corps ralentis, exposés, parce que pas du tout tenus par le sentiment d’être vus. Nicolas a pris le temps de cette lenteur, de cette raideur qui donne envie de cogner sur les membres, pour les assouplir.
Claude traîne les pieds, poussés l’un devant l’autre par un mauvais ressort. Il a si peu de direction, d’orientation vitale, qu’on a peur qu’il ne rentre dans les buissons. Le pantalon pend, la braguette est ouverte (tant de mains, à travers les années, l’ont reboutonnée).
Son corps est, comme on le dit de certains pays, en temps de guerre, occupé : par les voix, qui vident la tête et crucifient les oreilles, par des questions dont la boucle s’est défaite, dans le désert. Est ce que je suis né, est ce que tu es fils de roi?
Un après midi d’orage, il est assis sur un banc et lève ses yeux vers le ciel plombé. « Ils habitent où, les aveugles ? » Et il s’énerve : « Oui, ils habitent où, les aveugles ? » Ne pas s’extasier devant une phrase de fou. « Quand la pensée quitte son intériorité bavarde pour devenir énergie matérielle, souffrance de la chair »(1), se taire. La question magnifique, lourde, monte vers un ciel occupé à préparer son orage et retombe sur le corps plié.
Le silence du film laisse à la question toute sa place dans l’indifférence du monde.
Un mot, pourtant. Une telle phrase est un cadeau qu’on prend, le gardant par-devers soi pour les temps difficiles. Par exemple, quand on assiste à la rencontre d’un aveugle et d’un vrai fou (si les vrais fous, comme ne cesse de le marmonner Oury, sont tous ceux qui s’identifient à leur fonction, il y en a beaucoup), un professeur, par exemple, qui se prend pour un professeur et note le devoir d’une étudiante aveugle : « Il lui manque un point pour avoir la moyenne, à celle là : refusée. » « Oui, mais elle a dix huit ans et elle est aveugle », on hurle. Il n’y a pas autre chose à faire que hurler. Mais on peut, ensuite, se bercer avec la phrase de Claude : « Ils habitent où, les aveugles ? »
La veille de la fete, Jean Claude est assis sur un des trois bancs de la pelouse, à côté de moi. Il n’est jamais venu aux répétitions, sauf une fois où le musicien imitait le tonnerre. Il est vite reparti.
« Est ce que tu iras à la fête, Jean Claude ?
– Est ce que j’irai ? Pour aller à une fête, il faut être prêt, prêt à la fète. Oui, peut être j’irai. Mais regarde moi, habillé comme ça, regarde moi, Marie. J’ai déjà du mal avec les interfêtes, beaucoup de mal. J’essaie d’être prêt pour les interfêtes. La fête…», et il fait des gestes élégants avec les bras, s’incline. « Messieurs Dames, c’est la fête. Est ce qu’ils y pensent, aux interfêtes ? Les gens y vont comme des cons, sans savoir quoi faire, de la fête. Je suis fatigué. Toutes ces connasses, avec leurs gouttes. “Vous n’êtes pas venu me voir, Jean Claude, cet après midi.” Pour qu’elles me filent leurs gouttes. Connasses. Je vais voir Oury. Je vais le faire plus souvent. »
Partage des rôles, à La Borde. C’est Oury qui a ordonné les gouttes.
Mais il se tient à la lisière de la forêt, entre La Borde et l’horizon du monde, comme les caméras de Nicolas pour d’autres, c’est sa place.
Nicolas a pensé aux interfêtes, peut être même n’a t il pensé qu’à cela. Il a laissé se refaire l’immobilité.
À la fin, Claude marche sur la pelouse devant le château, dans la lumière un peu trop claire d’une fin d’après midi d’été. Il s’arrête. Manifestement, il voit l’herbe, il a comme une idée, le frôlement d’une idée, humaine, de s’y asseoir, de s’allonger. Il plie le buste lentement, étend les mains en avant, et reste là, plié, sans pouvoir toucher l’herbe.
(1) Michel Foucault, La pensée du dehors, 1966, in Dits et écrits, t. I, GalIimard, 1994, p. 522.
Libération - 13 avril 1998
Quel rapport entre les fous de Nicolas Philibert, les voitures de Jacques Tati, les costumes d’Orson Welles, les poses de John Huston, les mimiques de Sacha Guitry? En tout, cinq films à la thématique commune pour une semaine qui sera ici consacrée au corps et à ses déguisements. La Moindre des choses, on s’en souvient peut-être, est un voyage extraordinaire au pays des fous, là où les frontières sont les plus indécises, les plus floues. D’ordinaire, pour s’attirer les faveurs du public, les cinéastes choisissent de l’effrayer et de le rassurer dans un seul et même mouvement. C’est que le quidam n’aime rien tant que les clichés quand il s’agit des fous. Hirsute, hagard, dangereux, le fou effraye et séduit. Plus il effraye, plus il séduit. Nicolas Philibert, lui, n’étiquette pas ses fous. Il fait même mieux. A La Borde, la clinique fondée par Oury et Guattari, il choisit de suivre un groupe de fous et d’infirmiers qui répètent une pièce musicale de Gombrowicz, Opérette, sans songer un instant à filmer différemment les soignés et les soignants. Il en résulte une étonnante confusion des sentiments, un alignement hétérogène des émois, une mémoire immédiate de ce qui résiste à la normalisation des images, à des années lumière de l’abjection de Vol au dessus d’un nid de coucou et autres reportages complaisants au pays des aliénés.
Un dernier mot. On raconte ici et là que La Moindre des choses est un documentaire. N’en croyez rien. C’est une répétition d’acteurs filmée par Ingmar Bergman, un ballet perdu de Vincente Minnelli, un mélodrame inachevé de Douglas Sirk, une épure. On s’y murmure les plus belles histoires d’amour, celles que les non dupes n’entendront jamais. Loin du maniérisme ambiant qui triomphe à Hollywood et à Paris, il est question ici de mise en scène et de cinéma. Les amateurs de John Ford apprécieront. Les fans de Tarantino seront en manque. Les films qui divisent ont de l’avenir. Au royaume des fous, ceux qui chantent faux font les plus beaux crooners.
Revue Images documentaires n° 45/46 - Automne 2002
* Texte paru aussi dans « Nicolas Philibert, les films, le cinéma » (ouvrage publié sous la direction de Luciano Barisone et Carlo Chatrian à l’occasion d’une rétrospective N. Philibert à Alba (Italie) – Infinity Festival – mars/avril 2003, et dans « Voir et Pouvoir », de J.L. Comolli (Editions Verdier, 2004).
Au second semestre 2000, un séminaire dont le motif était le « corps filmé » s’est tenu aux Ateliers Varan. Pour la première séance de ce cycle, j’avais choisi de montrer « La Moindre des choses », de Nicolas Philibert (1994) (1). Les notes qui suivent sont la retranscription, relue, réécrite et quelquefois augmentée, de cette séance. (2)
Ce film pose la question du corps filmé dans toute son étrangeté : nous, spectateurs de ce film, nous sommes confrontés à la question du corps de l’autre — qui est aussi la question de l’altérité de tout corps.
Pour moi, ce film est tout entier dans l’affirmation que la question fondamentale du cinéma est bien celle de la relation entre corps filmé et machine filmante. Comment analyser ce qui se passe entre le ou les corps filmé(s), le ou les corps filmant(s), le corps du spectateur, et le dispositif machinique qui les relie les uns aux autres, qui les relie à travers lui — et seulement à travers lui ? Qu’en est-il des relations entre ce qui est d’un côté (corps filmants) et de l’autre côté de la machine (corps filmés) — le corps du spectateur se trouvant en quelque sorte des deux côtés à la fois, successivement ou en même temps, selon la loi obscure d’un désir d’ubiquité… d’un désir de se diviser ou de se couper — appelons cela : projection — qui, pour impossible et irrationnel qu’il puisse paraître, est la condition même de participation à la scène, à la représentation ? Qu’en est-il en somme de cette place impossible du spectateur quand, sur la scène, aucun corps représenté n’est tout à fait à la place que la société (ou l’idéologie, le système de croyances, les normes médiatiques, etc.) lui assigne ?
Je désigne ici un triangle : corps filmé/corps filmant/corps spectateur. Le film de Philibert construit et reconstruit sans cesse l’équilibre de ces trois pôles. Je dis « reconstruire » ou « construire », ce qui suppose que ce triangle est détruit ou déconstruit en permanence, que cette triple polarité est menacée de réduction ou de simplification, que le système même du spectacle tend à protéger le spectateur, à lui donner une « bonne place » depuis laquelle il pourrait considérer les heurs et malheurs de l’autre filmé, les avatars ou les tourments du corps filmé de l’autre en toute quiétude et en toute maîtrise. Telle est la place que le système de la visibilité sociale — la généralisation du Panoptique de Bentham relu par Foucault (3) — nous attribue : une bien illusoire place de maître : le spectacle déroule pour nous ses splendeurs ou ses horreurs et nous n’avons plus qu’à en savourer le goût. Et le spectacle de la folie de l’autre ne ferait lui non plus pas exception : l’autre filmé serait bien du côté des aliénés, le spectateur lui ne le serait pas…
La mise en scène de Philibert, dans la confrontation répétée qu’elle organise des regards regardants et des regards regardés, par le passage qu’elle inscrit de la place de spectateur à celle d’acteur, de celle de sujet de l’institution à celle de performer de la représentation, nous interdit de nous considérer, nous, spectateurs du film, comme protégés dans l’ombre de la salle : nous sommes littéralement pris à partie, pris comme partie par les pensionnaires de la clinique de La Borde qui sont aussi les acteurs de la pièce de Gombrowicz (4) et les personnages du film de Philibert. Nous ne pouvons jamais oublier que c’est nous qui sommes en train de voir et qu’ainsi il s’agit avant tout de notre regard. Notre regard en tant qu’il est l’écho ou la surface de rebond du regard de l’autre.
À la différence de beaucoup d’autres films sur la folie (5), ce film nous montre des malades relativement tranquilles, même si l’intensité de leur souffrance ne fait pas de doute ; on est dans une clinique qui est à la pointe de la recherche en psychiatrie et d’autre part les cas lourds ne sont pas là, ou en tout cas ne sont pas filmés, ou en tout cas ne sont pas filmés comme tels : s’ils sont là, ils restent hors champ ; ou s’ils sont quelque part dans le champ, on ne les distingue pas, rien n’est fait pour les désigner. Ainsi, tous ceux qui sont filmés — et quel que soit le « degré » de leur égarement — d’une manière ou d’une autre nous interpellent, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas absents du geste même de filmer, qu’ils en sont partie prenante, qu’ils le savent d’un savoir peut-être non toujours ou non absolument conscient mais tout à fait certain (quelque chose qui renverrait à l’« auto-mise en scène » (6). C’est le principe du film. Ils interpellent celui qui les filme, ne serait-ce que par un regard angoissé, une attente du corps crispé, un silence soudain ; c’est par exemple, au début du film, cette mobilisation intense montrée par la femme qui arrive dans le cadre pour chanter Eurydice — appelons ça un « effet de présence », effet qui ne peut se percevoir, je crois, que comme une demande à nous adressée, à la machine adressée, à Philibert, d’être là avec elle, de ne pas la laisser seule, d’être avec elle dans le miroir. Les sujets filmés nous montrent qu’ils ont besoin d’impliquer celui qui les filme — qui n’est en somme qu’un éclaireur, à l’avant poste, sinon à l’avant garde de celui qui les regarde ; c’est comme un échange de bons procédés : je vous filme, c’est que vous existez pour moi, pour nous ; si vous me filmez, c’est que j’existe pour vous… Une circulation se fait entre ces trois pôles qui constituent la relation cinématographique. Ainsi, et cela n’est pas sans conséquences y compris dans la sphère des idées, les questions de l’altérité et de l’aliénation sont réouvertes, laissées béantes, non résolues, posées et reposées sans cesse (ce sont en effet des questions qu’il convient d’activer, qui demandent un peu de travail pour demeurer actives) : il s’agit moins de savoir à qui nous avons à faire, que de ressentir que si nous avons à faire avec ce à qui c’est aussi en tant que nous-mêmes. Quel est notre rapport à nous-mêmes quand ce rapport est représenté, c’est-à-dire remédié, par la figure de l’aliéné ? Si l’autre filmé, celui qui se dit aliéné ou que l’institution soigne comme tel, est entré dans une relation avec nous, spectateurs, et qu’il nous propose en somme un dialogue des consciences, même altérées — la conscience de sa conscience de cette relation —, qu’il nous constitue ainsi comme interlocuteur, c’est que notre place est reliée à la sienne et que peut-être ces places sont interchangeables. Telle est la question qui anime le film de bout en bout. C’est la question même que pose la pratique de La Borde : que la frontière entre soignés et soignants, sans être abolie, apparaisse comme poreuse, avec l’espoir ou le désir planant dans les têtes des uns et des autres qu’elle soit réversible. Le cinéma serait radicalement égalitaire (Daney), au sens où il s’intéresse autant sinon plus aux faibles qu’aux forts, et que les corps filmés sont traités également par la machine. Cet égalitarisme ne l’est que d’exalter les particularités, les distinctions, les nuances, les miroitements infinis de l’altérité filmée — filmée, c’est-à-dire rapatriée, apprivoisée : l’autre absolu ne se laisse pas filmer. Telle est l’utopie cinématographique : en dépit de son altérité, l’autre s’est présenté dans une proximité, il est resté devant la machine, ou plutôt avec elle, et du coup résonne au cœur des particularités (morphologiques, psychologiques, culturelles, etc.) l’accord majeur de l’universalité. Philibert filme donc l’utopie même du cinéma ; mieux : il filme pour que renaisse cette utopie.
Il y a déjà dans l’entreprise de La Borde l’idée que la folie se traite aussi par la mise en question de l’institution qui traite la folie. Une mise en abyme des responsabilités et des places, dont l’enjeu est ce qu’on pourrait appeler le devenir-conscient. Ce processus dans lequel sont entrés les patients de La Borde est exactement celui auquel le film invite son spectateur. La dernière réplique (qui vous a fait réagir) est extrêmement forte : quand Michel, sublime réplique, dit « On est entre nous mais vous aussi vous êtes entre nous », c’est bien de l’« entre nous » de la séance cinématographique qu’il s’agit. Cet « entre nous » est celui auquel ouvre le cinéma, l’utopie à laquelle il donne réalité. « Entre nous » ce serait également la formule égalitaire du cinéma dont je parlais à l’instant, telle que l’accent se porte sur ce qui est commun (« nous ») et sur ce qui relie (« entre »). La machine cinématographique, la caméra précisément, effectue une sorte de mise à plat, de remise à zéro des corps filmés justement parce qu’elle enregistre et restitue toute leur singularité sans égale : la singularité de chaque corps est telle qu’elle ne peut renvoyer qu’à l’extrême de toute singularité : elle est ce que tous ont en partage, d’être — au cinéma — extrêmement singuliers. Le théâtre a créé et favorisé les types (la commedia dell’arte, Molière, le théâtre napolitain, Eduardo de Filippo, Totò, etc.). Le cinéma n’a jamais vraiment aimé les types, les caractères prédéterminés, les corps et les langages programmés comme des machines, il a aimé la distinction absolue de chaque corps, l’unique de chaque individu. Les caricatures dont sont si proches les types théâtraux ou les types publicitaires deviennent faibles au cinéma. Le grand acteur est avant tout unique. Charles Laughton, Gary Cooper, Cary Grant, James Stewart, Henry Fonda, Robert Mitchum ne sont jamais « typés », quoi que veuille leur costume ou leur personnage. En faisant en sorte que chaque distinction soit remarquable, le cinéma nous invite à n’opposer entre elles que des distinctions. Rien d’indistinct, rien qui ne soit appropriable. Les corps filmés certes s’opposent ou s’affrontent, mais toujours selon la loi cinématographique qui veut que ce soit entre eux et nous que cela se joue. La scène cinématographique plus encore que la scène théâtrale refoule tout « dehors », ou plutôt n’accepte ce qui n’est pas elle qu’en en faisant une part d’elle-même : par un tour supplémentaire de mise en abyme. Je pourrais dire que tout corps filmé accède à cette dimension d’une communauté cinématographique qui fait (Daney) que deux ennemis dans un duel se tuent, oui, en partageant le même cadre cinématographique. (Ou : comment filmer l’ennemi s’il n’est pas là, devant la caméra, et donc pas si « ennemi » que ça ?) Il faut ici entrer dans une logique du paradoxe. Plus la caméra singularise les corps filmés (A n’est pas B qui n’est pas C, etc.), plus elle invite à les accepter comme tels, plus il devient difficile de choisir les uns contre les autres. La pointe aiguë de la distinction entraîne une difficulté à choisir entre les distinctions. Cette difficulté à choisir clairement son camp (son ou ses corps) est constitutive de la scène cinématographique : le spectateur est des deux côtés, je l’ai dit, dans la salle et sur l’écran, il est lui-même corps imaginaire errant en projection parmi les corps filmés et projetés sur l’écran de la salle. Quelque chose de ce corps errant, flottant, s’accroche sans doute à chacun des corps filmés. Nicolas Philibert joue de ce retour de l’indistinction au sein de la distinction : tous les corps filmés dans La Moindre des choses sont remarquables et incomparables, et pourtant il m’est difficile, spectateur, de repérer facilement lequel est passé de l’autre côté, lequel est dans sa folie, et lequel ne l’est pas. Celui qui paraissait l’être ne l’est plus, le spectacle l’a changé (je pense à celui qui devient un exquis petit marquis). La désignation, l’indexation, le repérage (le « typage », si l’on veut) ne vont pas de soi : il y a là, par les moyens du plus simple cinéma, un démenti farouche apporté au dénigrement des corps opéré chaque jour dans les médias (télévisions mais aussi photos dans les magazines) où c’est toujours « l’identité » (au sens policier) qui gouverne l’image. (Heureusement, l’image qui n’est pas bonne fille résiste à ces mauvais traitements, il arrive même qu’elle se venge : je pense dans le film de Richard Dindo Che Guevara, journal de Bolivie, au moment où, dans une bande tournée par la police bolivienne ou la CIA, l’image du cadavre du Che assassiné se renverse, passant de la figure pitoyable du guérillero abattu à celle d’une sorte de Christ rayonnant et rédempteur…).
Pour le dire autrement, par moments les corps que l’on voit nous apparaissent comme disjoints de notre propre fonctionnement dans leur manière d’être, de parler, de bouger, de marcher… et à d’autres moments, non. Ils se sont mis à notre pas, à notre main, à notre portée. Cette bascule improbable et troublante est l’utopie que réalise l’opération cinématographique. Le cinéma permet de découvrir que les frontières, les barrières, les cases ne sont pas fermées à jamais, qu’entre elles il y a une circulation qui est réelle, et qui l’est, réelle, d’abord parce qu’elle nous implique dans son mouvement.
Le ressort de l’opération cinématographique est de mettre en question — en doute — notre capacité de voir et d’entendre : de nous ouvrir à une perception des êtres et des choses du monde que nous n’avons pas toujours dans la vie ordinaire, dans la mesure où notre perception est organisée, informée, déterminée en grande partie par les schèmes idéologiques qui circulent, et dans le cas précis par la manière dont chaque société traite ses « cas-limites ». Au cinéma, nous le savons, il n’y a pas de « cas-limite ». Ou alors, tout « cas » est « limite », ce qui revient au même. Il n’y a pas plus d’étrangeté à filmer celui qui sait que celui qui ne sait pas, celui qui erre que celui qui n’erre pas. Philibert filme chaque être et chaque chose comme non étrangère. Il est clair que le film que nous venons de voir aurait été impossible s’il y avait eu dans l’esprit de ceux qui l’ont fait un schéma quelconque de répression de « la folie », voire de méfiance à l’endroit d’une altérité problématique. Mais le cinéma lui-même, c’est ce que je tente de dire, n’est pas « répressif », il est même fait pour accueillir ce que les sociétés prétendent rejeter. C’est bien parce que ce schéma répressif a été évacué, c’est bien parce que l’appareil de savoir sur la psychiatrie ou sur la folie dont nous sommes plus ou moins les porteurs, si ce n’est les agents, a été mis de côté, c’est bien parce que ceux qui ont fait le film se sont débarrassés du bagage des préjugés et des idées reçues sur « la folie » qu’ils ont filmé les pensionnaires de La Borde comme des hommes parmi d’autres. Mais s’ils ont pu se décharger de tout cela, c’est que le cinéma leur dictait sa loi : les corps filmés, quelle que soit leur identité, leur pouvoir, leurs idées, leurs souffrances, sont d’abord des corps reliés à la machine par laquelle d’autres corps les filment en vue d’être confrontés, toujours par l’entremise de machines, aux corps spectateurs. On ne sort pas du cercle des corps.
Une remarque : le film nous pose constamment la question de savoir à quel moment celui ou celle qui est filmé est en train de le savoir ou pas. Et voilà qu’un regard, un mot, une pose nous font savoir qu’il le sait — lui aussi ; et s’il le sait « lui aussi », comment ne le saurions-nous pas, nous qui sommes censés savoir « nous aussi » ? La force du film tient au fait que, à un moment ou l’autre, et parfois au moment où on s’y attend le moins, chacun des personnages nous apparaît comme étant conscient de la situation dans laquelle il se trouve au moment même où il est filmé — où nous le voyons filmé —, et qu’il réagit à cette situation d’implication en l’avouant, en la désignant, en la commentant (« j’espère que le film est en noir et blanc », dit l’un des pensionnaires), qu’il assume donc la relation cinématographique dans laquelle il est engagé avec nous — en toute conscience. (Ce sont donc là des « acteurs » qui ne refoulent pas la dimension scénique de leur existence ; brechtiens sans le savoir, ils nous indiquent qu’ils ne « jouent pas le jeu » de la fiction puisqu’ils ont besoin de la fiction — de jouer — pour toucher et faire toucher quelque chose de leur réalité.)
Filmer, ainsi, revient à provoquer et relancer chez les personnes filmées le passage d’une certaine non-conscience à une certaine conscience. Il n’y a pour ainsi dire pas une seule scène du film sans un regard, un indice, un geste, un mot pour nous alerter sur le fait que ceux qui sont là filmés ne sont pas plus fous que nous tout simplement parce qu’ils savent que nous sommes là, spectateurs, à les regarder nous regarder. La « folie » du spectateur à regarder vaut peut-être celle qu’il y aurait à subir ce regard.
C’est aussi cela que je veux dire en parlant de la fonction égalitaire du cinéma : pas de division entre ceux qui seraient de l’autre côté, le mauvais, et ceux, nous, qui seraient du bon côté. Spectateurs, acteurs, les places s’échangent. Quand je suis acteur et que je te dis que je te regarde (« regard caméra », mais qui est aussi regard de spectateur), cela change ton regard sur moi puisque tu sais que je sais que tu es là. Les deux côtés de l’écran se mêlent : le regard se regarde (7).
La puissance, ou plutôt l’insistance insidieuse de cette opération de démonstration est accrue dans La Moindre des choses par le fait, bien évidemment, que les pensionnaires de La Borde répètent avant de la jouer sur scène une pièce de Witold Gombrowicz qui se nomme précisément « Comédie », pièce sur la dérive des sociétés hiérarchisées, la mise en miettes des ordres sociaux, la manière dont une société se montre satisfaite d’être grotesque et violente (c’est dans le texte « déjanté » de la pièce). Une société trouée et criblée par la désarticulation des paroles, la réduction du langage à une série de lieux communs boiteux et proverbes approximatifs. Les « personnages » de la pièce sont des sortes d’idiots, ici joués par des pensionnaires de La Borde qui, d’une certaine manière, sont plus doués qu’eux. La mise à mal des conventions sociales dans la pièce s’opère et se traduit par une égalisation des places, des rôles et des corps. Corps joué et corps jouant se valent probablement. Et même, au joueur revient le privilège de mettre à distance « son » personnage, qu’il le joue « bien » ou qu’il le joue « mal ».
Ainsi, les « personnages » de Gombrowicz n’ont ni plus ni moins de consistance que les acteurs de La Borde qui les jouent et qui sont les personnages du film de Philibert ; leur parole n’est ni plus ni moins sensée ; leur délire ni plus ni moins alarmant. Mais ce qu’ils n’ont pas et qu’ont ceux de La Borde, c’est — justement — l’expérience de la performance qu’il y a à jouer sur scène. C’est cet apprentissage que filme avant tout Philibert. Et sur ce terrain-là, nous, spectateurs, nous ne sommes au mieux qu’à égalité avec les personnages-acteurs : nous en savons aussi peu, nous serions aussi maladroits qu’eux, sans doute, et même pire, puisque que nous les voyons apprendre et comprendre, avancer malgré les ratés vers l’apothéose d’une représentation, c’est-à-dire vers ce qui nous est destiné. La structure du film suit l’ordre des répétitions, mais en même temps nous place dans un temps suspendu, qui ne passe pas vraiment, le temps laborieux et lent de l’apprentissage. Les personnages qui vont jouer cette pièce à la fois l’apprennent et la désapprennent. Il est difficile de les « évaluer » comme on ferait dans un cours de théâtre, en terme de « progrès ». Quoi que disent les techniciens qui les encadrent, subsiste pour nous spectateurs l’idée d’une imperfection, d’un manque irréparables. Le temps est suspendu, suspendu à la menace que tout craque (l’un des thèmes de la pièce). Nous sommes ainsi dans un système : 1/ dans la pièce, le monde ordonné craque de tous côtés ; 2/ La Borde comme scène est sans cesse au bord de la rupture ; et 3/ la loi du cinéma documentaire est qu’à chaque instant pèse la menace d’une interruption de la prise. Trois ensembles clos, phobiques et protecteurs (clinique, scène théâtrale, scène cinématographique) se superposent et s’ajoutent, intensification extrême de la clôture de toute scène, du principe d’exterritorialité de toute représentation. Nous savons pourtant que s’il faut cette coupure d’avec le monde pour rendre possible la représentation, le monde, refoulé un temps hors de la scène, ne cesse pas de faire pression sur elle et de la menacer de ses désordres (le théâtre peut brûler, l’acteur mourir en scène, etc.). La clôture de la scène ne se renforce ainsi qu’en renforçant la menace qui pèse sur elle. C’est exactement cela dont Michel est conscient. Que la scène est enchantée, que le monde ne l’est pas.
Ce qui permet à Philibert de mener cette opération de rééquilibrage, de remise en circulation des places, des rôles, des corps, des paroles, c’est bien le système de la mise en abyme (8) qui est porté ici au paroxysme. « Comédie » semble avoir été écrite pour La Borde et même pour Philibert. Il y a là une rencontre dont seul le cinéma documentaire détient le privilège : l’heureux du hasard. Le travail que le film fait accomplir à ses acteurs — manifester la conscience qu’ils ont d’être filmés — fait bien sûr écho au travail des répétitions qui conduisent vers la fête de la représentation. Le travail des corps passe par un texte extrêmement élaboré jusque dans sa dimension déglinguée. La mise en abyme est aussi une mise en forme. Ce qui est élaboré, c’est un délire supérieur, plus puissant que le délire des pensionnaires, c’est en somme un niveau supérieur de faiblesse capable d’absorber et de résoudre les faiblesses mêmes des acteurs. Ainsi, les pensionnaires de La Borde paraissent beaucoup plus « fous » quand ils jouent la pièce de Gombrowicz que quand ils ne la jouent pas. Étant plus agités, plus incohérents ou plus délirants quand ils sont dans le théâtre que quand ils n’y sont pas (n’étant alors « que » dans le film), ils nous alertent quant à la place critique du théâtre dans nos sociétés : mise en perspective et en relativité des maux et des stigmates sociaux. Il n’a pas seulement théâtre dans le cinéma, pièce dans le film : il y a mise en abyme réciproque de la « folie » et de la « normalité » : l’une ne va pas sans l’autre, l’une va « dans » l’autre, dans un jeu d’échos, de dédoublements, de renvois et de relances sans fin. (La mise en abyme implique une infinitude, une non-clôture). Au moment où nous pensons avoir atteint un sol plus stable, ce sol se dérobe ; ce qui était en train de se faire se défait.
Comme celui d’un tournage de film, comme celui d’une séance de cinéma, le temps de la scène est un temps suspendu. Le monde est mis entre parenthèses, et avec le monde, la « folie » elle-même qui est déjà une mise entre parenthèses du monde. Les boites dans les boites. La Borde apparaît comme un bout de la scène du monde. Là, le monde se fait scène, et ce faisant, s’évapore. Telle serait la jouissance du spectateur : d’assister à l’évaporation du monde dans le spectacle, à la réduction — magique — de tout ce qui est terrible ou menaçant aux dimensions du théâtre de marionnettes de La Tempête. Le temps suspendu de la représentation est aussi le temps de la répétition (ici, les répétitions, au sens propre, qui mènent à la représentation), ce serait aussi quelque chose qu’on imaginerait comme le temps de l’inconscient. Un temps bouclé, spiralé, du recommencement infini, du retour à l’origine indéfiniment bouclé sur lui-même : tel est en tout cas le temps proposé par la pièce de Gombrowicz, tout a déjà eu lieu, on est dans l’éternel défaire. Or, le temps d’un film diffère largement du temps suspendu du tournage. Qu’on le veuille et le sache ou non, le film est un fil qui se déroule linéairement dans le temps. Chaque photogramme ajoute 1/24e de seconde au précédent. Une consécution est en chemin. S’il y a récurrence (boucle) c’est que cette fraction de durée qui s’ajoute à elle-même vingt-quatre fois par seconde est aussi, si j’ose dire, un ajout d’oubli, un effacement. On le sait, au cinéma, inscription et effacement de l’inscription vont de pair. Chaque photogramme, donc, invisible en tant que tel, n’en efface pas moins sur l’écran celui qui le précède, comme il sera effacé par celui qui le suit. Le cinéma met l’oubli en acte, il en fait une puissance active, cet effacement est ce qui permet d’avancer, il est la condition de toute progression. Peut-être même cet acte d’effacement est-il ce qui permet d’entrer dans illusion d’une amélioration du monde — que le théâtre corrosif de Gombrowicz s’ingénie à annuler, et que le cinéma de Philibert s’emploie au contraire à sauver. Ceci revient à dire que la mise en abyme de ce théâtre-là dans ce cinéma-là s’effectue selon un principe de contradiction : la représentation de la pièce est à la fois — côté théâtre — destruction chaotique et ludique du monde ancien, et côté cinéma, construction d’une conscience de la crise chez les acteurs qui sont venus à la scène, c’est-à-dire construction d’une conscience aussi de leurs limites en tant qu’acteurs. C’est exactement en ce point que nous, spectateurs, sommes touchés. L’aliéné qui sait qu’il a encore beaucoup de travail et d’efforts à fournir pour « bien jouer » — jouer le jeu social — et qui nous le dit, nous dit du même coup que cette question est la nôtre : qu’en est-il de notre « jeu » sur la scène du monde ? Voilà qui nous remet à égalité avec ceux qu’on considère et qu’on nomme « fous ». Parce que comme eux nous sommes nous aussi dans le balbutiement, dans le langage bébé, dans le cri, dans la rengaine, la répétition, l’oubli, le geste manqué, et comme eux loin, par conséquent, de toute sorte de maîtrise. Ce que dit Michel dans son monologue final peut s’entendre comme la récusation de toute position de maîtrise chez ceux qui ne sont pas dans l’enclos de La Borde : quand il dit « Ne parlez jamais de votre santé à un médecin, il pourrait vous asservir », il s’agit bien de maîtrise et de la dénoncer comme dangereuse.
La beauté de ce film tient à ceci qu’il nous confronte à la récusation de toute maîtrise par ceux-là même qui ont le plus grand mal à maîtriser le monde et à « se » maîtriser eux-mêmes. La grande question du cinéma est sans doute de faire accepter à son spectateur qu’il puisse perdre quelque chose d’une illusion de maîtrise.
Le désir de maîtrise — désir d’une illusion — est aujourd’hui de plus en plus alimenté par les modes de domination dans lesquels nous sommes pris. L’art, le cinéma, ont entre autres effets celui de mettre en crise les fantasmes de maîtrise que la logique de la marchandise elle-même fait circuler entre nous. Nous interdisant toute conscience de la relativité de notre place parmi les autres, le fantasme de maîtrise nous prive de nous ouvrir à la pluralité des mondes, comme à la circulation et à l’échange des places et des rôles.
Revenons à la scène initiale du film, cette pensionnaire qui chante « J’ai perdu mon Eurydice… », en plan large dans un cadre fixe. A la fois elle ne sort pas du champ et menace d’en sortir. Ce corps s’expose, se donne à voir, à entendre, sans fard, sans abus. Aucune exhibition, mais une souffrance. Ce corps se reprend au moment même où il s’expose. Comment savoir s’il y a ou pas conscience chez cette femme d’être filmée, elle le sait, elle ne le sait pas, elle est dans cet entre-deux, nous ne le savons pas non plus, nous sommes dans cet entre-deux. Avoir conscience de la relation à la caméra et puis la perdre. De l’autre comme présent et puis le perdre. Il y a une angoisse, c’est une scène d’angoisse et de grâce à la fois, l’angoisse que ça s’arrête, que la chanteuse soit saisie par la caméra dans un trou, une panne, une rupture du jeu ; et en même temps, seconde après seconde, cette rupture menaçante n’a pas lieu, cette menace est levée, chaque seconde qui passe est une sorte de miracle et l’ensemble de ces petits miracles confère une véritable grâce à cette femme exposée au-delà d’elle-même : au film, à l’opération cinémato-graphique. Ce qui pourrait apparaître burlesque ou grotesque dans les trente premières secondes du plan finit par devenir extrêmement émouvant. L’objet du film est de montrer comment la folie et la grâce peuvent se rencontrer.
Ce n’est pas seulement au théâtre de La Borde que cela se passe, c’est dans les coulisses de la représentation que les personnages sont saisis par la grâce. La perte de maîtrise est la condition de la grâce. L’altérité se présente comme un devenir et non comme un donné. Il s’agit de devenir-autre. Dans la relation cinématographique qui m’inclut, spectateur, l’altérité sera ce à quoi je peux prétendre, elle sera à ma portée, elle sera ma prise, mais cette prise me dépassera et me débordera. Ce qu’éprouve le spectateur, son épreuve, c’est le débordement de ce qu’il est en mesure d’éprouver.
1/ Film que je montre chaque année aux étudiants du Département d’Études cinématographiques et audiovisuelles (ECAV) de Paris 8.
2/ Je remercie les Ateliers Varan qui ont accueilli ce séminaire, l’ont entouré de prévenances, en ont assuré l’enregistrement, et je remercie tout particulièrement celles et ceux de mes auditeurs qui en ont fait la transcription — tache ardue.
3/ Surveiller et Punir, op. cit.
4/ Tous les étés, les pensionnaires de La Borde donnent une représentation théâtrale. Cette année-là c’est Opérette de Witold Gombrowicz : Philibert en filme les répétitions puis le spectacle
5/ Je pense évidemment à Titicut Follies de Frédéric Wiseman et à San Clemente de Raymond Depardon, deux films qui, comme celui de Philibert, font partie de mon « répertoire » critique et qu’ainsi je confronte souvent les uns aux autres.
6/ Cf. « Lettre de Marseille sur l’auto mise en scène », in « La mise en scène documentaire », par Pierre Baudry et Gilles Delavaud, publication du Ministère de la Culture en association avec l’Éducation nationale (1994).
7/ Cf. « Le miroir à deux faces », in Arrêt sur histoire, Collection « Supplémentaires », BPI, Centre Pompidou, 1997.
8/ Qui était le motif principal du séminaire du premier semestre 1999-2000.
Intervention prononcée le 1er février 2003 au cours d’un colloque organisé par “Espace Analytique”
Introduire un commentaire et une discussion sur le film de Nicolas Philibert La Moindre des choses est une gageure. Nicolas est un cinéaste qui dans ses films raconte des histoires vraies Voyez Le Pays des sourds, La Ville Louvre, Un animal des animaux. Ce ne sont pas des documentaires, Il n’a pas un regard sur.., un point de vue de… il est là, il est accepté, il fait partie de l’expérience, simplement, il filme et en filmant, il saisit l’extraordinaire du réel lorsqu’on y prête attention. C’est ce que nous avons pu constater dans cette petite merveille récente Être et Avoir, le cours de l’année de la dernière classe de Mr Lopez, instituteur de Lozère, qui lui a valu succès et récompenses et qui lui en vaudra encore.
Pour ce film sur La Borde, antérieur de quelques années, il est resté un an aussi. Je ne le connaissais pas à l’époque. J’ai participé à l’expérience de La Borde à ses débuts, en 1955 et dès ce moment, j’ai commençé à m’intéresser à la psychothérapie institutionnelle. Depuis, j’ai travaillé ailleurs avec des patients psychotiques. Mais le lien avec La Borde est resté très vivant pour moi.
Ce qui est remarquable, à La Borde, c’est la constance des questions et des recherches, depuis tant d’années, qui peuvent se concrétiser dans les activités diverses du club de malades, l’activité théâtrale en étant un exemple, mais il y en a beaucoup d’autres. Ce qui m’a mobilisé pour parler à propos du film de Nicolas Philibert, c’est la démonstration de la constance des abords théoriques que l’école de psychothérapie institutionnelle propose, et en particulier un exemple saisissant de ce qu’on peut appeler « espace métonymique. »
Cette notion prend sa place dans le courant actuel parce que depuis quelque 50 ans la psychiatrie a pu renouveler ou réinventer des aspects de la clinique, qu’on va trouver développés dans des mises en forme théoriques diverses, des mouvements de pensée qui font retour.
Ces formes nouvelles n’ont parfois de nouveau que le fait qu’elles disparaissent et réapparaissent. La pratique de secteur par exemple, inventée par Conolly en Angleterre fin XIXe siècle réapparaît en Europe, grâce à Tosquelles en Espagne, puis en France et produit une résurgence moderne d’une forme de pensée psychiatrique, comme la psychothérapie institutionnelle. La thérapie institutionnelle requestionne ainsi maintenant, de façon assez récente le malaise produit par les nouvelles formes de prises en charge: secteur ou antipsychiatrie par exemple, elle même venue de loin. Mais on aurait tort d’y voir une mise en question de la psychiatrie. Comme le souligne Jean Oury dans son dialogue récent avec Marie Depussé dans leur ouvrage A quelle heure passe le train : la psychothérapie institutionnelle, c’est la psychiatrie. (1)
Cependant, ces différents mouvements se trouvent toujours coïncider avec l’expression de crises sociales dont elles en sont une expression. Actuellement, nous sommes face à une crise de l’économie libérale dont Christophe Dejours a dénoncé la perversion possible quant aux possibilités de maintien des structures psychiques du sujet et l’attaque des capacités symboliques de la pensée contemporaine. Pour le psychotique, la perversion sociale qui en résulte est meurtrière.
La crise de la société attaque donc les structures psychotiques qui sont elles mêmes déjà attaquées sans qu’il soit besoin de faire appel à la pression sociale. Celle ci va ajouter son poids à la paralysie que subit le patient psychotique. Le travail, soutient Christophe Dejours, est important dans la structuration dynamique du sujet, l’activité comme piège du désir est appréhendée comme point capital, d’où les positions institutionnelles déjà vieilles se basant sur l’importance du travail, de l’activité (Hermann Simon, pour ne pas le nommer), de la possiblité d’agir son désir. Mais qu’est ce que le « faire » pour un psychotique ?
Mais on peut prendre les dangers des changements sociaux pour un malade psychotique par un autre biais, celui de la construction de l’univers symbolique, contre les vents et les marées de la façon dont la culture peut ou non « bricoler » perversement les structures psychiques. Un des dénominateurs communs, de cette construction, depuis Mauss et l’essai sur le don, ce dénominateur commun c’est l’échange plutôt que l’interdit de l’inceste. Lorsque cet interdit n’a pas été inscrit, il ne peut être oublié, mis en arrière pour proposer un primat de l’échange, une ouverture vers ce qui fait le social, avoir des beaux frères pour chasser c’est à dire faire alliance. Et c’est cet effacement dont il est question dans la psychose. Ainsi le psychotique, loin et hors de lui même qui n’a pu inscrire les signifiants marquant l’opérativité de l’interdit de l’inceste en lui ne peut il rien « oublier », ni qu’il manque de l’espace pour lui d’un échange possible.
Accueil, ambiance, échange, termes princeps. Biens, femmes, paroles doivent s’échanger. Le psychotique ne peut échanger dans le registre des femmes, il en est loin, ni du côté des biens. Il n’en a pas parce qu’il s’en fout. Ce qu’il a , ce sont des « ostrakas », des restes de son histoire, ça n’a de valeur que pour lui. Il les garde, dans un tiroir, une valise, un sac en plastique voire une poche de sa veste déchirée. Il reste l’échange des paroles, le seul domaine ou l’on peut théoriquement avoir accès, mais pour cela, il faut dépasser le vide et tenir compte que si le psychotique ne parle pas, s’il ne peut échanger, c’est en raison du danger de la parole, arme meurtrière de l’autre.
Le psychotique est seul, n’ a pas d’autre, pas de partenaire, pas de « beau frère », pas même une image de lui même. Il ne peut participer à une activité qui implique une « participation » sociale quelle qu’elle soit. L’acte n’a pas de sens. Et pourtant, c’est par ce biais qu’on peut aborder un patient psychotique. On entend parfois qu’il faut des techniques d’accrochage. Par où accrocher un psychotique?
Sans doute par un petit bout de ce qu’on ne peut encore appeler un désir, mais une réponse à une demande qui n’est pas la réponse à une question formulée, mais une demande de prendre une place dans un espace de rencontre particulier que je vais vous présenter maintenant.
Dans la schizophrénie, c’est le lien de contiguïté, métonymique, qui manque, reprenait Oury, dans la préface de Figures du réel mon dernier travail. Le psychotique, c’est celui pour lequel ce lien est en défaut. Il lui manque l’espace du déplacement. Il a si peu d’espace intérieur disponible pour son être là qu’il lui en manque pour établir un échange. Et de ce manque d’échange, il en souffre même s’il se l’est constitué pour se protéger des échanges trop douloureux. C’est le paradoxe du sujet psychotique, souffrir du manque de ce qu’il ne peut supporter à aucun prix. Je veux dire que le prix est trop lourd à payer, et que le psychotique le payerait seul.
Cet espace d’échange que j’ai appelé espace métonymique, il doit être là pour que chaque sujet (petit sujet) fonctionne pour combler ce «vide» que le psychotique, mais pas seulement lui ressent en place de son sentiment d’existence.
Ce sentiment, on peut le décrire comme une sorte de «présence interne», non représentable, une perception incarnée au niveau du corps, du « là » du corps du « poids » qui donne du lest, du corporel orienté par l’histoire personnelle, poids dans l’existence intime et sans nécessité de la présentifier par la chaîne des associations possibles.
Le Vide, c’est cela en négatif, une perception due à la rupture des liens entre le code et les affects qui déclenchent habituellement le phénomène de pensée. Le « retrait » affectif entraîne cette coupure et le retrait de la pensée. Cette coupure avec le code est sûrement en relation avec ce sentiment de vide qui participe à la fois du vide affectif et du vide de pensée qui se résume au « rien », mot souvent usité pour décrire cette perception. Il n’y a rien, que de l’inexistence, de la massivité du corps là, dans l’absence de présence à l’autre qui fait naître une perception de « non présence » à soi, de massivité inhumaine et dépourvue de sens. Et les premiers mots qui traduisent ce rien sont aussi là pour évoquer l’incompréhension de l’absence de perception du temps.
Pour vivre avec la psychose, avec les fous de psychose, il faut le temps, le temps de voir, de ne pas comprendre, ne pas être pressé, laisser à l’autre le temps de se taire, de vous attendre ou de vous perdre, le temps de s’accrocher à un détail qui prend toute la place. Pour le cinéaste, Il faut laisser la caméra exister puis se faire oublier. Le « montage » se fait après (2) Pour le psychiatre, il faut surtout oublier d’être obsessionnel, une des pathologies rédhibitoire pour ce métier avec celle que stigmatise Oury dans son entretien avec Nicolas Philibert, la phobie.
Car le malheur dans la rencontre avec le psychotique, c’est une histoire de temps, de rythme. Le temps du monde dit normal devient de plus en plus un temps inhumain qu’on ne peut plus « prendre ». C’est le temps « utile ». Dans notre société libérale, le temps, c’est de l’argent.
Et comme dans les collectivités, il y a de moins en moins d’argent, il y a de moins en moins de temps à « passer » je ne dis pas perdre quoique ce soit parfois présenté comme celà, avec les psychotiques. Se promener avec eux, de leurs pas incertains et solitaires, s’ils vous acceptent, partager avec eux une création musicale. Trois doigts qui courent sur des touches d’accordéon. Trois paroles fondamentales dans une séquence infinie. C’est ça, le moment de la rencontre. Il faut le temps, il faut un espace dégagé, pour que ça bouge, que ça se meuve, qu’il y ait du mouvement, même infime, vers cette rencontre. C’est tout une autre logique, que Oury appelle « logique abductive ». Il disait que tout le film de Philibert est un exemple de cette logique de la rencontre.
Elle préside à ces rencontres qui ne peuvent se faire que sur le fond d’un autre regard sur l’arrière fond du travail, la veillance comme il dit, l’attention à la sous jacence, les entours, et surtout d’autres notions plus exactes à décrire la présence active et attentive des participants aux « soins » psychiatriques.
Le film de Nicolas nous en montre de nombreuses facettes. De même qu’il n’y a rien dans un espace vide de corps là où le sujet sait cependant qu’il existe, il n’y a plus de sentiment de temps orienté. Cette perception peut durer indéfiniment.
C’est pour faire du « lien », pour renouer les affects et des éléments de code venant de l’extérieur du sujet, pour saisir un transfert toujours perceptible que sont mises en place de nombreuses techniques d’approche des patients psychotiques. Pour recréer une zone de partage qui puisse attirer ceux ci sans danger vers leur reconstruction, sans que la demande de l’autre puisse être perçue comme menaçante. En même temps qu’une greffe d’affect, il faut que la demande vienne d’un tiers lieu qui peut alors demander sans risque, puisqu’il n’est pas besoin d’y répondre en direct. C’est le tiers qui demande, encore mieux si c’est un tiers non humain, donc moins dangereux, une institution, un mécanisme utilisé comme rouage de l’organisation. Un objet institutionnel qui fait appel. Une réunion où le sujet fait partie d’un groupe, le jardin, qui appelle à être arrosé, la grille qui demande des volontaires pour une tâche, un trou dans l’équipe de volley qui se montre, là, devant le patient qui regarde la partie, et qui demande à être comblé etc… Les exemples fourmillent dans une institution vraiment vivante.
Et La Borde en est une. Avoir pu créer un appel multiple comme la création de la pièce de Witold Gombrovicz a mis en scène doublement des appels aux liens très nombreux, avec des lieux multiples d’expression des demandes et l’initium, progressif, des investissements variés des participants. Pour avoir pu la filmer, il a fallu que le cinéaste soit lui-même doué de ce don qui permet d’être dans ce lieu, de pouvoir faire appel sans être dans la pression de la demande, lorsqu’elle est formulée par un discours rationnel. Il faut de l’à côté pour faire du lien, il faut la possibilité du glissement métonymique, il faut de l’allusif (3), du léger et de l’esquisse, comme le préconisent les japonais (4).
Ainsi dans l’expérience de la mise en scène de la pièce et le tournage du film de Nicolas Philibert, il y a du lien. Il y a du métonymique. Il n’y a même que cela. Par une dérivation de la demande de l’Autre, vécue comme dangereuse vers une demande qui va entraîner le sujet à se soumettre d’abord, et après réassurance à la pulsion « de base » la pulsion scopique. Il ne s’agit pas de la demande de l’Autre, ni de l’autre, (Lacan) la demande tout court, la demande d’ailleurs. Ça demande. C’est la pièce qui demande. Même pas les copains, le metteur en scène, les infirmiers, même si la formulation passe par eux. Non, la pièce est là, elle est en demande, d’acteurs, de metteurs en scène, de temps pour regarder, de temps pour comprendre comment cela s’installe, comment les uns se relationnent avec les autres, à travers cette création là, dont Nicolas est le témoin, le spectateur délicat, caméra à l’oeil, discrète, comme il filme toujours et comme on a pu le voir depuis sur les écrans.
Le « vide » des uns va se remplir du fait que des barrières vont se lever entre la pensée et le code. Certains éléments vont entraîner un investissement, non sur une personne, mais sur la chose, la pièce, le truc qui se passe là, mine de rien, et de fil en aiguille l’un va porter là l’accessoire dont l’autre a besoin et chanter à l’unisson d’un troisième au moment de l’entrée en scène d’un quatrième. Multiples contiguïtés qui vont donner de l’espace métonymique, cet espace de l’échange qui va pour un temps combler ce vide, après l’avoir enclos dans un praticable provisoire. Toutes ces contiguïtés, légères, ce sont plein de petites « moindre des choses », qui font l’épaisseur du tissu d’échange qu’on rencontre à La Borde, avec des uns et des autres rassemblés par le même souci. Mais que Nicolas a aussi filmé dans la classe de M. Lopez, c’est la même chose. C’est le soubassement de l’ambiance. A La Borde, c’est une attitude, une certitude d’être en contact avec des sujets, des individualités riches de surprise que sont les malades psychotiques qui permet cela.
En conclusion, je dirai que notre univers technocratique, hyperscientificisé voire déshumanisé par le mouvement de la pensée libérale menace de pénurie la psychiatrie du XXIe siècle, sous le fallacieux argument politique du manque de moyens ou de l’essor des sciences biologiques et du comportement
On comprendra grâce au travail et aux publications de psychiatres comme François Tosquelles ou Jean Oury et à des documents comme le film de Nicolas Philibert que ce sont les techniques institutionnelles, mettant en pratique le plus pointu de la recherche en psychanalyse sur les psychoses qui seront à même de privilégier le sujet, le respect de sa parole et de son désir pour que l’existence de son espace psychique par l’échange avec l’autre puisse être mis en place. Ceci est le soin psychiatrique par excellence parfaitement capté par la caméra de Nicolas Philibert.
Cette attention à l’autre, dans le respect de l’infime de sa manifestation, dans le plus anodin de La Moindre des choses, il faut s’y consacrer. Jean Oury, à qui on demandait s’il n’était pas dérangé d’être là depuis si longtemps avec les fous répondait : « Ce sont les gens qui me dérangent à venir là me poser des questions idiotes. C’est ça qui gêne. »
Et comme cette attention, essence du soin psychiatrique, c’est une attitude éthique et personnelle de chacun, ça ne s’énonce pas comme ça, plutôt comme « une obstination, un amour… qu’il faut oser dire. » dit Marie Depussé dans son dernier livre avec Jean Oury.
Et ça, ça ne coûte pas cher.
Et c’est aussi, pour un psychiatre digne de ce nom, « la moindre des choses. »
1 Jean Oury et Marie Depussé, A quelle heure passe le train, Conversations sur la folie, Calman Lévy, 2003.
2 Lorsque j’ai écrit ce texte, Nicolas n’avais pas encore eu le césar du montage pour Être et avoir.
3 François Jullien, « distance allusive », in Le détour et l’accès, stratégie du sens en Chine, en Grèce. cité par Catherine De Luca Bernier.
4 Catherine de Luca-Bernier, Japon et institutionnel, une question d’ambiance.