La vida cotidiana en una escuela de una sola aula en un pequeño pueblo.
Directores de fotografía Katell Djian / Laurent Didier • Cámara Nicolas Philibert, asistido por Hugues Géminiani • Sonido Julien Cloquet • Montaje Nicolas Philibert, assistido por Thaddée Bertrand • Música original Philippe Hersant • Dirección de producción Isabelle Pailley-Sandoz y Tatiana Bouchain • Productor delegado Gilles Sandoz • Productor asociado Serge Lalou • Una coproducción Maïa Films, Arte France Cinéma, les Films d’Ici, Centre National de Documentation Pédagogique • Con la participación de Canal +, Centre National de la Cinématographie, Gimages 4, y el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, del «Conseil Régional d’Auvergne» y de la Procirep.
Sélection officielle Cannes 2002, hors compétition • Prix Louis Delluc 2002 • Prix «Tiempo de Historia», Festival de Valladolid, 2002 • Grand-Prix du Festival France Cinéma, Florence, 2002 • « Best documentary » (Prix ARTE), European Film Awards, 2002 • Prix Humanum, décerné par la Presse Cinématographique de Belgique, 2002 • Prix Méliès « meilleur film français de l’année » décerné par le Syndicat français de la Critique de Cinéma, 2003 • Prix des auditeurs du Masque et la Plume, France Inter, janvier 2003 • Nominations aux Cesar 2003 : « Meilleur réalisateur », « Meilleur film » et « Meilleur montage » • Cesar 2003 du montage • Prix de l’Association Cubaine de la Presse Cinématographique (Fipresci), Festival du Cinéma français à Cuba, 2003 • Etoile d’Or décerné par la presse française • Prix du public au 4e Festival du film français à Athènes, 2003 • Grand-Prix et Prix du public au Festival du Film francophone de Bratislava (Slovaquie), 2003 • Grand Jury Prize for the Best Doc., Full Frame Film Festival, USA, 2003 • « Best non fiction film Award », National Society of Film Critics, USA • Nominé aux BBC World Cinema Awards, novembre 2003 • Nominé aux BAFTA (British Academy Film Awards) dans la catégorie « Best films not in the English language », Londres, 2004.
Distribución en Francia & Ventas internationales : Les Films du Losange
Estreno en cines franceses : 28 de agosto de 2002
À propos du film par Nicolas Philibert
* Texte destiné au dossier de presse, printemps 2002
Je voulais situer ce film dans une région de moyenne montagne, où le climat serait rude et l’hiver difficile. Avant de choisir cette école, j’en ai contacté plus de 300, et visité une bonne centaine. Il importait de trouver une classe comportant un effectif réduit (10 à 12 élèves), de sorte que chaque enfant soit identifiable et puisse devenir un « personnage ». Je souhaitais aussi que l’éventail d’âges y soit le plus large possible – de la maternelle au CM2 – pour le charme qui émanent de ces petites communautés hétérogènes, et pour le travail si particulier qu’elles exigent de la part des enseignants.
Dès le début de mes repérages – en juin 2000 – j’avais eu un premier coup de cœur, dans un petit village de l’Aveyron. Elle s’appelait Marie-Lou. C’était une institutrice d’une certaine expérience, et dans sa classe, il y avait quelque chose de magique. Malheureusement, elle devait avoir une vingtaine d’élèves, et ça faisait vraiment trop. Par la suite, il y a eu d’autres belles rencontres, mais il y avait souvent quelque chose qui clochait… Ici, on construisait un lotissement en face de l’école, c’était hyper bruyant. Là, l’espace de la classe était minuscule, on ne pouvait pas bouger ! Là encore, l’institutrice, enceinte, ne pourrait pas rester au-delà du mois de février…
Au début, je prospectais de façon un peu aléatoire. Une institutrice m’adressait à une autre, et ainsi de suite. Mais assez vite, pour éviter de faire des kilomètres superflus, je suis passé par les services académiques. J’y ai sans doute gagné en efficacité, mais ça m’a tout de même pris beaucoup de temps. Il fallait envoyer des courriers, attendre qu’on veuille bien me répondre… Il y avait un peu de méfiance. Dix semaines de tournage dans une classe, ça ne va pas de soi. Il faut dire aussi qu’au sein de l’administration, ces écoles à classe unique n’ont plus tellement le vent en poupe. Il en existe encore beaucoup, plusieurs milliers semble-t-il, mais aujourd’hui on préfère la formule du « regroupement pédagogique » : tous les enfants de la maternelle dans un village, les CP-CE1 dans un autre, les CE2, CM1 et CM2 dans un troisième…
Naturellement, je savais que beaucoup de choses reposeraient sur le choix de l’enseignant, mais sur ce point, j’étais très ouvert. Cela pouvait être un homme, une femme, quelqu’un de jeune, de moins jeune… Je n’avais pas d’a priori. Bien sûr chacun avait son style et sa personnalité, mais la plupart des enseignants que je rencontrais me semblaient très impliqués dans ce qu’ils faisaient. Les méthodes pédagogiques n’étaient pas toujours les mêmes, mais j’ai laissé cet aspect au second plan. Je ne faisais pas un film pour spécialistes.
Alors pourquoi avoir choisi cette classe-là ? Les vacances de la Toussaint approchaient, j’avais visité un peu plus de cent écoles, ça faisait quatre mois que je prospectais, que j’étais sur les routes, et en entrant dans cette classe, j’ai eu le sentiment d’avoir trouvé. La salle était grande, lumineuse, le nombre et l’âge des enfants correspondaient à ce que je cherchais, et j’ai senti qu’avec ce maître expérimenté, un peu autoritaire, notre présence ne pèserait pas trop. Il semblait assez disponible, prêt à nous accueillir pendant 10 semaines. En même temps il avait un côté secret, mystérieux, qui en faisait un « personnage ». Enfin, le fait de choisir un homme, alors qu’aujourd’hui ce métier est exercé à 85% par des femmes, me paraissait de nature à renforcer cette dimension intrigante, propre à nourrir l’imaginaire du spectateur.
Quand je l’ai rencontré, il s’est d’abord étonné, comme beaucoup d’autres avant lui, qu’on puisse faire un film de cinéma sur un sujet aussi peu « spectaculaire ». Je lui ai parlé de mon approche, précisant qu’elle n’était fondée ni sur le pittoresque ni sur la nostalgie, mais sur le désir de suivre au plus près le travail et la progression des élèves. J’avais la conviction que filmer un enfant livrant bataille avec une soustraction pouvait devenir une véritable épopée…
Les parents ont très vite donné leur accord, sans doute en raison de la confiance et du respect qu’il avaient envers ce maître installé parmi eux depuis 20 ans. Pour autant, il m’a paru indispensable de leur dire d’entrée de jeu que leurs enfants ne seraient pas filmés à part égale, ni toujours montrés dans les situations les plus gratifiantes, sans quoi il n’y aurait pas de film, du moins pas d’histoire. J’ai également anticipé sur la question du montage, pour dire qu’il faudrait éliminer des heures de rushes, sacrifier sans doute de belles scènes, sachant qu’un montage n’est pas un « best-off » mais une construction, qui obéit tant à ses propres lois qu’aux désirs du réalisateur… Bref, pour écarter toute ambiguïté, je voulais affirmer d’emblée la subjectivité de mon regard. À partir de là, chacun était en droit d’accepter ou non. Il aurait suffi qu’un seul parent soit réticent pour que je change d’école.
Le tournage s’est fait en plusieurs fois, de décembre 2000 à juin 2001. Le premier jour, nous avons pris tout le temps d’expliquer aux enfants comment nous allions travailler, à quoi servaient tous nos appareils, etc. Chacun a collé son oeil dans la caméra, mis le casque sur ses oreilles… Puis le maître a repris la classe en main, ils se sont mis au travail, nous aussi, et au bout de trois jours, nous faisions presque partie des meubles.
Nous étions quatre : un chef opérateur, un ingénieur du son, un assistant caméra et moi. On m’a souvent demandé comment nous faisions pour nous faire oublier… Mais il ne s’agit pas de ça. Bien entendu nous étions aussi discrets que possible, pour ne pas freiner le cours des choses, mais la question n’est pas « de se faire oublier ». Ce qui compte, c’est de se faire accepter. J’essaie toujours de faire comprendre à ceux que je filme que je ne suis là ni pour les juger ni pour les filmer à tout prix. Il faut savoir renoncer, poser la caméra. Ne pas forcer les portes. La caméra vous donne un pouvoir considérable, surtout si on filme des enfants. Un enfant n’osera pas forcément dire devant les autres qu’il ne veut pas être filmé. Il faut être attentif. On n’y arrive pas toujours. Dans le feu de l’action, on peut se laisser emporter.
Le moment où l’instituteur questionne Olivier sur la santé de son père est arrivé de façon très inattendue. Au début, quand j’ai commencé à filmer leur conversation, il n’était question, entre eux, que de travail. L’instituteur essayait d’encourager Olivier : s’il ne voulait pas redoubler, il allait falloir qu’il s’accroche. Et soudain il a changé de sujet, lui a demandé des nouvelles de son père, et Olivier a éclaté en sanglots ! Derrière la caméra, je n’en menais pas large ! Au montage, j’ai beaucoup hésité à garder ce passage. Même chose pour la conversation entre le maître et Nathalie, que j’ai gardée elle aussi après beaucoup d’hésitation. Mais j’ai pensé que le moment venu, quand ils découvriraient le film, l’un et l’autre seraient assez forts pour affronter ces images.
Les saisons, le temps qui passe… c’était pour moi essentiel. Souvent, après la classe, on partait dans les chemins, on allait filmer le paysage. Je voulais filmer la nature dans sa beauté et aussi dans ce qu’elle peut avoir d’inquiétant. D’ailleurs, si le film a quelque chose d’un conte, c’est d’abord à ces plans qu’il le doit : à ces arbres un peu fantomatiques agités par le vent, au silence qui pèse sur ces grands espaces, à cette solitude, ces champs d’orge où on cherche Alizé…
Le film joue souvent de cette opposition entre l’intérieur et l’extérieur, le chaud et le froid. D’un côté l’école, la chaleur du poêle, le fait d’être tous ensemble, dans une sorte de cocon protecteur ; de l’autre, le vaste monde, sa violence, les éléments qui se déchaînent, la neige, le vent, la tempête, ce troupeau de vaches que les paysans essaient de rassembler…
En m’attachant aux « personnages » de cette classe, j’ai voulu faire partager leurs épreuves, leurs bonheurs, leurs petits drames. C’est un film très ouvert. En ce qui me concerne, j’y vois une certaine gravité, voire une certaine violence, même si celle-ci reste contenue. Avant le tournage, je crois que j’avais oublié à quel point il est difficile d’apprendre, mais aussi de grandir. Cette plongée à l’école me l’a rappelé avec force. C’est peut-être le vrai sujet du film.





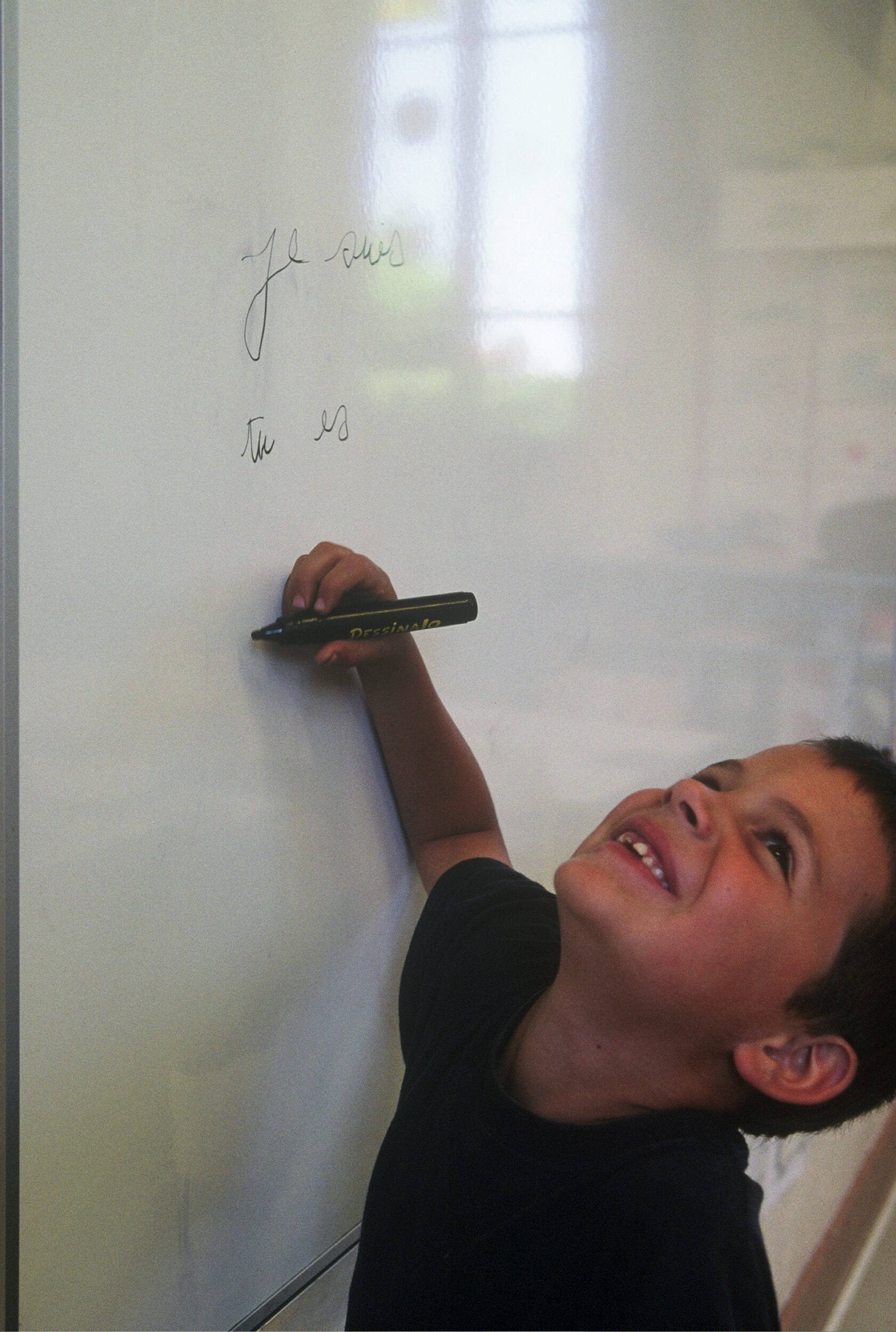



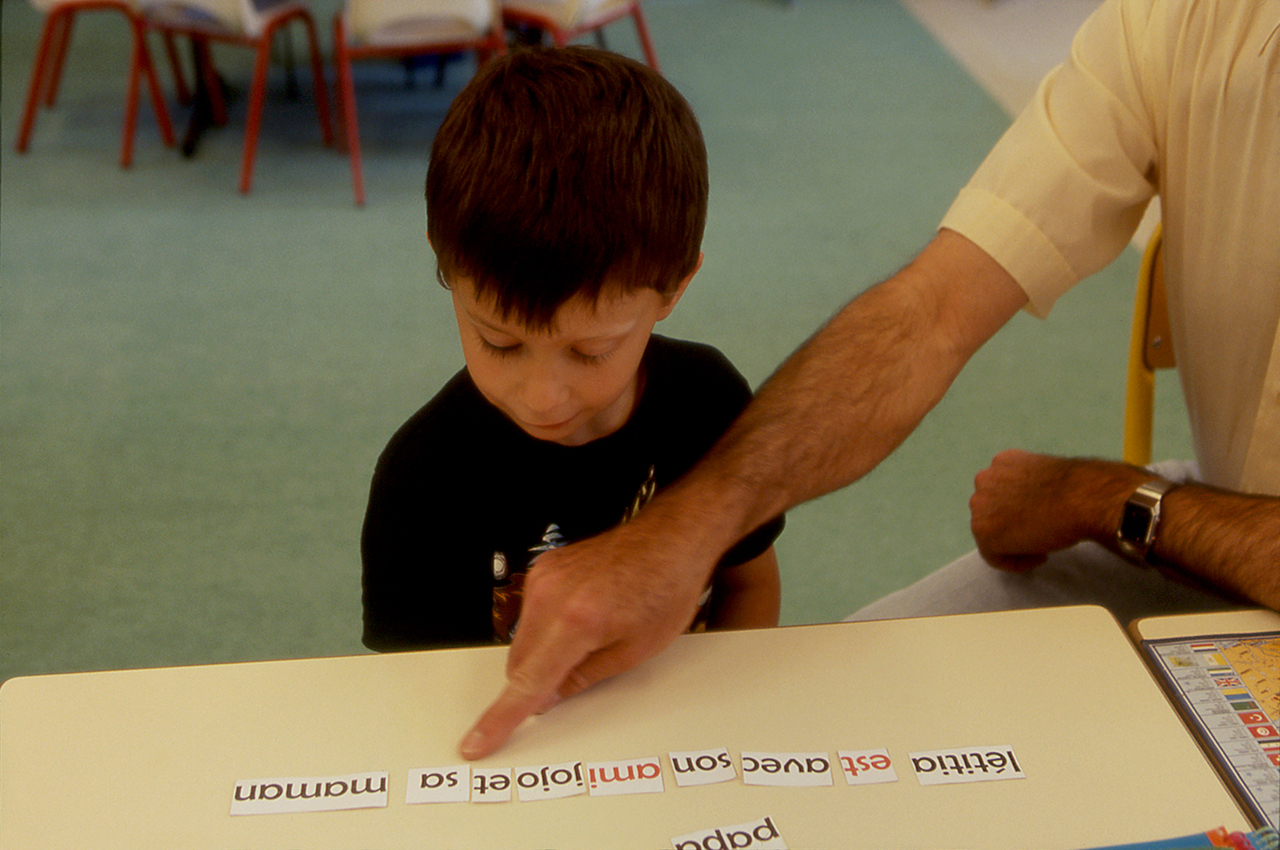
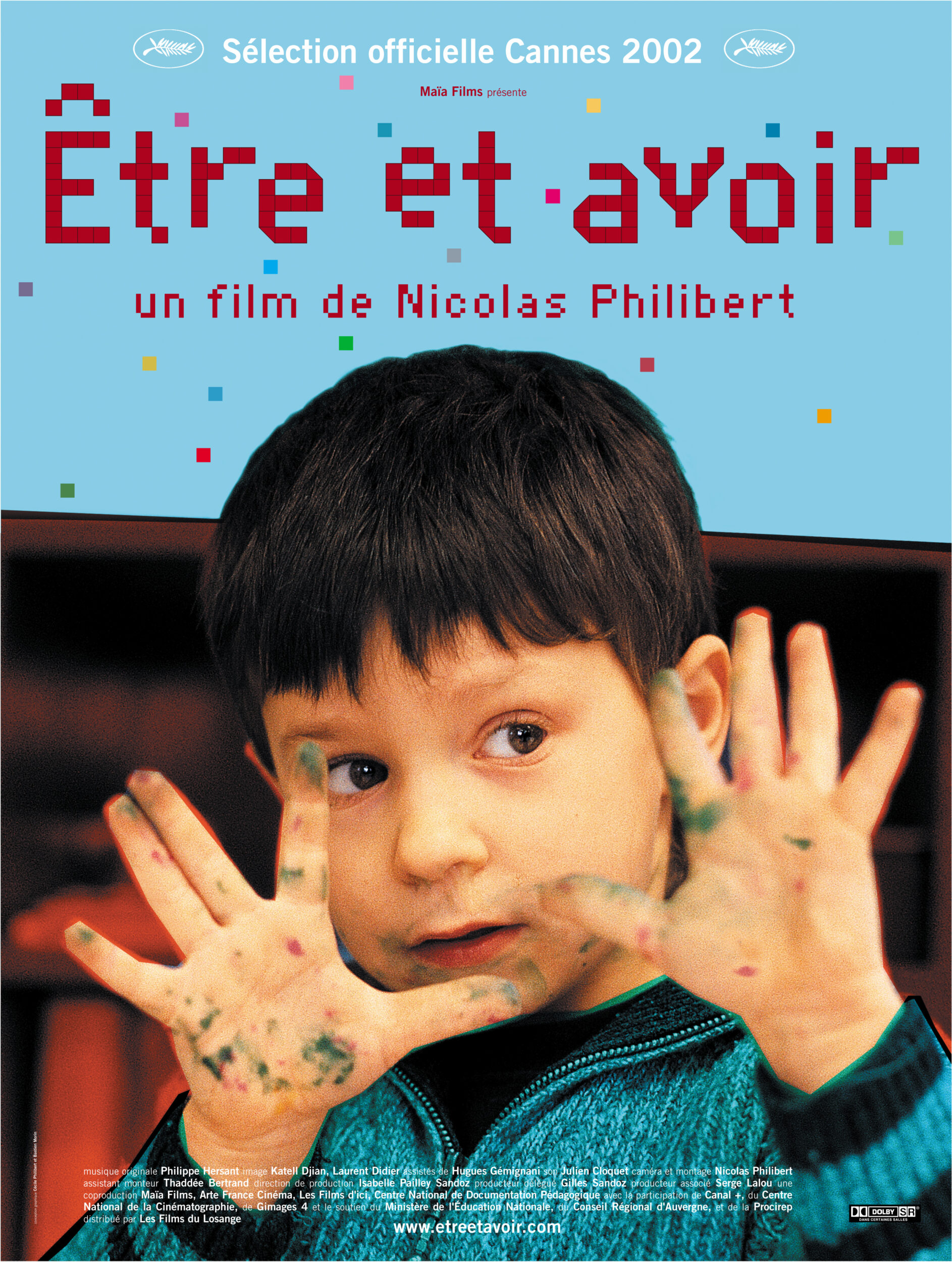

Tribunal de Grande Instance de Paris / Jugement du 27 septembre 2004
Tribunal de Grande Instance de Paris
3ème Chambre, 1ère Section
Jugement du 27 septembre 2004
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Marie-Claude APELLE, vice-président
Edouard LOOS, vice-président
Marguerite-Marie MARION, vice-président.
Greffier lors des débats : Annie VENARD-COMBES
Greffier lors du prononcé : Caroline LARCHE.
Débats
A l’audience du 15/06/2004
tenue publiquement
Jugement
Prononcé en audience publique.
Contradictoire en premier ressort
Par actes des 28, 29, 30 Janvier et 19 Septembre 2003, Monsieur Georges LOPEZ a fait assigner Monsieur Nicolas PHILIBERT, Monsieur Philippe HERSANT, la S.A.R.L. MAIA FILMS, la S.A. LES FILMS D’ICI, La S.A. ARTE France CINEMA, la S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE, la S.A.R.L. MERCURE DISTRIBUTION représentée par Maître AYACHE, liquidateur, la S.A. FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION, la S.A. TELERAMA, la S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 et la SOCIETE CANAL PLUS devant ce tribunal.
Les défendeurs sont assignés en leurs qualités respectives suivantes :
Monsieur Nicolas PHILIBERT : réalisateur du film « ETRE ET AVOIR »
Monsieur Philippe HERSANT : auteur de la musique du film
S.A.R.L. MAIA FILMS, S.A. LES FILMS D’ICI, la S.A. ARTE FRANCE CINEMA : coproducteurs
S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE : distributeur, en charge de la distribution internationale à la suite de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. MERCURE DISTRIBUTION
S.A.R.L. MERCURE DISTRIBUTION représentée par Maître AYACHE, liquidateur : distributeur des ventes internationales, jusqu’à sa liquidation
S.A. FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION : diffuseur des vidéocassettes et DVD tirés du film
S.A. TELERAMA : diffuseur d’un coffret en offre spéciale
S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION France 2 : diffuseur de spots publicitaires
S.A. CANAL PLUS : diffuseur du film
Sont intervenus volontairement à la procédure, suivant actes signifiés les 23 Avril, 17 Mai et 24 Mai 2004 :
Le 23/04/2004 : l’ UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.)
Le 17/05/2004 : l’ ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.)
Le 24/05/2004 : le CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (C.N.D.P.).
Monsieur LOPEZ expose que le film « ETRE ET AVOIR » a été tourné entre Décembre 2000 et Juin 2001 dans l’école à classe unique de Saint-Etienne-sur-Usson dans le Puy-de-Dôme où il a été instituteur de l’Education Nationale pendant près de vingt ans avant de prendre sa retraite en 2002 : que l’inspecteur d’académie a autorisé le tournage selon courrier en date du 08/12/2000 en rappelant à Monsieur PHILIBERT que, par application des circulaires des 03/07/1967 et 10/12/1976, « il ne saurait être toléré en aucun cas et aucune manière que maîtres et élèves servent directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit » ; que le tournage, qui a permis de réaliser 60 heures de rushes, a été suivi d’un montage s’étant déroulé de Juillet 2001 à Avril 2002 ; que la composition de la musique a été confiée à Monsieur Philippe HERSANT ; que le documentaire, coproduit par les sociétés S.A.R.L. MAIA FILMS, S.A. LES FILMS D’ICI, et S.A ARTE France CINEMA, a été distribué par la société LES FILMS DU LOSANGE ; que les ventes internationales ont été confiées à la société MERCURE INTERNATIONAL, puis après liquidation judiciaire de cette dernière, à la société LES FILMS DU LOSANGE qui a créé un site promotionnel intitulé « êtreetavoir.com » où figurent de nombreuses photographies de Monsieur LOPEZ.
Monsieur LOPEZ poursuit en indiquant que le documentaire, présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2002, a ensuite connu un exceptionnel succès en salles avec, au 31/12/2002, 1.303.419 entrées générant des recettes brutes d’un montant de 2.735.536,54 euros ; que la bande-annonce et des extraits du film ont été utilisés à des fins promotionnelles ; qu’antérieurement à la sortie du film, les sociétés MAIA FILMS et LES FILMS DU LOSANGE lui ont adressé des propositions d’intéressement et d’indemnisation pour l’utilisation de ses interviews de promotion auxquelles il n’a pas donné suite au vu de leurs montants ; que par arrêt du 31/03/2004, la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé un jugement du Conseil des Prud’hommes de Perpignan du 05/11/2003 qui a exclu tout lien de subordination entre Monsieur LOPEZ et la société LES FILMS DU LOSANGE au titre de sa participation à la promotion du documentaire ; qu’à compter du 01/03/2003, la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION a diffusé des vidéocassettes et DVD tirés du film accompagnés d’un livret de vingt pages comportant des photographies extraites du film où apparaît Monsieur LOPEZ ; que le DVD comporte également un film sur la présentation du documentaire à Cannes ; que, dès Mars 2003, la société TELERAMA a proposé à la vente le film en vidéocassettes et DVD ; que des spots publicitaires ont été diffusés par la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 ; qu’à compter du 01/09/2003, l’œuvre a été diffusée par la chaîne CANAL PLUS ; que tous ces actes d’exploitation ont été commis sans son autorisation.
Dénonçant des faits de contrefaçon par exploitation non autorisée de ses droits d’auteur et d’artiste interprête ainsi que des atteintes à ses droits exclusifs sur son image, son nom et sa voix, par application des dispositions du Code de propriété Intellectuelle et du Code Civil, Monsieur LOPEZ demande au tribunal de prononcer le dispositif suivant :
- dire l’U.S.P.A. et l’A.F.P.F. irrecevables en leurs demandes,
- rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevée par les sociétés MERCURE DISTRIBUTION et ARTE FRANCE CINEMA,
- écarter des débats les courriers du 28/04/2003 et du 14/05/2003 échangés entre les avocats des parties et produits par Monsieur Nicolas PHILIBERT, Monsieur Philippe HERSANT, la S.A.R.L. MAIA FILMS, la S.A. LES FILMS D’ICI et la S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE,
- dire que les actes commis par les défendeurs sont des actes de contrefaçon et les condamner à réparer le préjudice en résultant,
- faire interdiction aux défendeurs de procéder à une quelconque exploitation des droits d’auteur et d’artiste interprète du concluant sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
- dire que les défendeurs ont également commis des atteintes aux droits à l’image, au nom et à la voix de Monsieur LOPEZ et les condamner à réparer le préjudice en résultant,
- faire interdiction aux défendeurs de procéder à une quelconque exploitation des droits de la personnalité de Monsieur LOPEZ (droits à l’image, au nom et à la voix) sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée,
- condamner in solidum les défenseurs au paiement de 150.000 Euros et de 100.000 euros à titre de provisions et ordonner une expertise,
- prononcer l’exécution provisoire,
- condamner respectivement l’U.S.P.A., l’A.F.P.F. et le C.N.D.P. à verser au concluant la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile,
- condamner chacun des autres défendeurs à verser au concluant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur LOPEZ soulève les moyens suivants :
- Il est titulaire de droits d’auteur sur son cours (article L112-2 2° du CPI), 80 % du film étant constitué d’extraits du dit cours. L’originalité porte sur la présentation, l’expression, la composition et non sur le fond (les programmes de l’Education Nationale). L’œuvre de commande n’est pas exclusive d’originalité.
- Il est ensuite co-auteur de l’œuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR » au sens de l’article L 113-7 du C.P.I. pour avoir participé à sa création intellectuelle (concertation avec Monsieur PHILIBERT avant et après tournage) et pour être l’auteur du texte parlé.
- « ETRE ET AVOIR » s’analyse en conséquence en une œuvre de collaboration au sens de l’article L 113-2 du C.P.I. , ayant trois co-auteurs : Messieurs LOPEZ, PHILIBERT et HERSANT.
- Il est également titulaire de droits voisins sur l’interprétation de son cours en application de l’article L 212-1 du C.P.I.
- Le film a fait l’objet d’une exploitation à laquelle il n’a jamais consenti contrairement à l’article L 113-3 du C.P.I. qui dispose que les co-auteurs d’une œuvre de collaboration « doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».
- Les cessions de droits en matière de production audiovisuelle (article L 131-2 C.P.I.) et de droits voisins (L 212-3 C.P.I.) doivent obligatoirement être formalisées par écrit, ce qui n’a pas été le cas en la présente espèce.
- Il a été porté atteinte aux droits exclusifs qu’il détient sur son image, son nom, sa voix, puisqu’il n’a consenti aucune autorisation au titre des exploitations commerciales et publicitaires.
- Le documentaire ne bénéficie pas d’un régime d’exception dérogatoire.
Monsieur Nicolas PHILIBERT, Monsieur Philippe HERSANT, la S.A.R.L. MAIA FILMS, la S.A. LES FILMS D’ICI, la S.A.R.L. LES FILMS DU LOSANGE, ont conclu au rejet des demandes de Monsieur LOPEZ et sollicitent sa condamnation à verser à chacun d’eux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ces défendeurs soutiennent que Monsieur PHILIBERT est l’unique auteur du film documentaire « ETRE ET AVOIR » puisqu’il est seul auteur du projet et seul réalisateur tant au stade du tournage que du montage. Il est précisé que le film ne constitue aucunement un simple montage d’extraits du cours de Monsieur LOPEZ.
Selon ces défendeurs :
- le cours de monsieur LOPEZ n’est pas une œuvre protégeable au titre du droit d’auteur,
- Monsieur LOPEZ n’a pas la qualité de co-auteur pour n’être jamais intervenu ni lors du tournage ni pendant la phase de montage.
- Monsieur LOPEZ n’est pas l’auteur du texte parlé au sens de l’article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle puisque son cours, non constitutif d’une œuvre, ne préexiste pas au tournage. De plus, l’objet du film ne porte pas sur le cours.
- L’instituteur ne peut pas se prévaloir de droits d’artiste interprète.
- L’atteinte au droit à l’image ne peut être retenue, Monsieur LOPEZ ayant donné son accord pour qu’un film soit tourné dans sa classe, s’étant ensuite félicité à de multiples reprises du succès que le film a rencontré et ayant enfin activement participé à la promotion du film.
La société ARTE FRANCE CINEMA a conclu en demandant au tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
- déclarer Monsieur LOPEZ irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur LOPEZ de l’ensemble de ses demandes,
- à titre très subsidiaire, condamner la société MAIA FILMS à garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles,
- condamner Monsieur LOPEZ au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société ARTE FRANCE CINEMA indique avoir signé le 18/12/2000 une convention de coproduction avec la société MAIA FILMS, producteur délégué, limitant son engagement au seul domaine financier à l’exclusion de toute détention de droits à l’égard d’éventuels ayants droits du film « ETRE ET AVOIR » ; qu’elle se trouve donc totalement étrangère à la cause du programme litigieux. Il est également précisé que par cette convention, la société MAIA FILMS s’est obligée à garantir son co-contractant de tout recours éventuel.
Subsidiairement, il est demandé de considérer que Monsieur LOPEZ n’est pas auteur de son cours et ne rapporte pas la preuve d’une originalité au sens des articles L 112-2-2° et L 112-1 du Code de la propriété Intellectuelle. Sont également déniées les atteintes au droit à l’image, au nom et à la voix en raison des autorisations de tournage accordées tant par l’inspection académique du Puy-de-Dôme que par l’intéressé lui-même qui a activement participé tant au tournage qu’à la phase de commercialisation du film.
Maître AYACHE, mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société MERCURE DISTRIBUTION a conclu en s’en rapportant à justice sur les demandes de Monsieur LOPEZ et sollicite sa condamnation au paiement de 1.525 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION a conclu ainsi qu’il suit :
- prononcer sa mise hors de cause au titre des exploitations du film « ETRE ET AVOIR » dans les salles cinématographiques et par télédiffusion,
- débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit d’auteur puisqu’il n’a pas participé à la réalisation du film qui ne reproduit aucun élément original de son cours,
- débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit d’artiste interprète puisqu’il n’exécute aucune œuvre de l’esprit et en toute hypothèse n’a accompli ni interprétation ni prestation artistique,
- débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes fondées sur l’atteinte à son image puisqu’il a consenti aux exploitations critiquées,
- à titre subsidiaire, dire que Monsieur LOPEZ ne justifie d’aucun préjudice au titre de la diffusion par la concluante des spots publicitaires litigieux,
- condamner Monsieur LOPEZ au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à titre subsidiaire, condamner la société MAIA FILMS et LES FILMS DU LOSANGE à garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles et condamner ces dernières au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société CANAL PLUS a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes pour des motifs identiques à ceux développés par les précédents défendeurs. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le cours serait considéré comme une œuvre de l’esprit, il est demandé de déclarer Monsieur LOPEZ irrecevable à agir puisque les droits d’exploitation de cette œuvre appartiendraient à l’Etat. A titre subsidiaire également, par application du contrat d’achat de droits signé le 04/01/2001, il est demandé de condamner la société MAIA FILMS à relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles. Est sollicitée la condamnation de Monsieur LOPEZ au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2, diffuseur de spots publicitaires, a conclu à sa mise hors de cause au titre des exploitations du film « ETRE ET AVOIR » dans les salles cinématographiques, sur supports de reproduction (cassette VHS et DVD) et par télédiffusion. Elle conteste toute contrefaçon en raison des représentations critiquées qui présentent un caractère accessoire et ne portent sur aucun élément protégé. Elle précise que Monsieur LOPEZ ayant expressément consenti à l’utilisation de son image pour les besoins de la promotion du film ne peut pas invoquer une atteinte au droit sur son image. A titre subsidiaire la défenderesse soutient que Monsieur LOPEZ ne justifierait d’aucun préjudice au titre de la diffusion des spots publicitaires litigieux. A titre très subsidiaire, elle demande la garantie des sociétés MAIA FILMS, LES FILMS DU LOSANGE et LES FILMS D’ICI. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de Monsieur LOPEZ au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société TELERAMA, diffuseur d’un DVD dans les réseaux de kiosques et marchands de journaux en France, sollicite sa mise hors de cause au titre des exploitations du film dans les salles cinématographiques et par télédiffusion. Elle s’oppose à toutes les demandes de Monsieur LOPEZ pour des motifs identiques à ceux développés par les précédents défendeurs. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION en application de la convention signée avec cette dernière le 12/02/2003. Elle réclame la condamnation de Monsieur LOPEZ à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) est intervenue volontairement à la procédure le 23/04/2004 et s’oppose aux demandes de Monsieur LOPEZ. Elle soutient avoir intérêt à agir en sa qualité de syndicat professionnel regroupant les producteurs d’œuvres audiovisuelles destinées à la télévision notamment les documentaires et avoir pour objet la protection de leurs intérêts professionnels. Elle rappelle la nature et l’économie du genre documentaire, incompatibles avec tout principe de rémunération. Concernant particulièrement le film « ETRE ET AVOIR » elle considère non fondées les prétentions de Monsieur LOPEZ tant au titre du droit d’auteur que de l’atteinte aux droits de la personnalité.
L’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.) est intervenue volontairement à la procédure le 17/05/2004 en s’opposant également aux demandes de Monsieur LOPEZ. Elle soutient avoir intérêt à agir en sa qualité de syndicat professionnel ayant pour objet de rassembler les entreprises de production de films cinématographiques et de programmes audiovisuels en vue notamment d’une meilleure défense de la profession, l’action engagée par Monsieur LOPEZ étant susceptible de compromettre l’avenir du film documentaire. Sur le fond, l’A.F.P.F. prétend que les demandes de Monsieur LOPEZ ne sont pas justifiées.
LE CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (C.N.D.P.) est intervenu volontairement le 24/05/2004 en réclamant la condamnation de Monsieur LOPEZ à lui verser 1 euro en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE C.N.D.P., établissement public national à caractère administratif, expose que, dans le cadre de sa mission, il a conclu le 03/12/2001 avec la société MAIA FILMS un contrat de coproduction du film documentaire « ETRE ET AVOIR » et percevoir à ce titre 7 % des recettes. Le C.N.D.P. affirme également que le cours de Monsieur LOPEZ n’est pas l’objet du film qui ne s’apparente aucunement à un documentaire pédagogique ; que de surcroît Monsieur LOPEZ applique dans son enseignement les méthodes et programmes officiels de 1995 tels qu’ils figurent dans l’ouvrage « Une école pour l’enfant, des outils pour le maître » édité par le C.N.D.P.
MOTIFS
A/ SUR LA PROCEDURE
SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Attendu que l’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) est intervenue volontairement à la procédure le 23/04/2004 ; que l’ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.) est intervenue volontairement le 17/05/2004 ; que ces interventions sont accessoires au sens de l’article 330 du Nouveau Code de Procédure Civile puisqu’elles tendent non pas à présenter une prétention, mais à appuyer celles formulées par une partie, en l’espèce celles du réalisateur et des producteurs du film « ETRE ET AVOIR ».
Attendu que l’ U.S.P.A. est un syndicat professionnel qui regroupe des « producteurs d’œuvres audiovisuelles destinées à la télévision… » comprenant notamment les documentaires et a pour objet la protection de leurs intérêts professionnels ; que ce syndicat a le droit d’ester en justice et, dans la présente espèce indique comprendre parmi ses adhérents la société LES FILMS D’ICI, coproductrice du film « ETRE ET AVOIR », partie défenderesse au présent litige ; que ce syndicat a intérêt, pour la conservation des droits des producteurs qu’elle représente, à soutenir la position juridique de la société LES FILMS D’ICI selon laquelle la personne filmée dans un documentaire n’a pas la qualité de co-auteur et ne peut prétendre à aucune rémunération à ce titre.
Attendu que l’A.F.P.F. est également un syndicat professionnel qui a pour objet de rassembler les entreprises de films cinématographiques et de programmes audiovisuels en vue d’une meilleure défense de la profession ; qu’outre sa qualité à agir en justice elle a intérêt à soutenir l’action des producteurs du film « ETRE ET AVOIR » puisque l’action telle qu’engagée par Monsieur LOPEZ , au-delà des faits propres de l’espèce, tend à voir reconnaître un principe de rémunération au bénéfice des personnes présentées dans un genre documentaire.
Attendu que ces deux syndicats doivent être déclarés recevables en leur intervention volontaire.
SUR LA DEMANDE DE REJET DE PIECES
Attendu que Monsieur LOPEZ demande au tribunal d’écarter des débats, pour atteinte au secret professionnel, les courriers du 28/04/2003 et du 14/05/2003 échangés entre les avocats des parties correspondant aux pièces n°12 énumérées dans le bordereau de communication du conseil de Monsieur PHILIBERT, de Monsieur HERSANT, et des sociétés MAIA FILMS, LES FILMS D’ICI et FILMS DU LOSANGE ; que ces pièces ne figurant pas dans le dossier remis au tribunal par ce conseil, la demande doit être considérée comme étant sans objet.
SUR LES AUTRES EXCEPTIONS D’IRRECEVABILITE
Attendu que, par application des dispositions de l’article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal n’a pas à statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par Maître AYACHE, mandataire liquidateur et représentant des créanciers de la société MERCURE DISTRIBUTION, dans ses conclusions du 27/08/2003 et non repris dans ses dernières conclusions du 14/05/2004.
Attendu que la société ARTE FRANCE CINEMA soulève une irrecevabilité des demandes présentées à son encontre en raison des termes de la convention de coproduction du film « ETRE ET AVOIR » signée entre elle-même et la société MAIA FILMS, producteur délégué ; que l’examen de ce moyen nécessitant un examen au fond ne constitue pas une exception de procédure.
B/ SUR LE FOND.
SUR LES DROITS DE MONSIEUR LOPEZ SUR SON COURS
Attendu que Monsieur LOPEZ revendique un droit d’auteur sur son cours.
Attendu qu’un cours est susceptible de faire l’objet de la protection prévue à l’article L 112-1 du Code de la propriété Intellectuelle, qu’il soit oral ou écrit et quel que soit le niveau de la classe d’enseignement, à condition qu’il présente des éléments d’originalité traduisant la personnalité de son auteur ; que l’originalité peut se situer au niveau du contenu du cours, de la didactique ou des méthodes pédagogiques.
Attendu que, contrairement à ce que soutient la société CANAL PLUS, Monsieur LOPEZ ne se prévaut pas d’un droit portant sur les programmes de l’ÉDUCATION NATIONALE sur lesquels seul l’Etat serait susceptible de détenir des droits, mais revendique la forme, la présentation, et plus spécialement, la composition et l’expression de ses cours.
Attendu que le suivi des programmes, qui constitue une obligation pour les enseignants des établissements du primaire et du secondaire, n’exclut pas l’existence d’une originalité dans leur mise en œuvre par l’instituteur ou le professeur des écoles ; qu’en effet, les circulaires du Ministre à l’intention des enseignants du primaire, si elles comportent à la fois des listes des programmes pour chaque classe et des références nombreuses et parfois très détaillées aux méthodes préconisées et aux objectifs recherchés, n’incluent pas des textes de cours.
Que, contrairement au moyen soulevé par la société CANAL PLUS, Monsieur LOPEZ est donc recevable à agir puisqu’il ne se prévaut pas de droits appartenant à son employeur.
Attendu que Monsieur LOPEZ affirme que son cours est original dans sa composition qui résulte de ses choix personnels, dans son style et dans son expression ; qu’il fait valoir que son cours est une création personnelle, fruit de son expérience d’enseignant, de ses réflexions sur son métier, sur la psychologie et le comportement de ses élèves, de ses recherches,de ses choix quant à ses méthodes d’enseignement, et enfin de ses sélections quant à la nature des textes littéraires et des exercices proposés aux écoliers.
Mais attendu que s’il est évident que le film révèle la très grande compétence professionnelle de l’instituteur, sa réflexion sur son exercice professionnel et la pertinence de ses méthodes pédagogiques, ces éléments ne constituent pas des matières protégeables en application du Code de la Propriété Intellectuelle.
Que sont susceptibles d’être protégés, sous réserve d’originalité, un cours en tant qu’ « enseignement suivi sur une matière » (E.Littré) qu’il soit écrit ou oral, une didactique, c’est-à-dire un système de présentation logique et méthodique d’un enseignement, et une méthode pédagogique, c’est-à-dire un système psycho éducatif favorisant l’apprentissage des savoirs ; que le film ne présente pas de tels cours ou méthodes, mais montre, à travers des séquences d’enseignements ou de contacts, un ensemble de relations complexes entre l’instituteur, ses élèves, les familles et le milieu social et géographique ; que si la figure de l’instituteur est très présente et prégnante, il n’en est pas moins incontestable qu’aucun cours, aucune didactique ou aucune méthode pédagogique ne sont reproduits dans le film.
Que Monsieur LOPEZ doit, par voie de conséquence, être débouté de sa demande fondée sur le droit d’auteur.
SUR LES DROITS DE MONSIEUR LOPEZ SUR L’OEUVRE AUDIOVISUELLE
Attendu que Monsieur LOPEZ soutient qu’il est co-auteur du film « ETRE ET AVOIR » en application de l’article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle du fait de sa participation à la création du documentaire, en sa qualité d’auteur du texte parlé et du fait de l’incorporation de son œuvre dans le film.
Attendu qu’il est démontré par les pièces produites au débat que Monsieur PHILIBERT, qui souhaitait réaliser un long-métrage documentaire sur une classe unique à la campagne, a visité diverses écoles au cours de l’année 2000 et a pris contact avec les inspecteurs d’académie de la Lozère, de la Corrèze et du Puy-de-Dôme ; que finalement, il a porté son choix sur l’école primaire de Saint-Etienne-sur-Usson dans le Puy-de-Dôme ; que le 08/12/2000, l’Inspecteur d’Académie du Puy-de-Dôme lui a donné l’autorisation de tourner son film dans cette dernière école ; que le tournage a commencé en Décembre 2000.
Attendu que Monsieur LOPEZ, dans les interviews données après la sortie du film, a indiqué, de manière constante qu’il n’était pas intervenu dans le tournage ; qu’il a ainsi précisé, parlant du réalisateur, Monsieur PHILIBERT, « on a presque oublié qu’il tournait ».
Que le fait que Monsieur LOPEZ disposait évidemment du pouvoir d’intervenir – pouvoir qui n’était pas fondé seulement sur l’accord du réalisateur, mais d’abord et surtout sur la spécificité d’un tournage portant sur l’exercice d’une mission de service public, dans un local dépendant du domaine public et mettant en cause de jeunes enfants – n’implique pas que Monsieur LOPEZ pouvait intervenir dans la création – texte ou structure de l’œuvre – et qu’il l’ait effectivement fait ; que la seule évocation d’échanges entre le réalisateur et l’instituteur, qui sont très plausibles, compte tenu de la longueur des opérations et de la qualité des relations ayant existé entre l’instituteur et le réalisateur, ne caractérise aucunement une participation de ce dernier aux opérations intellectuelles de conception du film.
Que Monsieur LOPEZ n’allègue aucune participation réelle aux opérations de réalisation et au choix des plans et des séquences ; qu’aucune pièce produite au débat n’est par ailleurs de nature à étayer une telle participation, que Monsieur LOPEZ indique uniquement avoir été invité pendant les vacances scolaires de fin Octobre 2001 à assister aux opérations de montage, s’y être rendu et être resté un peu plus d’une heure, sans avoir fait faire de modifications ; qu’ainsi, Monsieur LOPEZ n’invoque et à fortiori, ne prouve aucune participation de sa part à ces différents stades de la création du film.
Attendu que Monsieur LOPEZ soutient par ailleurs qu’il est auteur du texte parlé.
Mais, attendu que le documentaire ne renferme aucun texte susceptible d’avoir été conçu pour les besoins de l’œuvre audiovisuelle au sens du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’il s’agit d’un documentaire dans lequel les paroles de Monsieur LOPEZ se situent, pour une part majoritaire en durée, dans le cadre de son exercice professionnel, en interaction avec les élèves et pour une autre part moins importante en temps dans le cadre d’une interview portant sur ses origines familiales et sa vocation d’instituteur ; qu’ainsi, Monsieur LOPEZ n’invoque aucun texte susceptible d’avoir été conçu pour les besoins de l’œuvre audiovisuelle.
Attendu que le présent jugement, au terme des motifs exposés plus haut, n’ayant pas retenu que les interventions de Monsieur LOPEZ au sein du film constituaient des textes, cours ou méthodes susceptibles d’être protégeables au sens du Code de propriété Intellectuelle, ces interventions ne peuvent constituer une incorporation dans le film d’éléments protégeables permettant à Monsieur LOPEZ d’avoir la qualité d’auteur.
Attendu que Monsieur LOPEZ ne peut donc qu’être débouté de sa demande de reconnaissance de droit d’auteur sur le fondement de l’article L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle.
SUR LES DROITS VOISINS
Attendu que, sur le fondement des articles L 212-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Monsieur LOPEZ revendique des droits d’artiste interprète de l’œuvre orale que constitue son cours.
Mais, attendu que le seul fait d’être filmé ne confère pas à celui qui l’a été la qualité d’artiste-interprète ; qu’il est intellectuellement acquis aujourd’hui que toute œuvre documentaire implique, à l’instar des autres œuvres scientifiques ou artistiques, une « construction », mais que l’existence de ce processus de construction ne permet aucunement d’assimiler documentation et fiction, pas plus que la personne filmée dans le documentaire à un artiste-interprète ; que Monsieur LOPEZ n’a été filmé que dans l’exercice de son activité professionnelle et dans le cadre de l’interview ci-dessus spécifiée, où il évoquait ses origines familiales et les bases de sa vocation d’enseignant ; que ces données, qui reflètent un exercice professionnel et un statut social, relèvent du fait documentaire qui, de par son rapport au réel, tel qu’il est conçu dans les arts cinématographiques, exclut la notion d’interprétation.
Que cette demande non fondée doit être rejetée.
SUR LA CONTREFAÇON
Attendu que le documentaire montre Monsieur LOPEZ dans son exercice professionnel d’instituteur, et donc « faisant cours » au sens commun du terme, mais qu’il n’inclut pas un cours susceptible d’être protégé au titre de la propriété intellectuelle, à savoir un exposé suivi sur un savoir déterminé, ni davantage, une didactique ou un type de pédagogie identifiable dans ses présupposés, ses principes et ses structures ; que cet aperçu de l’exercice d’un professionnel ne constitue pas une œuvre au sens précis et restreint défini par la loi.
Qu’il ne peut donc y avoir contrefaçon.
SUR L’ATTEINTE AU DROIT A L’IMAGE, AU NOM ET A LA VOIX
sur le film et les supports d’exploitation
Attendu que, par application des dispositions de l’article 9 du Code Civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée » ; que ce droit couvre notamment le droit à l’image, au nom et à la voix.
Attendu que Monsieur LOPEZ fait valoir qu’il n’a jamais consenti « expressément » à l’exploitation de son droit à l’image, au nom et à la voix, dans le film stricto sensu et, à fortiori, dans les différents supports publicitaires et commerciaux.
Attendu que la partie qui se voit reprocher une telle atteinte, peut opposer l’autorisation donnée par la personne physique qui invoque la violation de son droit ; que cette autorisation peut être expresse ou tacite et que la preuve en est libre.
Attendu qu’il n’est produit au débat aucune pièce établissant que Monsieur LOPEZ ait donné de manière expresse, son accord au tournage du documentaire.
Qu’il convient de rechercher si Monsieur LOPEZ a, au moins tacitement mais de manière certaine, accepté d’être filmé.
Attendu que les courriers adressés par Monsieur PHILIBERT à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Lozère le 27/06/2000 et à Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Corrèze le 25/09/2000, concernent d’autres écoles situées dans d’autres ressorts d’inspections académiques, projets qui n’ont pas eu de suite ; que ces documents sont dépourvus de pertinence pour apprécier l’existence d’un accord de Monsieur LOPEZ.
Attendu qu’il est constant que Monsieur PHILIBERT a rencontré Monsieur LOPEZ au cours de l’automne 2000, lui a exposé son projet et lui a fait visionner deux de ses précédents films, que Monsieur l’Inspecteur du Puy-de-Dôme a accepté le tournage du documentaire dans les locaux de l’école de Saint-Etienne-sur-Usson, que Monsieur LOPEZ a indiqué à des journalistes avoir ainsi accepté le tournage du film ; que le tournage s’est déroulé sur neuf mois à compter de Décembre 2000, dans les locaux publics où Monsieur LOPEZ exerçait sa profession de fonctionnaire de l’Education Nationale ; que Monsieur LOPEZ a donné l’interview susmentionnée qui est intégrée dans le film.
Que ces éléments démontrent que Monsieur LOPEZ était d’accord sur le principe de la prise de son image et sur les modalités, nécessairement successives de cette prise.
Attendu qu’il importe également de déterminer si Monsieur LOPEZ était d’accord sur la libre diffusion de son image et sur les diverses modalités qu’a prise cette diffusion.
Attendu qu’il convient de constater préalablement que, à l’évidence, l’ensemble du film est imprégné d’empathie et/ou de sympathie à l’égard de l’instituteur et de la manière dont il exerce sa mission ; qu’il s’en suit que le film ne dénature ni n’altère l’image de Monsieur LOPEZ.
Attendu, s’agissant des modalités de diffusion, que le tribunal constate que Monsieur LOPEZ était présent avec ses élèves et leurs parents, lors de la projection du film à Clermont-Ferrand, en Avril 2002 ; qu’il était présent à la séance spéciale du Festival de Cannes où le film a été présenté en Mai 2002 ; qu’entre le 25 Août et le 03 Octobre 2002, il a participé à plusieurs manifestations de promotion organisées en vue de la sortie en salles ; que dans le quotidien « Le Républicain Lorrain » du 18 Septembre 2002 – donc au cours de la période de promotion pour la sortie en salles – il n’a pas seulement comparé le tournage à sa plus belle inspection – ce qui pourrait, hors contexte, être analysé comme la seule expression de satisfaction éprouvée d’une telle reconnaissance publique –mais encore s’est réjoui expressément du succès du film ; qu’enfin, dans « le Parisien » du 12 Décembre 2002, il se félicite de l’attribution au film le jour précédent du Prix Louis Delluc.
Attendu que l’ensemble de ces données démontrent l’accord tacite mais certain de Monsieur LOPEZ pour la création, la réalisation et la sortie du film ainsi que par voie de conséquence, pour la diffusion de son image par ce film ; qu’il n’a formulé aucune objection et a adhéré aux diverses étapes de reconnaissance du film tant par les professionnels que par le grand public ; qu’en participant à sa promotion, il a contribué au succès du film ; que Monsieur LOPEZ ne peut pas invoquer son absence de consentement ; que le caractère imprévisible du succès du film vaut pour toutes les œuvres cinématographiques ; que dans ces conditions, Monsieur LOPEZ ne peut pas soutenir que la représentation de son image, de sa voix et de son nom dans le film constitue une violation de ses droits de la personnalité au sens de l’article 9 du Code Civil.
Attendu que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, Monsieur LOPEZ ne prouve aucunement que le film comporterait une dénaturation ou une altération de son image ; que le film le montre en sa qualité d’instituteur, fonctionnaire de l’Education Nationale dans l’exercice de ses fonctions ; que la partie relative à ses parents, à sa vocation et à son parcours professionnel résulte de l’entretien qu’il a lui-même accordé en vue de son intégration dans le film ; que pour les motifs ci-dessus développés, il ne peut invoquer son absence de consentement.
Attendu, que par ailleurs, la bande-annonce du film, qui est présente dans le DVD et a été diffusée par extraits à la télévision, est constituée de séquences, qui, conformément aux lois du genre, comprennent de courts extraits de scènes marquantes du film, sans modification ni ajout ; que l’image de Monsieur LOPEZ n’est donc pas dénaturée ou altérée dans cette bande-annonce.
Attendu que la publicité pour un film, par bande-annonce, s’analyse également dans les conditions culturelles et économiques contemporaines comme un élément de l’ensemble indissociable, à défaut de stipulation contraire, que constituent la production et la diffusion normales d’un film ; que la mention des circulaires ministérielles visées par Monsieur l’Inspecteur d’Académie du Puy-de-Dôme ne concerne pas la promotion normale d’une œuvre cinématographique sur le service public de l’Education Nationale, tournée avec l’autorisation de l’autorité compétente, mais la seule exploitation anormale – purement mercantile ou contraire aux intérêts légitimes du service public – éventuellement au moyen de produits dits dérivés, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
Attendu que dans ces conditions la diffusion du film en salles à compter de Septembre 2002 et sa promotion n’ont pas porté atteinte aux droits de Monsieur LOPEZ sur son image, son nom, sa voix.
Attendu que dès lors qu’un film, quel que soit son genre, documentaire ou fiction, rencontre un succès en salles, il possède une vocation normale et même évidente, dans les conditions culturelles et économiques contemporaines, à être diffusé en VHS et DVD puis à la télévision ; que le film est sorti en VHS et en DVD à compter de Mars 2003, ainsi qu’à la télévision sur CANAL PLUS en Septembre 2003 ; que ces formes de distribution constituent un ensemble rendant leur dissociation arbitraire.
Attendu qu’il faut toutefois examiner la question d’une faute éventuelle du réalisateur ou de toute autre partie dans l’utilisation de l’image consentie par Monsieur LOPEZ.
Attendu qu’en la présente espèce, aucun détournement, aucune dénaturation ou dévalorisation de l’image de Monsieur LOPEZ, dans le film, n’est commis ni d’ailleurs allégué.
Attendu que Monsieur LOPEZ, qui a autorisé de façon tacite mais certaine la diffusion de son image, de son nom et de sa voix dans le film, ne prouve ni même n’allègue que son autorisation aurait été limitée à la seule diffusion du film en salles.
Que dès lors, Monsieur LOPEZ ne peut invoquer aucune violation de ses droits sur son image, son nom et à sa voix, du fait de la diffusion du film, sans aucune dénaturation, sur les supports naturels actuels d’une œuvre cinématographique – étant observé, en outre, que l’Etat, qui ne serait pas insusceptible d’apparaître comme le titulaire premier, voire unique des droits sur les images, l’œuvre se déroulant pour partie dans des locaux du domaine public et étant tournée à l’occasion d’une mission de service public administratif, n’a formulé aucune objection ni revendiqué aucun droit.
C/ SUR LES AUTRES UTILISATIONS
Attendu qu’il convient d’analyser le cas spécifique constitué par le petit film intitulé « Récitations » présent uniquement sur le DVD ; que le DVD comporte en effet une courte séquence filmée dans laquelle plusieurs des élèves récitent des petits poèmes.
Attendu que l’image de Monsieur LOPEZ n’est pas présente dans cette séquence, seul le son de sa voix étant perceptible ; que comme dans le film stricto sensu, ce passage ne comporte aucun élément de dévalorisation ou de dénaturation, tout au contraire, et n’a pu être réalisé qu’avec l’accord de Monsieur LOPEZ dans l’exercice de son activité professionnelle ; que sa réalisation comme sa diffusion s’intègrent dans l’ensemble pour lequel Monsieur LOPEZ a donné tacitement mais de façon certaine son consentement.
Attendu que le documentaire tourné à Cannes en Mai 2002, présent uniquement sur le DVD, montre Monsieur LOPEZ à l’occasion de la projection du film au Festival International du Cinéma, en compagnie de Monsieur PHILIBERT, des enfants et des parents de ces derniers ; que là encore, il n’existe aucun élément de dévalorisation, de dénaturation ou de détournement ; que l’événement était par essence public, médiatique et en dehors de l’activité professionnelle de Monsieur LOPEZ ; que la participation de Monsieur LOPEZ à cet événement correspond à une phase où il apportait activement sa contribution à la promotion du film ; que, dans ces conditions, Monsieur LOPEZ n’est pas fondé à invoquer la responsabilité du réalisateur ou de toute autre partie, au titre des articles 9 et 1382 du Code Civil.
Attendu que ces mêmes considérations conduisent à débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes au titre du livret inclus dans le DVD et du site Internet, qui ne présente aucun élément extérieur au film et aucune dénaturation.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la solution du litige conduit à débouter Monsieur LOPEZ de ses demandes d’interdiction et d’indemnisation ainsi que de ses réclamations présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la demande d’expertise est sans objet.
Attendu que le Centre National de Documentation Pédagogique, intervenant volontaire, invoque un préjudice moral résultant « tant de l’attitude procédurale de Monsieur LOPEZ à son égard que des allégations formulées à son encontre » ; qu’il ne démontre toutefois aucunement l’existence d’un comportement fautif imputable à Monsieur LOPEZ dans le déroulement de la procédure qui excèderait les droits normaux d’une partie dans une instance judiciaire ; qu’il doit être débouté de ce chef de demande.
Attendu que l’équité conduit à ne pas faire supporter à Monsieur LOPEZ les sommes exposées par chacun des défendeurs ou intervenants volontaires, non comprises dans les frais et dépens ; que les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doivent être rejetées.
Attendu qu’au vu de la solution du litige, la demande d’exécution provisoire s’avère sans objet.
Attendu qu’en application de l’article 696 du Nouveau Code de procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Attendu qu’en l’espèce, la personnalité de Monsieur LOPEZ , son acceptation d’un tournage qui a duré de nombreux mois, l’incidence de la mise à contribution de ses dons pédagogiques et de sa qualité professionnelle ont contribué, de manière manifeste et importante au grand succès commercial, peu fréquent, de ce type d’œuvre documentaire ; que le principal de ses contradicteurs, Monsieur Nicolas PHILIBERT, ne le conteste pas, qu’une proposition financière avait d’ailleurs été, à un moment, formulée par un des défendeurs ; que ces données constituent des éléments de caractère exceptionnel au sens de l’article 696 susvisé qui commande de laisser uniquement à la charge de Monsieur LOPEZ les frais d’actes d’huissier de justice qu’il a fait diligenter et à la charge de chacune des autres parties les frais répétibles qu’elle ont exposés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN PREMIER RESSORT
Déclare recevables en leurs interventions, L’UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE (U.S.P.A.) et l’ ASSOCIATION FRANCAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (A.F.P.F.).
Reçoit en son intervention le CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE.
Dit sans objet la demande de rejet de pièces.
Dit que le film « ETRE ET AVOIR » ne reproduit pas des éléments du cours de Monsieur Georges LOPEZ sur lesquels il pourrait revendiquer un droit d’auteur.
Dit que Monsieur Georges LOPEZ n’est pas co-auteur de l’œuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR ».
Dit que Monsieur Georges LOPEZ ne dispose pas de droits d’artiste interprète sur le film « ETRE ET AVOIR ».
En conséquence, déboute Monsieur Georges LOPEZ de sa demande de contrefaçon,
Déboute Monsieur Georges LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit à l’image, au nom et à la voix.
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laisse uniquement à la charge de Monsieur LOPEZ les frais d’actes d’huissier de justice qu’il a fait diligenter, et à la charge de chacune des autres parties les frais répétibles qu’elles ont exposés.
PRONONCÉ LE 27 SEPTEMBRE 2004 PAR MADAME APELLE – VICE-PRESIDENT – ASSISTEE DE MADAME LARCHE –GREFFIER.
Cour d’Appel de Paris / Arrêt du 29 mars 2006
Cour d’Appel de Paris
4e Chambre, Section A
Arrêt du 29 mars 2006
Numéro s’inscription au répertoire général : 04 / 22172
Décision déférée à la Cour ; Jugement du 27 Septembre 2004 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 03 / 03496
APPELANT
Monsieur Georges LOPEZ
Représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
Assisté de Me Benoît MAYLIE avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
Monsieur Nicolas PHILIBERT
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Philippe HERSANT
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. MAIA FILMS
prise en la personne de son gérant
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
S.A. LES FILMS D’ICI
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
SA.R.L. LES FILMS DU LOSANGE
prise en la personne de son gérant
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Roland RAPPAPORT (P329) plaidant pour la SCP RAPPAPORT-HOCQUET- MEDAKSIAN, avocats au barreau de PARIS
S.A. ARTE FRANCE CINEMA
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298,
plaidant pourla SCP CARBONNIER et associés
S.A. CANAL PLUS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P224
plaidant pourla SCP CHEMOULI- DAUZIER et associés
Maître Gérald AYACHE
ès qualités de mandataire liquidateur et de représentants des créanciers de lasociété MERCUREDISTRIBUTION
représenté par la SCP VARlN – PETIT, avoués à la Cour
assisté de Me Elisabeth GUYOT, avocat au barreau de Pontoise, toque :(T92),
plaidant pour le cabinet .Christophe SANTELLI-ESTRANY
S.A. FRANCE TELEVISIONS DICTRIBUTION
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B808
SA. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX- BOULAY, avoués à la Courassisté de Me Gilles VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B808
SA. TELERAMA
prise en la personne de ses représentants légauxreprésentée, par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry MASSIS, avocat au barreau de PARIS, (P72)
plaidant pour la SCPLUSSAN BROUILLAUD
USPA – UNION SYNDICALE DE LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
prise en la personne de son Délégué Général
représentée par la SCP GERIGNY-FRENEAUX avoués à la Cour
assistée de Me Patrick BOIRON, avocat au barreau de PARIS (235)
plaidant pour la SCPCARIDDI et associés
AFPF – ASSOCIATION FRANçAISE DES PRODUCTEURS DE FILMS ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick V1LBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L315,
plaidant pour SELARL BOCQUET et associés
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT et par Mme JacquelineVIGNAL,
greffier présent lors du prononcé.
Vu L’appel interjeté par Georges LOPEZ du jugement rendu le 27 septembre 2004
par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- déclaré recevables en leurs interventions l’Union Syndicale de la Production Audiovisuelle dite USPA, et l’Association Française des Producteurs de Films et deProgrammes Audio-visuels dite AFPF,
- reçu en son intervention volontaire le Centre National de Documentation Pédagogique,
- dit sans objet la demande de rejet de pièces,
- dit que le film « ETRE ET AVOIR » ne reproduit pas des éléments du cours de GeorgesLOPEZ sur lesquels il pourrait revendiquer un droit d’auteur,
- dit que Georges LOPEZ n’est pas coauteur de l’oeuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR »
- dit que Georges LOPEZ ne dispose pas de droits d’artiste interprète sur le film « ETRE ET AVOIR »
- débouté Georges LOPEZ de sa demande en contrefaçon,
- débouté Georges LOPEZ de ses demandes fondées sur le droit à l’image, au nom et à la voix,
- rejeté toutes les demandes des parties y compris celles présentées sur le fondement del’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- laissé uniquement à la charge de Georges LOPEZ les frais d’actes d’huissier qu’il a faitdiligenter et à la charge de chacune de autres parties les frais répétibles qu’elles ontexposés ;
Vu les dernières écritures signifiées le 7 février 2006 par lesquelles Georges LOPEZ, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la Cour de :
– enjoindre aux intimés à l’exception de I’USPA de verser aux débats les pièces, objets de la sommation de communiquer du 8 novembre 2005, réitérée le 25 novembre 2005, sousastreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* à titre principal
– dire l’USPA et l’AFPF irrecevables en leurs interventions,
– dire qu’il est coauteur de l’oeuvre audiovisuelle « ETRE ET AVOIR »,
– dire que les intimés ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice,
– dire que les intimés ont méconnu ses droits à l’image, au nom et à lavoix,
– avant dire droit sur son préjudice, ordonner une expertise,
– condamner in solidum les intimés à 1ui verser une provision à valoir sur son
préjudice équivalente au montant de la provision qui sera allouée à l’expert qui sera désigné,
– condamner in solidum chacun des intimés à lui verser la somme de l.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
* subsidiairement
– ordonner une expertise,
– désigner un expert spécialiste en pédagogie avec mission de :
• décrire les extraits du cours reproduit dans le filin litigieux et les bonus DVD,
• décrire la composition et les enchaînements des différents enseignements donnés simultanément par l’instituteur,
• identifier et recenser les choix effectués par l’instituteur quant aux méthodes pédagogiques, quant aux matière enseignées, exercices, textes littéraires, etc,
• fournir tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des dits extraits;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2006 aux termes desquelles Nicolas PHILIBERT, Philippe HERSANT, la société MAÏA FILMS, la société LES FILMS D’ICI, la société LES FILMS DU LOSANGE et le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP) prient la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes sesdispositions et y ajoutant, de condamner Georges LOPEZ à leur verser chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 février 2006 par lesquelles la société CANAL PLUS sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris sauf en l’ensemble deses dispositions fondées sur les articles 700 et 696 du nouveau Code de procédure civile, réclamant à ce titre la condamnation de Georges LOPEZ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à titre subsidiaire,la garantie de la société MAIA FILMS ;
Vu les ultimes conclusions signifiées le 8 février 2006 par lesquelles la société ARTE FRANCE ClNÉMA demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de prononcer sa mise hors de cause, à titre subsidiaire de
– condamner la société MAIA FILMS à la relever et garantir de toutes condamnationsprononcées à son encontre,
– condamner Georges LOPEZ à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement del’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures signifiées le 8 février 2006 par d’une part, la société nationale de télévision FRANCE 2, d’autre part, la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION, qui prient la Cour de débouter Georges LOPEZ de son incident de communication de pièces, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux articles 700 et 696 du nouveau Code de procédure civile, à titresubsidiaire de :
– condamner les sociétés MAIA FILMS et les FILMS DU LOSANGE à les garantir contretoute condamnation prononcée à leur encontre, s’agissant de la société FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION au titre de l’exploitation des spots publicitaires qui lui ont été fournis en vue de l’exploitation des vidéogrammes litigieux,
– condamner les sociétés MAIA FILMS et les FILMS DU LOSANGE à verser à chacuned’elles la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code deprocédure civile,
-en toute hypothèse, condamner Georges LOPEZ à verser à chacune d’elles la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2006 par lesquelles Maître GéraldAYACHE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MERCUREDISTRIBUTION, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation deGeorges LOPEZ à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700dunouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 9 février 2006 aux termes desquelles la sociétéTELERAMA, après avoir demandé à titre liminaire sa mise hors de cause, prie laCour,à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, de dire que lasociété FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION sera tenue de la garantir de toutes lesconséquences de l’action diligentée contre elle par Georges LOPEZ et detoutes les condamnations principales et accessoires qui seraient prononcées à son encontre et entoutétat de cause, de condamner Georges LOPEZ à lui verser la somme de 5.500 euros HT surle fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les ultimes conclusions signifiées le 13 février 2006 par lesquelles 1’AFPF demande
à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Georges LOPEZ aux dépensde première instance et d’appe1 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 février 2006 aux termes desquelles l’USPA prie la Cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de confirmer le jugement déféré et de condamner Georges LOPEZ aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu’autorisé par l’inspection d’Académie du Puy-de-Dôme, Nicolas PHILIBERT, réalisateur de films documentaires, a, entre le mois de décembre 2000 et lafin du mois de juin 2001, procédé au tournage du film ayant pour titre « Etre et avoir »relatant le quotidien de la classe unique de l’école d’un village de moyenne montagne,située à Saint Etienne sur Usson (Puy-de-Dôme), regroupant autour de l’instituteur,Georges LOPEZ, une dizaine d’élèves de la maternelle au CM2 ; que la distribution dufilm, coproduit par la société MAIA FILMS, la société LES FILMS D’ICI et la société ARTEFRANCE CINEMA, a été confiée à la société LES FILMS DU LOSANGE et à la société MERCURE .DISTRIBUTION ;
Que ce film documentaire a été présenté au Festival de Cannes au mois de mai 2002, puisest sorti en salles fin août 2002 ;
Que Georges LOPEZ ayant accepté de participer à la promotion du film durant le mois deseptembre 2002, la société les FILMS DU LOSANGE lui a proposé, par lettre du 16septembre 2002, en complément des défraiements versés pour couvrir ses frais dedéplacement à Paris, des indemnités au titre des interviews données ou à venirpour la promotion du film, que cette proposition n’a pas été acceptée par Georges LOPEZ qui, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicite de la société LES FILMS DU LOSANGE, laconclusion d’un contrat de travail, qui lui a été refusé ;
Que c’est dans ces circonstances que Georges LOPEZ a, le 14 février 2O03, saisi le Conseilde Prud’hommes de Perpignan, qui, par jugement du 5 novembre 2003 s’est déclaréincompétent, relevant l’absence de lien de subordination révélateur d’un contratde travail ; que ce jugement a été confirme, par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 31 mars2004 ;
Que parallèlement à cette procédure, il a assigné devant le tribunal de grande instance deParis Nicolas PHL1BERT réalisateur du film, Philippe HERSANT, auteur de la musique,la société MAIA FILMS, la société LES FILMS D’ICI, la société ARTE FRANCE CINEMA,co-producteurs, la société LES FILMS DU LOSANGE et la société MERCURE DISTRIBUTION représentée par son liquidateur Maître AYACHE, en qualité de distributeurs, la seconde en charge des ventes internationales, la société FRANCETELEVISION DISTRIBUTION et la société TELERAMA, en qualité de diffuseurs des vidéocassettes et DVD tirés du film, la société nationale de télévision FRANCE 2, diffuseur de spots publicitaires comportant des extraits du film et la société CANAL PLUS,diffuseur du film sur la chaîne de télévision éponyme, en paiement de dommages et intérêts pour contrefaçon et violation de son droit à 1’imge, au nom et à la voix ;
Que le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), l’USPA et I’AFPF sontintervenus volontairement dans l’instance ;
• Sur la demande de communication de pièces formée par Georges LOPEZ
Considérant que Georges LOPEZ sollicite la communication des 60 heures de rushes réalisés pour le montage du film, objet du litige, de l’extrait du film diffusé sur les chaînesde télévision pour sa promotion ainsi que de l’ensemble des contrats d’exploitation desdroits d’auteur conclus avec les coauteurs du film, des contrats conclus avec lesproducteurs ainsi que des relevés des droits perçus par les sociétés d’auteur concernées ;
Mais considérant qu’il ne démontre pas en quoi le visionnage des rushes permettrait dedéterminer la qualité de coauteur et d’artiste interprète qu’il revendique dès lors que cespassages ont été exclus du film ; que cette demande doit donc être rejetée ;
Considérant par ailleurs, que la communication des autres éléments d’ordre comptableapparaît prématurée avant que soit tranchée la question de la qualité d’auteur ou d’artiste interprète de Georges LOPEZ ;
• Sur la recevabilité des interventions de I’USPA et de L’AFPF
Considérant que Georges LOPEZ, faisant valoir que l’action qu’il a engagée ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif des producteurs d’oeuvres audiovisuelle et qu’au contraire l’action syndicale ne peut consister en la défense de membres de la profession qui se voientreprocher des actes de contrefaçon et la violation des droits de la personnalité, soulèvel’irrecevabilité de l’intervention de 1’USPA et de l’AFPF ;
Considérant que l’USPA, organisme constitué sous forme de syndicat professionnel, qui regroupe les producteurs d’oeuvres audiovisuelles destinées à la télévision, quel que soitleur genre, notamment documentaires, a, aux termes de l’article 2 de ses statuts, pour objet« de représenter leurs intérêts professionnels nationaux et internationaux » ; que la société LES FILMS D’ICI, mise en cause par Georges LOPEZ, est membre de ce syndicat ; que le Conseil syndical du 2 décembre 2303 a mandaté l’USPA pour intervenir aux côtés deson adhérent dans le présent litige, relevant qu’il pose « des questions d intérêts collectifspour les producteurs » ;
Considérant que l’AFPP est, aux termes de ses statuts, un syndicat professionnel qui a pour objet de « rassembler les entreprises de production de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ou multimedia et de défendre les intérêts économiques, matériels ou moraux de cette profession » ; qu’ensuite d’une réunion de son conseil d’administration du 25 mars 2004, son président a été mandaté pour faire intervenir volontairementl’association dans la présente procédure, afin de faire valoir la défense des intérêtséconomiques, matériels et moraux des producteurs de films et programmes audiovisuelsqui sont en jeu ;
Considérant que conformément à l’article L 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels ont qualité et intérêt à intervenir dès lors que le litige soulève une questionde principe dont la solution est de nature à porter un préjudice même indirect a l’intérêt collectif de la profession ;
Considérant, en l’espèce, que le litige porte sur le point de savoir si une personne filmée dans le cadre d’un film documentaire peut ou non se prévaloir de la qualité de coauteur etprétendre à une rémunération à ce titre ;
Qu’il s’agit donc d’une question de principe qui met en jeu l’intérêt collectif de la profession des producteurs d’oeuvres audiovisuelle du genre documentaire ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention deces deux syndicats ;
• Sur le fond
Considérant que la Cour a, en présence des parties et de leurs conseils, assisté à laprojection du film « ETRE ET AVOIR », objet du litige ;
* Sur l’atteinte aux droits d’auteur invoqués par Georges LOPEZ sur son cours oral
Considérant que Georges LOPEZ, énumérant dans ses écritures les extraits de la leçon oudu cours donné à ses élèves, reproduits dans le film litigieux et le bonus DVD intitulé« Récitations », se prévaut, en premier lieu, « d’une oeuvre orale, fruit de son expérience d’enseignant, de ses réflexions sur son métier, sur la psychologie et le comportement des élèves, de ses recherches, de ses choix quant aux méthodes d’enseignement, de ses choixquant à la nature des textes littéraires et des exercices proposés » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L. l 12-2-2 du Code de la propriété intellectuelle que le cours oral d’un enseignant peut, au même titre qu ‘une conférence, uneallocution, un sermon ou une plaidoirie, être considéré comme une oeuvre de l’esprit, dèslors qu’il répond au critère d’originalité ;
Considérant que le film « ETRE ET AVOIR » retrace la vie d’une classe unique pendant sixmois, au fil de trois saisons, hiver, printemps et été, qui rythment l’ambiance des leçonset le travail quotidien du village rural de moyenne montagne dans lequel elle se situe ;
Considérant que la mise en images des leçons de l’instituteur, Georges LOPEZ, constitue à l’évidence une composante essentielle du film, même si les scènes de cours, qui s’enchaînent naturellement avec l’arrivée des élèves, les recréations, et le retour à lamaison s’accompagnant, pour les élèves aînés, des travaux de la ferme, se fondent dansl’oeuvre audiovisuelle ; que si sa compétence dans la transmission du savoir alliée à sapersonnalité charismatique, empreinte d’une autorité bienveillante, transparaît dansl’organisation de son enseignement, la composition et l’enchaînement de ces cours ne mettent en oeuvre aucune méthode pédagogique originale, mais répondent à l’objectif impératif de s’adapter aux trois groupes d’élèves de niveaux différents regroupés danscette classe unique ;
Que les passages filmés des leçons ne révèlent pas davantage, au regard des programmes imposés, un choix inédit des exercices et des textes qui soit en lui-même protégeable parle droit d’auteur ; que par-delà la mise en image de ces leçons, le réalisateur du films’attache à communiquer au spectateur un ensemble de relations complexes entre lesélèves, le maître, les familles, qui participent de la transmission des règles nécessaires à toute vie en communauté ; que si la plupart de ces échanges en forme de dialogues entrele maître et les élèves contribuent à l’acquisition des connaissances et font à ce titre partieintégrante du cours, ils ne présentent pas une originalité suffisante pour accéder austatut d’oeuvre de l’esprit ;
Que le jugement entrepris doit donc confirmé en ce qu’il a débouté Georges LOPEZde sa demande de reconnaissance d’un droit d’auteur sur les cours reproduits, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée ;
* Sur les droits d’auteur de Georges LOPEZ sur l’oeuvre audiovisuelle
Considérant que Georges LOPEZ revendique, en deuxième lieu, la qualité de coauteur del’oeuvre audiovisuelle que constitue le film, en ce que :
– il est intervenu dans le choix des séquences filmées,
-.il est auteur du texte parlé ;
Considérant à titre liminaire que le film en litige relève du genre documentaire, ce qui n’est pas contesté par Georges LOPEZ, dont l’objet est de filmer des personnes qui ne jouent,ni ne suivent des scénarios, mais accomplissent devant la camera leur tâche oufonctionhabituelle, simple transcription de la réalité ; qu’il ressort des extraits d’interviews, produits aux débats, donnés par des réalisateurs de films documentaires, qu’iln’est pasdans les usages de prévoir une rémunération pour les intervenants, afin de préserverl’authenticité des scènes filmées, ce que confirment L’USPA et I’AFPF ; qu’il convient derelever à cet effet que Georges LOPEZ n’a, ni en cours de tournage, ni a l’issue de celui-ci,sollicité de rémunération en contrepartie de sa participation au documentaire, mais aattendu le succès populaire rencontré par le film dès sa sortie en salles ;
Considérant, sur la première revendication formée par l’appelant, que les pièces produitesaux débats établissent que Nicolas PHILIBERT a conçu le projet de réaliser ledocumentaire litigieux, sur le thème « d’une classe à la campagne et si possible une classeunique » dès le mois de juin 2000 ; qu’ainsi dans une lettre datée du 27 juin 2000 adresséeà l’inspectrice de l’Académie de Mende, il décrivait en ces termes ce projet :
« Ce film raconterait la vie au quotidien de cette petite communauté, ses hauts et ses bas,ses difficultés et ses joies, et ce sur une longue période. Il ne s’agit pas d un reportage téléoù le réalisateur vient «traiter un sujet» en sachant à l’avance ce qu’il va ou doit montrer, pour illustrer un discours tout fait » ; que le 25 septembre 2000, dans une correspondanceadressée à l’inspection Académique de Corrèze, il annonce que son souhait est « de raconterjour après jour l’histoire d’une classe, une histoire dont ni moi ni personne ne connaîtencore les méandres et les rebondissements » ; qu’il remettait à l’Inspecteur d’Académie duPuy-de-Dôme un texte de 11 pages sur ce projet, le 20 novembre 2000 ;
Qu’il s’ensuit que le choix du sujet, relater la vie quotidienne d’une classe unique, appartient à Nicolas PHILIBERT seul ;
Que le fait que Georges LOPEZ disposait du pouvoir d’intervenir sur les séquences filmées, intrusion inhérente à la spécificité du tournage (exercice d’une mission de servicepublic, présence de jeunes enfants), n’implique pas qu’il ait participé à la conception del’oeuvre dans sa composition : plan du tournage, choix des situations filmées, des images et du cadrage ; que 1e caractère limité de ses interventions ressort de l’interview qu’il a accordée, le 28 août 2002, au quotidien «LA CROIX», dans laquelle il a déclaré s’être « très vite accoutumé à la présence de la caméra de Nicolas PHIL IBERT et de son équipe qui se sont fondus dans notre univers sans rompre ni déranger nos habitudes » ; qu’il ne justifiepas davantage être intervenu dans le montage du film ; qu’ainsi, dans l’ouvrage intitulé»Les petits cailloux», publié sous son nom aux Editions STOCK, il raconte avoir assistéau montage du film et découvert la version achevée, « la rusticité des premières images,déplorant l’absence de prises auxquelles il avait assisté en spectateur pendant le tournage » (pages 299 et 300) ;
Considérant, sur sa revendication d’auteur du texte parlé, au sens de l’article L. 113-7-3 du Code de la propriété intellectuelle, que les leçons qu’il professe comme les dialoguesavec les élèves s’inscrivent dans l’exercice de ses fonctions d’instituteur, chargé de mettreen oeuvre les programmes définis par l’Education nationale et n’ont pas été conçues pourles besoins de l’oeuvre audiovisuelle ; qu’il en est de même des propos échangés tant avecles élèves qu’avec leurs parents concernant le quotidien de leurs enfants, dont laspontanéité révèle qu’ils ne sont pas le fruit d’une création préexistante ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Georges LOPEZ de sademande tendant à lui voir reconnaître la qualité de coauteur d’une oeuvre audiovisuelle ;
* Sur l’atteinte aux droits voisins
Considérant que Georges LOPEZ revendique, en troisième lieu, des droits d’artisteinterprète sur l’exécution qu’il a faite de son cours, faisant valoir qu’il a joué à la demandedu réalisateur des scènes purement «fictionnelles» ;
Mais considérant que la scène fugace du film relatant la disparition de l’enfant Alizé dansun champ de blé, dont l’issue n’est d’ailleurs pas révélée, ne saurait suffire pour qualifierce film documentaire d’oeuvre de fiction ; qu’en effet, Georges LOPEZ ne dément pas lesaffirmations du réalisateur selon lesquelles l’enfant se cachait fréquemment sous la tablepour jouer, de sorte que cet épisode s’inscrit naturellement dans le quotidien de la classe ;que surtout, tout au long de ce documentaire, il a été filmé dans l’exercice de sa professiond’instituteur ainsi que dans le cadre d’une interview au cours de laquelle il évoque sesorigines familiales et sa vocation d’enseignant, et non comme interprète d’un rôle qui neserait pas le sien, au service d’une oeuvre ; que les premiers juges ont exactement relevéque ces données, qui reflètent un exercice professionnel et un statut social, relèvent du faitdocumentaire qui, par son rapport au réel, tel qu’il a été conçu dans les arts cinématographiques, exclut la notion d’interprétation au sens de l’article 212-l du Codede la propriété intellectuelle ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Georges LOPEZ de sesdemandes sur ce fondement ;
* Sur l’atteinte aux droits de la personnalité
Considérant que Georges LOPEZ fait valoir, en quatrième lieu, que l’exploitation commerciale du documentaire sur différents supports commerciaux et publicitaires porte atteinte au droit dont il dispose sur son image, son nom et sa voix ; qu’il expose à cet effet que la seule autorisation de diffusion que l’on pourrait déduire du fait qu’il a autorisé letournage du film dans sa classe consiste en une diffusion à des fins purementpédagogiques, réservée exclusivement à l’usage interne de l’Education Nationale ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges aprèsavoir relaté la rencontre entre Georges LOPEZ et le réalisateur, Nicolas PHILIBERT, aucours de l’automne 2000, l’acceptation du tournage par l’inspecteur de l ‘Académie du Puy-de-Dôme, relevé la durée du tournage (9 mois) et l’interview accordée par Georges LOPEZintégrée dans le film, ont justement estimé que ce dernier avait consenti à la reproductionde son image ;
Considérant que Georges LOPEZ ne pouvait se méprendre sur la diffusion du
documentaire, à des fins autres que purement pédagogiques, dès lors qu’il savait, dès sarencontre avec le réalisateur, qu’il n’était pas réalisé à l’initiative de l’Education Nationale ; que dès le 16 janvier 2001, dans une lettre adressée au ministre de 1’Education Nationale,la société MAIA, coproducteur du film mentionnait qu’il s’agissait d’un film long-métragedocumentaire prévu pour une exploitation cinématographique en salle ; qu’il ne pouvaitdonc à l’évidence ignorer que ce documentaire était réalisé pour le cinéma ; que lespremiers juges ont, par ailleurs, souligné la présence de Georges LOPEZ accompagné deses élèves et de leurs parents, lors de la projection du film à Clermont-Ferrand en avril2002, à la séance spéciale du Festival de Cannes lors dela présentation du film en mai2002, sa participation à la promotion du film entre le 25août et le 3 octobre 2002 ainsi queses déclarations à la presse, notamment dans le quotidien «le Républicain Lorrain»du 18septembre 2002 où il se réjouit du succès remporté par le film dès sa sortie en salles,ajoutant « qu’il est attendu dans le monde entier, au Japon, au Brésil » ; qu’ils en ont déduità juste titre le consentement tacite mais non équivoque de Georges LOPEZ à la diffusionde son image par le biais de ce film ;
Qu’il ne justifie pas qu’au cours des discussions qu’il a engagées pendant la période depromotion du film, à compter du 24 août 2002, il se serait plaint de l’ampleur de ladiffusion, les propositions avancées concernant exclusivement la cession du droit à l’imagesur les interviews réalisées dans le cadre de l’exploitation du film ;
Considérant que Georges LOPEZ se plaint en outre des autres exploitations commercialesdu film ;
Mais considérant qu’il est d’usage de diffuser en vidéocassettes et DVD, puis à latélévision, un film couronné de succès lors de sa sortie en salle, ce qui est le cas enl’espèce ; qu’en outre, Georges LOPEZ ne rapporte pas la preuve que ces modes dedistribution et de diffusion lui porteraient préjudice, dès lors qu’il est démontré qu’il aconsenti sans équivoque à l’utilisation de son image pour les besoins du film;
Considérant que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ontestimé à juste titre que la bande annonce du film, présente dans le DVD et diffusée parextraits à la télévision, est constituée de séquences qui comportent des courts extraits desscènes marquantes du film, sans modification, ni ajout, conformément aux usages en lamatière ; que relevant que ce moyen de promotion ne contrevient pas aux circulairesministérielles visées par l’inspecteur d’Académie du Puy-de-Dôme, qui proscrivent touteexploitation purement mercantile ou contraire aux intérêts du service public, ils ont concluexactement que cette diffusion ne portait pas atteinte au droit que détient Georges LOPEZsur son image, son nom et sa voix ;
Que Georges LOPEZ ne saurait faire grief aux intimés d’avoir intégré dans le DVD ledocumentaire tourné lors du Festival de Cannes le montrant en compagnie de ses élèveset de leurs parents, événement largement relaté par la presse ; qu’en effet, durant cettepériode, il participait activement à la promotion du film comme il l’a déclaré au quotidien»Libération» du 22 mai 2002 dans ces termes :
« La participation aux avant-premières et aux débats, les rencontres avec la presse vont rendre la transition moins brutale . Ce sera ma rentrée à moi » ;
Que le livret inclus dans le DVD ne présente aucun élément étranger au film ;
Que, par ailleurs, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, le Ministère de1’Education Nationale n’a formulé aucune objection, ni revendiqué aucun droit à l’encontrede ces multiples exploitations du film ;
Que Georges LOPEZ est donc mal fondé à se prévaloir d’une quelconque atteinte auxdroits qu’il détient sur son image, son nom et sa voix ;
Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Georges LOPEZ de l’ensemble de ses demandes ;
– Sur les autres demandes
Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civiledoivent bénéficier à chacun des intimés ; qu’il sera donc alloué à ce titre la somme de1.000 euros à Nicolas PHILIBERT, Philippe HERSANT, la société MAIA FILMS, lasociété LES FILMS D’ICI, la société LES FILMS DU LOSANGE et le CNDP, soit au total 6.000euros ; la somme de 1.000 euros à la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION,la société nationale de télévision FRANCE 2, la société CANAL PLUS, la société ARTEFRANCE CINEMA, la société TELERAMA et à Maître Ayache en qualité de liquidateurde la société MERCURE DISTRIBUTION, à chacun d’eux ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé exclusivement à la charge de GeorgesLOPEZ les frais d’actes d’huissier qu’il a fait dresser et à la charge des autres parties lesfrais répétibles qu’elles ont exposés en première instance ;
Qu’en revanche, Georges LOPEZ sera condamné aux entiers d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de communication de pièces formée par Georges LOPEZ,
Déboute Georges LOPEZ de sa demande d’expertise,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Georges LOPEZ à verser sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes suivantes :
– 1.000 euros à Nicolas PHILIBERT, Philippe HERSANT, la société MAIA FILMS, lasociété LES FILMS D’ICI, la société LES FILMS DU LOSANGE et le CNDP, soit au total6.000euros,
– 1.000 euros à la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION, la société nationale de télévision FRANCE 2, la société CANAL PLUS, la société ARTE FRANCE CINEMA, lasociété TELERAMA, et à Maître AYACHE en qualité de liquidateur de la société MERCURE DISTRIBUTION, à chacun d’eux ;
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Georges LOPEZ aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformémentà l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Cour d’Appel de Paris4ème Chambre, section A
Lettre à Nicolas Philibert, par Pascal Thomas / Le Nouvel Observateur, 23 octobre 2003
Le 8 octobre 2003, « L’affaire Etre et avoir » éclate dans la presse. Quelques jours plus tard le cinéaste Pascal Thomas, Président de la Société des Réalisateurs de Films (SRF) prend sa plume et écrit à N.Ph. Cette lettre paraîtra peu après dans « Le Nouvel Observateur ».
Cher Nicolas,
Je comprends ton étonnement et ta déception. Connais-tu cette définition de Bonaparte par Pierre Larousse dans sa première édition du Larousse du XIXe siècle : « Bonaparte, général de la Révolution, mort le 18 brumaire… » ?
C’est un peu ce qui arrive à ton personnage, oui je dis bien personnage, je n’arrive pas à désigner autrement les protagonistes des documentaires, encore moins celui de ton film, tant il apparaît aujourd’hui que tu l’as rêvé : « Monsieur Lopez, instituteur idéal, dont le portrait a été réalisé par le cinéaste documentariste Nicolas Philibert pour le film Être et avoir, DISPARU en automne 2003 dans la fange des comportements judiciaires à l’américaine introduits en France depuis une dizaine d’années. »
Il était un maître, le Maître. Le voilà suiveur d’avocaillons. Il forçait le respect. Il ne fera plus bonne figure dans notre Panthéon. Monsieur Lopez, l’instit, n’est plus. Monsieur Lopez est un autre. Comme toute mort, comme tout crime, celui-ci, détaché de toute littérature, ne comporte rien d’inédit. En matière de cinéma, une réussite éclatante s’accompagne toujours d’un certain déni, et il n’est pas rare qu’une réussite d’abord indiscutée ne finisse, avec le triomphe, par subir des attaques d’une bassesse et d’une violence qui doivent appartenir à une sorte de déontologie non écrite du coup de pied de l’âne.
Et bien, mon cher Nicolas, tu y es. Le coup est venu. Et comme toujours, certainement pas d’où tu l’imaginais venir ni de celui que ta bonne nature ne pouvait certainement pas concevoir.
Nous ne sommes plus au temps où le philosophe Emile Chartier, dit Alain, autorisait la publication de ses cours, à la condition expresse qu’on ne l’embête pas avec les droits d’auteur. Ses émoluments de professeur lui suffisaient. Et l’arrivée de sommes inattendues aurait troublé le mode de vie qui lui convenait une fois pour toutes.
Ce qui paraît déplacé et choquant dans votre conflit, c’est la menace qu’il fait planer sur l’ensemble de la création documentaire par cette prétention à vouloir être co-auteur d’une œuvre quand on n’en a été que le modèle. La nouveauté, l’obscénité, le scandale sont là.
Quand le frère de James Joyce, après Ulysse, ou quand les habitants de Guéret, après la publication de Chaminadour, ont cherché à tirer parti de ces situations pour obtenir de l’argent, ils se cantonnaient dans le domaine des dommages et intérêts. Ici, on revendique une sorte de droit du modèle à être co-auteur, ce qui est absurde et mettrait en péril tout un pan de ce qui fait la substance même du cinéma et sa part la plus intéressante, celle qui se nourrit du réel.
Comment a-t-on pu en arriver là ?
À mon avis par l’ignorance, l’incompétence crasse du discours sur la création cinématographique même de ces dernières années. Et là, j’y mets tout le monde : productions, commentateurs, scénaristes hors d’eux dans leur prétention à vouloir être les auteurs des films, et même certains réalisateurs trop soumis à cette idée fausse.
Si on continue à accréditer cela, la boîte de Pandore est ouverte. Toutes les dérives peuvent s’y engouffrer. Or un film, c’est sur l’écran que cela se passe. Pas ailleurs, Ce n’est ni le prétexte, ni le scénario, ni les dialogues, ni l’acteur, ni le montage, ni le type de production. Un film c’est ce qu’on voit sur l’écran, qui y a été amené par une seule personne, le réalisateur. Et on ne doit pas sortir de là. Les films ont beau être faits par des gens qui adorent le compagnonnage d’une équipe, la création naturelle d’un tournage, tout ce qui contient la fabrication du cinéma, ce refuge de l’artisanat, seul le metteur en scène, le réalisateur est maître de sa création.
Encore plus dans la voie périlleuse que tu as choisie, celle du documentaire, qui réclame des yeux bien ouverts, une attention infinie, beaucoup d’intuition, de l’adresse et de l’humilité artisanale.
Je termine. L’histoire du cinéma repose sur deux courants fondamentaux, deux lignes de force. Il arrive que celle dans laquelle s’inscrit ton cinéma – la représentation du réel – s’intéresse à des individus, célèbres ou anonymes, exceptionnels ou modestes, autant pour dégager la singularité de leur personnalité que pour observer dans leur comportement et leur milieu ce qu’ils ont à nous révéler de l’homme en général.
C’est le cas de ce film. Ton œil, celui du réalisateur, a choisi de retenir et de composer avec ce qu’il y avait de meilleur dans ton modèle. Ta foi en l’homme a laissé de côté ce qui te paraissait le plus mauvais. Il est aujourd’hui dans les officines d’avocats. Il n’a rien à revendiquer de ce travail. La Joconde n’a pas peint la Joconde. Ni les chirurgiens de la leçon d’anatomie, les chirurgiens de la leçon d’anatomie. Ni Monsieur Lopez dans sa classe multiple à l’ombre des monts du Livradois, Monsieur Lopez dans sa classe multiple à l’ombre des monts du Livradois. Ces monts du Livradois d’où nous venait Maurice Pialat qui aurait certainement très mal pris, lui qui dans sa pratique travaillait comme un documentariste, qu’une telle mésaventure vienne à lui.
Voilà mon cher Nicolas ce que je pouvais te dire aujourd’hui. Mais j’ai encore de la réserve. Saches en tous cas que la SRF (Société des Réalisateurs de Films) et tous ses réalisateurs te soutiennent.
Bien à toi.
Pascal Thomas, le 13 octobre 2003
À Nicolas P., documentariste, qui a connu le meilleur et le pire, par Alain Bergala / Les Cahiers du cinéma n° 592 – Juillet/août 2004
Cher Nicolas
Quelle peine j’ai éprouvée l’autre soir, devant ma télévision, au journal de 20 heures en tombant sur un sujet à propos du procès Être et avoir. Sujet plein de sous-entendus, un peu goguenard sur la fin, fondé sur une idée reçue démagogique : les gens de cinéma sont tous des pourris, toujours prêts à exploiter les innocents, c’est à dire les gens comme vous, téléspectateurs anonymes et moyens. Vous voilà, toi et Gilles Sandoz, assimilés par la télé à des gens de cinéma douteux, ayant abusé d’un instituteur et d’enfants innocents pour faire cyniquement de l’argent sur leur dos. On est en plein cauchemar médiatique. La réalité, que j’ai connue en direct, c’était un producteur très isolé, sans arrières, mettant toute son énergie et le peu d’argent dont il disposait pour te permettre de faire ce film dans les meilleures conditions possibles. C’est à dire avec du temps devant toi pour faire un travail sérieux, fondé sur la durée et sur des rapports de confiance réciproques et patiemment établis avec ceux que tu filmais. Le contraire absolu d’un « coup de cinéma » ce film a été fait comme devraient l’être tous les films, en pensant à lui comme à quelque chose de fragile, à protéger et à aimer à deux, le cinéaste et le producteur.
Personne, pendant ces mois de travail, loin de tout calcul médiatique, n’a jamais pensé une seconde que ce film pourrait être un succès public. Tout ce qui se plaide aujourd’hui dans les cours justice contre vous relève de la canaillerie pure et simple, de la mauvaise foi et de la cupidité la plus basse. J’espère que la honte en rejaillira sur ceux par qui le scandale est arrivé, mais le vrai scandale est évidemment ailleurs.
Les parents déclarent qu’ils font ce procès pour que leurs enfants, devenus adultes, ne se retournent pas contre eux en les accusant de ne pas avoir défendu leurs intérêts. Il y a pour le moins un «malaise dans la civilisation » si des parents d’aujourd’hui, en France, regardent leurs rejetons comme de futurs ennemis qui vont leur faire des procès plus tard. Il va leur falloir dorénavant consulter un avocat chaque fois qu’ils doivent prendre en tant que parents une décision d’éducation pour leurs enfants. Comment peut-on assumer son rôle de parent dans un tel état d’esprit? Mais se sont ils seulement demandé comment leurs enfants les considèrent aujourd’hui lorsqu’ils les voient renier ce qui a été leur attitude pendant deux ans. Car ils doivent bien mesurer avec leur expérience d’enfant, à quel point les arguments new look de leurs parents sont fallacieux et de flagrante mauvaise foi, eux qui ont pu évaluer ton attitude de cinéaste à leur égard, durant le tournage. Puisque ce sont bien les mêmes, ces parents, que ceux que j’ai vus à Cannes, ravis d’être là, légitimement fiers de leurs fistons et fifilles, heureux de l’accueil du public et des journalistes de tout poil. Mais c’était avant le succès public et commercial du film, l’un des plus inattendus des vingt dernières années dans le cinéma français, sans la moindre préméditation, je peux en témoigner. Quand je suis très pessimiste, je pense qu’avec un autre maître, d’autres parents et d’autres enfants il se serait passé la même chose après un million et demi d’entrées. Quand je reprends un peu espoir, je me dis que tu t’es humainement trompé sur le choix de cet instituteur, et qu’un autre n’aurait peut-être pas cédé aux sirènes de la renommée, des médias et du fric. Mais comment se poser la question d’une future célébrité possible des participants quand on entreprend un film comme celui ci ? Pour le coup cette démarche deviendrait calculatrice, ce qui est à mille lieux de ta personnalité. Ce que tu paies de la plus injuste des suspicions, finalement, c’est de ne pas avoir été assez suspicieux.
Le plus grave, à mes yeux, dans toute cette sinistre affaire, c’est que ces parents ont gâché à vie, pour ces enfants au nom desquels ils attaquent, une expérience d’enfant qui a été une chance unique et formidable rencontrer le cinéma à travers un cinéaste comme toi. Il n’y a qu’un vrai préjudice, bien réel celui là et irrémédiable, c’est celui que ces parents, bien mal inspirés, sont en train d’infliger moralement à leurs enfants. Je ne voudrais pas être dans leur peau ni dans celle de l’instituteur qui a à peu près tout bradé dans cette histoire son image, ses convictions, sa dignité d’homme et d’enseignant. Mais qui peut encore prêter foi à quelqu’un qui pendant des mois était en train d’engager concrètement un procès tout en continuant à aller présenter avec chaleur un peu partout le film, en n’en disant que le plus grand bien?
Bientôt, sur les photos de classe, il manquera, au nom du droit à l’image, les enfants dont les parents n’auront pas signé le contrat avec le photographe local, au cas où, trente plus tard, l’un d’entre eux, devenu riche et célèbre, exploiterait l’image des autres en publiant cette photo de classe prise en CM2. Le règne tyrannique jusqu’à l’absurde du droit individuel à l’image a comme envers complice l’accélération du cynisme dans l’exploitation des mêmes individus par la télévision. Cette défense maniaque et préventive d’un pseudo respect de la personne n’est en fait qu’une « marchandisation » des êtres humains comme valeur d’échange : «Vous valez de l’argent ! Ne le laissez pas perdre ! » Il suffit de regarder n’importe quel public de plateau de jeu ou de variétés à la télévision pour mesurer à quel point cette liberté glapie par tous s’accompagne d’une ignoble aliénation des mêmes individus, à qui les médias font accepter avec le sourire leur propre humiliation et la perte consentie de leur dignité. Que toi avec les films que tu as faits avant dans la plus grande discrétion, sans le moindre carriérisme, dans la précarité que connaissent la plupart des vrais documentaristes en France tu te retrouves à devoir te défendre contre cet instituteur et les parents de ces enfants que tu as filmés avec la plus grande honnêteté à un moment où la télévision ne devient que mépris, manipulation et crétinerie relève moralement et intellectuellement d’une sinistre farce et d’un grave symptôme de l’époque.
Dans ce sujet du 20 heures, un mot blessant a été lâché. Tu aurais «bidonné» certaines scènes du film. Tu as demandé à des enfants de garder plusieurs jours de suite le même pull over, tu as proposé pour la scène des devoirs du soir à la maison une autre opération que celle du maître. J’en passe et des plus grotesques, il faudrait un Molière pour en faire un texte comique. On devrait montrer en boucle Nanouk l’esquimau à ceux qui vont avoir à juger ce procès, ou même seulement la construction de l’igloo, s’ils sont pressés. J’imagine que pour les plaignants être documentariste consiste à filmer planqué, sans interagir sur ce et ceux que l’on filme, dans une sorte de reportage caméra cachée. Heureusement pour toi et pour le cinéma, tu es convaincu avec d’autres documentaristes français (Denis Gheerbrant, Claire Simon, Jean Louis Comolli, Raymond Depardon, et quelques autres…) qu’une caméra voyeuse, non intervenante, ne peut saisir que l’apparence superficielle des êtres et des situations. La vérité, c’est autre chose, ça se travaille, ça se mérite, et ça passe forcément par l’affirmation calme de la place du cinéaste et de la présence de la caméra, par une relation affirmée au filmé. Ce qui est extraordinaire dans ces mauvais procès, c’est que ce sont précisément tes qualités de cinéaste que l’on te reproche. Tu es attaqué de n’avoir pas fait un mauvais reportage télé sur cette classe et ces personnes.
Cette histoire prouve en tout cas que le documentaire, quand c’est un vrai documentaire, agit toujours sur ceux qui y prennent part, d’un côté ou de l’autre de la caméra, comme un événement de leur vie : ce n’est pas rien d’avoir (et de voir) une image de soi exister sur un écran dans un vrai film. Cela devient forcément quelque chose qui compte dans la vie de quelqu’un. Il n’y a qu’une alternative : ou bien demander aux filmés de livrer devant la caméra la seule prestation attendue de leur rôle (par exemple « l’inondé pour la troisième fois » ou « le vacancier bloqué en gare par les grèves » des journaux télévisés, qui connaît par coeur son texte et son rôle pour l’avoir lui même vu jouer des dizaines de fois à 20 heures 27 sur son petit écran), ou bien prendre en compte le tournage comme une situation vivante mettant enjeu des personnes dans un contrat intersubjectif clair où chacun prend le risque de toute relation vivante : en être quelque peu secoué ou transformé. Mais ceci vaut pour toute rencontre dans la vie, le cinéma étant simplement un démultiplicateur d’inscription des émotions.
Aujourd’hui plus que jamais, il ne faut pas céder d’un pouce sur la condition sine qua non pour qu’il y ait encore des documentaires dignes de ce nom dans ce pays : un sujet (au sens d’une personne) ne s’achète pas. Imaginons le jour d’ « épouvante fiction » où avant de filmer sa boulangère ou son grand père, on lui fera signer un contrat progressif lui garantissant tel bénéfice jusqu’à 50 000 entrées, tel autre à 100 000, et tel autre à 1 million. La boulangère va forcément essayer de jouer une boulangère sympathique et pittoresque, susceptible de plaire à 100 000 spectateurs, et le grand père va se prendre aussitôt pour Raimu ou Fernandel. Autant arrêter tout de suite de faire des documentaires, qui ont un besoin vital de la dignité et de l’intégrité des personnes qui en sont les sujets, au deux sens du terme.
Je ne doute pas une seconde que les plaignants vont perdre ce mauvais procès, et à tous les niveaux. Le contraire signerait l’arrêt de mort de cette forme de cinéma qui se pratique simplement sans esbroufe, à hauteur d’homme, et dont nous avons besoin plus que jamais en ces temps de télévision sans foi ni loi où l’information s’éloigne de plus en plus du réel ainsi que du patient et humble travail que nécessite toute approche artistique de la vérité.
Ne te laisse pas trop atteindre, si c’est possible, par toute la vase malodorante soulevée dans cette « affaire », ceux qui connaissent tes films savent bien à quel point tout ceci n’a rien à voir avec ton travail, ni avec celui de Gilles. Que ce soit tombé sur vous, qui avez depuis toujours une morale exigeante dans votre travail, est juste une terrible mauvaise ironie de l’histoire.
Je t’envoie mon amitié et ma totale solidarité.
Alain B.
L'image, Être ou Avoir, une conférence de Marie-José Mondzain
Conférence prononcée à Genève en décembre 2004, et publiée dans le n° 52/53 de la revue « IMAGES documentaires » (1er trimestre 2005).
On imagine aisément qu’une intervention intitulée « l’image être ou avoir » est inspirée par le procès intenté à Nicolas Philibert par Monsieur Lopez instituteur. Comme par un double trait d’esprit, le lieu du film et son titre ont fait de ce procès à proprement parler un cas d’école. Il est aussi remarquable que le titre donné par Nicolas Philibert à son documentaire désigne le point exact d’engouffrement où l’instituteur qui se sentit lésé bascula de la plainte subjective à l’acharnement procédurier et où le juge qui lui donna tort a partagé avec lui un même contresens sur les enjeux de l’image elle même… Être et Avoir sont ce que la grammaire enseignée par Monsieur Lopez appelle des auxiliaires. En la circonstance, ces verbes dont on serait donc en droit d’attendre de l’aide et même du secours sont devenus le double site d’un naufrage intime et d’une confusion juridique. C’est cette confusion qui fera l’objet de mon propos. Le titre du film dans lequel Monsieur Lopez a tourné a fonctionné à plein comme signifiant et a fourni la matière même d’un délire persécutif et d’une réponse juridique qui en a accepté les termes. Lopez a appelé l’auxiliaire de la justice à son secours laquelle a si je puis dire conjugué le litige sur le même modèle que le plaignant même si ce fut pour lui donner tort. Nous ne savons pas dans quels termes Monsieur Lopez exprima sa plainte et ses revendications à son avocat, ce qui est certain, à lire les conclusions du procès, c’est que les termes de la loi offraient à l’avocat de Monsieur Lopez les modalités de formulation de cette plainte et les arguments d’une défense. Ce n’est donc pas de la légitimité d’un état subjectif que je parlerai, mais de l’objectivation de cet état dans son rapport à la loi telle qu’elle existe.
Je rappellerai pour me faire comprendre que lorsque quelqu’un disparaît totalement dans une catastrophe ou un naufrage sans laisser de traces, il est courant d’user de l’expression «disparaître corps et biens». Cette propriété du sujet vivant d’avoir d’une part un corps, un nom et une voix, et d’autre part des biens, permet à la loi de définir et de formuler les conditions juridiques qui assurent la défense de la dignité, la sécurité et la protection des propriétés et des attributs qui déterminent chacun de nous dans le champ de la communauté et cela en termes de droits. Or aujourd’hui la loi a insidieusement mis l’image au rang de cette définition du sujet et de ses attributs. L’image vient réclamer ses droits au même titre que corps et biens. Première confusion donc : l’image est abordée en termes de propriété tantôt du côté de la propriété intellectuelle, elle même indexée sur le régime des avoirs, tantôt du côté des attributs de la personne à l’égal du corps et de la voix qui désignent l’existence de tout sujet vivant. Or si l’on y regarde bien en matière de propriété intellectuelle, le droit ne peut protéger que ce qui est inaliénable, original et de ce fait inimitable… La propriété intellectuelle concerne donc le statut des oeuvres dans ce qu’elles ont d’original et d’inimitable. Or l’image est par nature née sous le signe de la reproductibilité et de la multiplication. Ce qui fait d’une image une oeuvre inimitable ne relève pas de ses composants visibles qui sont toujours reproductibles mais de sa mise en situation dans un dispositif qui lui confère la singularité de son sens. L’image en tant que chose est incontrôlable et doit le rester sous peine de tarir les oeuvres innombrables qui peuvent indéfiniment surgir à partir d’une image. L’image du crucifix n’a pas fini de faire proliférer les figures de la piété et du fantasme et c’est tant mieux. L’Eglise qui protège l’image du crucifix ne peut en aucun cas faire payer des droits sur chaque crucifix reproduit ! Elle ne peut que défendre ce qu’elle estime être le respect de son sens, et l’on sait que même sur ce versant du sens, le débat n’est pas clos. Sur le versant des attributs existentiels du sujet, l’atteinte portée au nom, au corps ou à la voix est une atteinte portée aux composants intrinsèques de la présence du sujet au monde. Chacun de nous a un nom, un seul corps et une seule voix, et ce corps, ce nom et cette voix lui appartiennent et le concernent dans son être de sujet vivant et cela jusqu’à sa mort. Mais qui oserait penser qu’il n’y a de lui qu’une seule image et qui plus est qui disparaîtrait avec lui. De chacun de nous il existe autant d’images que de regards qui se posent sur nous, autant d’images que d’auteurs de ces images qui traitent chacun singulièrement sa façon d’inscrire notre apparition et cela en dépit de notre absence et même au-delà de notre mort. Aucune image de nous ne peut prétendre être la bonne, la vraie, celle qui produit ce qu’il y a en nous d’inimitable et qui nous appartiendrait en propre. La ressemblance comme la dissemblance ne s’étayent que de l’absence du sujet dans son image et de son écart irréductible avec elle. Autrement dit l’image n’a aucun statut ontologique. Il faut donc s’habituer à l’idée que la prolifération des images les rend incontrôlables et de ce fait qu’elles ne peuvent relever des atteintes portées à l’intégrité de la personne. C’est parce que l’on n’est pas son image qu’il est impossible de la défendre comme son corps et son bien. L’auteur de l’image n’est pas celui ou celle dont c’est l’image mais celui qui répond de l’autorité de son regard sur celui dont il fait l’image. Même dans un auto-portrait, il en va de la dépossession de soi dans la figure que l’on en fait. On peut ne pas aimer l’image que l’autre a de nous, et l’on peut refuser ou dénoncer l’usage indigne ou diffamant qui a été fait de son corps sans son consentement. Il est non-recevable que le législateur puisse censurer l’art de la caricature, la parodie, le traitement burlesque ou critique quand il ne s’agit pas de viser le corps mais de donner une figure critique voire violente à une figure symbolique, à une représentation relative. Chaplin dans Le Dictateur donne une leçon décisive à ce sujet: la victime et le bourreau peuvent être joués par un même corps, mais ce corps singulier peut se dédoubler et donc se démultiplier en images contradictoires ou à l’infini. L’image n’a pas de propriétaire et n’est pas une propriété de la personne. Celui dont c’est l’image traverse nécessairement l’épreuve d’une dépossession. L’image n’a pas d’être et n’est pas un avoir. Elle ne désigne jamais ce qui relève de l’être pour chacun de nous non plus que nos possessions.
Eh bien c’est justement au nom de l’être de l’image, conception de l’image à laquelle il croit bien plus qu’à lui même que Monsieur Lopez pense qu’il s’est fait avoir. Or la confusion de Monsieur Lopez qui croit se faire avoir sur ce qui est propre à son être (il s’agit de sa qualité d’auteur et de sa qualité d’acteur) n’a pas été clarifiée par le juge qui a répondu à sa plainte dans les ternies mêmes où il l’avait exprimée. Je dirai plus exactement que la plainte de Monsieur Lopez dont peu d’entre nous ont entendu la voix, a dans les mains de son avocat, pris la forme que la législation en cours pouvait entendre. En effet Monsieur Lopez considérait qu’il avait subi un double dommage puisque sa trop faible rémunération portait atteinte non seulement à ses droits d’auteur mais à ses droits d’acteur, étant donné qu’il se considérait d’une part comme auteur de ses cours et plus généralement de sa pensée, et d’autre part comme acteur du film de Nicolas Philibert et à ce titre dans l’un et l’autre cas propriétaire de l’image qui récoltait tant de succès. Il y aurait donc eu un usage abusif de son talent de pédagogue mais aussi de « son image, de son nom et de sa voix » si je reprends les termes mêmes du jugement qui lui a donné tort. Il intenta ce procès au titre des atteintes portées à ses droits tant par application des dispositions du Code de Propriété intellectuelle que du Code Civil en raison des dispositions qui protègent l’image, le nom et la voix de chacun. Bien heureusement Monsieur Lopez a été débouté et sa plainte a été considérée comme irrecevable. Mais je voudrais revenir sur les termes du jugement au sujet du droit à l’image. Il est écrit : « L’atteinte au droit à l’image ne peut être retenue, Monsieur Lopez ayant donné son accord pour qu’un film soit tourné dans sa classe, s’étant ensuite félicité à de multiples reprises du succès que le film a rencontré et ayant enfin activement participe à la promotion du film. »
C’est à l’intérieur d’un cadre juridique qui définit les conditions d’exercice d’un droit que Monsieur Lopez a perdu car la loi remarque qu’il était non seulement consentant mais même heureux et collaborant au succès du film. Il n’y a donc eu aux yeux du juge, ni vol ni viol puisqu’il était consentant. Ni vol parce que son cours ne lui appartient pas, donc pas davantage l’image de son cours. Le jugement refuse donc l’accusation de contrefaçon en raison du droit à la propriété. Ni viol : car le droit à l’image est assimilé au droit qui porte sur la propriété du corps, or Lopez est consentant. Autrement dit le droit ne distingue pas corps et image du corps, propriété intellectuelle et propriété et l’image. Désormais pour disparaître complètement il ne suffit plus de disparaître corps et biens il faudra donc dire « Corps, biens et image ». Mais en vérité il y a plus : disparaître complètement c’est ne plus apparaître à l’image, ne plus la contrôler, en être dépossédé. Tant qu’il y a image, vous existez. Perdez corps et biens, tant que l’image est là l’honneur est sauf et vous pouvez vous s’enrichir sur le fond même de votre inexistence. Plus d’image, plus d’être ni d’avoir. C’est toute une culture audiovisuelle formatée par la télévision qui associe l’existence même du sujet à sa participation au marché des images. Sans image, tu n’existes plus, et le prix de l’image indique ton prix. Terrible confusion aux terribles conclusions quant aux assises existentielles de chacun. Le jugement rendu contre monsieur Lopez ne peut que l’enfoncer davantage dans ce vertige qui le tue et dont on imagine qu’il aura du mal à se remettre. Il songe à se pourvoir en cassation pour éviter le gouffre d’une capitulation existentielle. Ce qui est dramatique car quelque chose comme une question de vie et de mort se joue pour lui dans ce rapport à ce qui n’est ni vivant ni mort et qui s’appelle l’image. Monsieur Lopez ressemble à ces spectres qui demandent vengeance pour trouver le repos.
Mais ce n’est pas tout. Le même jugement traite aussi de la qualité d’auteur de Monsieur Lopez qui se considère dans sa pratique d’instituteur comme inimitable, à quoi le juge répond que s’il y avait un propriétaire dans cette matière ce serait l’Education Nationale, donc l’institution et non Monsieur Lopez qui n’est en rien l’auteur des programmes d’enseignement ni l’inventeur de sa pédagogie. Etant donné que le film de Nicolas Philibert ne prend nullement en charge la nature inimitable de sa pédagogie l’institution n’a pas lieu de lui réclamer quoi que ce soit ! Le jugement qui reconnaît la qualité d’auteur au seul Nicolas Philibert ne porte pas sur ce qui fait le caractère original de l’oeuvre, c’est à dire sur le regard imaginaire et singulier de Philibert sur un réseau de relations, mais uniquement sur l’absence d’originalité et donc de propriété intellectuelle de Monsieur Lopez. J’en conclu que si Monsieur Lopez avait eu du génie, il devenait auteur du film. Les cinéastes feront bien à l’avenir de fuir le talent et le génie pour ne s’attacher qu’à la banalité et la répétition. Monsieur Lopez est donc un instituteur imitable mais son image ne l’est pas. N’est ce pas étrange ? Autant dire que celui qui ne vaut rien à titre personnel aux yeux de son institution, se met à penser que son image vaut cher. La loi est plus à l’aise pour designer la propriété des biens que pour reconnaître la propriété des idées et du sens. Et c’est là une chose bien naturelle et bien normale, mais elle pose d’emblée la question des critères qui permettent de designer une oeuvre et de la défendre comme telle. C’est parce qu’il est aisé de prouver que Lopez n’est pas auteur de ses cours qu’il en résulte pour le juge qu’il n’est pas l’auteur du film. Nouvelle confusion de Lopez partagée par le juge qui s’appuie sur le droit quant à la notion d’auteur : l’image n’est pas intellectuelle non pas parce qu’elle n’est pas intellectuelle mais parce qu’elle n’est pas une propriété. Je veux dire que même si Lopez avait été un génie de la pédagogie, le film restait envers et contre tout l’oeuvre de Nicolas Philibert. Tant mieux pour Nicolas Philibert si Lopez a semblé sans originalité au juge et donc pas inimitable, mais il n’en reste pas moins que la confusion juridique demeure. L’auteur c’est Philibert et il n’y en a pas d’autre. Est-ce que les ayants droits de Clouzot versent des droits aux ayants droits de Picasso ? Je pose la question… Francis Ponge n’a jamais revendiqué le titre d’auteur pour le film de Jean-Daniel Pollet, Dieu sait quoi, tout entier bâti sur les textes de ses poèmes.
A bien considérer ce dont il s’agit dans chaque cas, on voit bien que l’image n’appartient ni à la définition de l’auteur ni à celle de la personne. Le législateur en gagnant la cause de Nicolas Philibert a malgré tout accepté les termes dans lesquels Monsieur Lopez participe d’une confusion au sujet de l’image elle-même.
Revenons à ce procès qui fait symptôme: une chose est de dire que Lopez n’est en rien l’auteur du film au même titre qu’il s’autoproclame auteur de ses cours, une autre est de dire qu’il n’en est pas non plus l’acteur professionnellement rétribuable. Un acteur prête son nom, son corps, sa voix à des personnages dont il incarne l’image, dont il n’assume pas l’identité avec sa personne propre si bien que l’acteur prend le nom du personnage et que sa parole n’est pas celle du sujet qui joue mais du personnage qui est joué. En devenant image, l’acteur change de nom et de voix puisqu’il prend le nom du personnage et prononce des paroles qui ne lui appartiennent pas, dont il n’a pas à répondre. Je pourrai ici citer le beau texte de Valère Novarina dans Devant la parole : «L’acteur est un absenté qui s’avance, un homme défait doué d’un manque et renoncé à lui-même… L’acteur c’est l’homme moins l’homme. Un homme en moins ». A mille lieu de cette expérience, Monsieur Lopez n’est pas en situation d’acteur, mais comme dans tout documentaire, il est là en personne. C’est même ce qui caractérise le documentaire à savoir de ne pas mettre en scène des acteurs professionnels mais de filmer des corps qui parlent en leur lieu et en leur nom propre. Par conséquent Monsieur Lopez ne peut être un acteur qui joue le rôle de Monsieur Lopez à moins de se trouver dans une situation schizophrénique d’être et de ne pas être Monsieur Lopez. Or c’est ce qui est arrivé à Monsieur Lopez, il s’est clivé en deux : d’un côté, il a été le sujet consentant d’un documentaire où son corps filmé faisait entendre la voix qui est la sienne et où il était appelé par son nom propre, de l’autre il se vivait comme l’objet d’une transaction dépersonnalisée qui réclamait son bien comme quelque chose qu’on lui avait enlevé à son insu ou malgré lui, à savoir son image d’acteur. Un Lopez marchandise volée et ventriloque qui réclame son prix. Tant et si bien qu’il y a eu procès et jugement sur la base d’un comportement délirant à partir d’un contresens sur l’image devenue « être de la marchandise » sur le marché des avoirs. Le paradoxe du procès qui en fait un cas d’école, comme je l’ai déjà souligné, consiste en ceci : Philibert a promu dans toute sa gloire l’image idéale d’un homme, image dont le cinéaste est à proprement l’auteur. Or le narcissisme de Monsieur Lopez le conduit à se considérer comme ne devant sa valeur idéale qu’à lui-même. En un mot voilà quelqu’un qui s’engouffre dans une figure pathologique de l’image de soi où la relation à l’autre n’est pas la source de la valeur. L’autre pour lui c’est le regard social saisi dans le réseau des transactions marchandes. Je dirai que comme la plupart des sujets aujourd’hui devenus spectateurs d’un monde dans lequel devenir image est la condition de l’être, de la reconnaissance et de la richesse, Lopez traverse un désarroi narcissique dont il est incapable de repérer la source dans le marché médiatique. Au coeur de ces confusions, Lopez a vécu le film comme une véritable aubaine, c’est-à-dire comme une fiction qui ne pouvait devenir réalité que si la société lui renvoyait les signes de son triomphe dans le réel. Qu’est-ce que le triomphe réel dans le monde visible, c’est le profit tiré du spectacle. Son problème est le suivant : il demande à être rétribué comme s’il jouait son propre rôle en se dédoublant dans la peau d’un autre. Autrement dit un Lopez non filmé a loué un Lopez filmable à un cinéaste locataire et mauvais payeur. Mais si ce Lopez n’était qu’un personnage acteur dans une fiction, dès lors, il n’y avait plus d’atteinte portée aux propriétés de sa personne propre. Que Lopez ait perdu la tête comme certains l’on suggéré parce que l’appât du gain a fait de lui un autre homme, ou plutôt a réveille en lui les fantasmes de revanche sur des années de frustration ne nous importe guère. Ce qui est intéressant c’est d’un côté de voir que l’accès à la visibilité peut aujourd’hui devenir un point de vertige et de fragilisation décisif pour ceux qui sont en mal d’image et de reconnaissance. Lopez saisi comme dernier témoin d’un monde en voie de disparition de plus partait à la retraite. N’être plus rien et ne rien avoir. La définition juridique de la personne et le droit de propriété mettent en place des mesures qui renforcent cette souffrance et cette fragilité de l’image de soi en y répondant en termes de consentement, d’image et d’argent. Confondre le corps et l’image du corps, confondre le corps de la personne et l’image du personnage peut faire basculer les plus fragiles dans un gouffre de promesses et de leurres. La croyance en la magie de l’image a traversé Monsieur Lopez sur le mode le plus platement hollywoodien : être filmé, devenir star, devenir un homme riche c’est le rêve qui vient insidieusement remettre en question l’essence même du film par les mécanismes du marché complètement intériorisé. Les choses se compliquent et ne peuvent que s’aggraver lorsque le juge se trouve chargé de faire régner le droit sur ce désordre de la raison en transformant une question de droit au singulier en questions de droits à payer. Pourquoi le mot droit nous fait-il aisément basculer de ce qui se réduit à l’évaluation comptable d’un dû. Quand il s’agit des images le terme même de droit perd son lien comme auxiliaire de la justice et de l’être, pour n’être plus que l’auxiliaire conjugué à la gestion de tous les avoirs.
Lopez, atteint de plein fouet par le succès financier du film, est devenu une sorte de schizophrène. Il a préféré jouer l’effondrement de son image au coeur d’une oeuvre construite par le regard et par le film de Philibert et qui pourtant le magnifiait. Plutôt que d’accepter de recevoir d’une oeuvre un don imaginaire, celui d’une image positive de sa personne et de ses fonctions, il choisit de se destituer publiquement pour faire valoir ses droits au profit tirés de son image.
Au fond, tout le monde a cru au film et c’est cela qui a fait son succès. Un seul n’y a pas cru, c’est Lopez. Le film a fonctionné pour tout le monde sauf pour lui et sa revanche, c’est de ruiner l’essence même du film. Chose que Nicolas Philibert a parfaitement ressenti à partir du moment où la dimension délirante du procès a pris tant d’ampleur que le cinéaste, même gagnant sur le plan juridique, ne peut que penser que c’est lui-même qui s’est leurré sur la personne de l’instituteur. En un sens, c’est lui qui gagnant s’est fait avoir et en subit le préjudice moral. De cette affaire, tout le monde sort déçu, Lopez, Philibert et nous les spectateurs qui aurions voulu continuer à croire à ce que le film raconte. C’est donc que le droit est incapable de faire justice sur le fond puisque le jugement maintient l’image dans les limbes contradictoires de l’être et de l’avoir.
La justice est encore aujourd’hui incapable d’éclairer le spectateur et l’ensemble des citoyens sur les enjeux de l’image dans la constitution d’un partage du monde sensible, et de ce qui fait la valeur d’une oeuvre. Dès lors qu’on ne distingue pas dans le droit d’auteur ce qui est inimitable dans le visible de l’image imitable en tant qu’objet, dès lors qu’on ne distingue plus dans le droit de la personne la propriété du corps de celle de son image, on fait une erreur philosophique majeure qui va coûter très cher non seulement à tous les créateurs d’images mais par voie de conséquence à tous les citoyens. L’image n’est pas une propriété subjective ni un objet comme un autre car elle est ce par quoi le sujet fait dans un même mouvement l’expérience de sa dépossession et de sa constitution dans le regard de l’autre. C’est dans la construction de l’image, dans sa production que le sujet apprend à ne plus jamais confondre ce qui fait sa personne propre avec les modalités infinies et libres de son image… Ce n’est pas seulement le métier d’acteur qui est concerné par ce statut de l’image, c’est la totalité de la scène sociale où les images transforment les citoyens en spectateurs d’apparitions qui ne valent que dans le projet imaginaire qui les soutient. Ce sont les arts de l’image qui dans leur liberté inconditionnelle construisent la liberté des citoyens eux-mêmes. L’image ne révèle ni de l’être ni de l’avoir. En elle se joue d’autres auxiliaires que l’on ne peut jamais conjuguer juridiquement que sont les verbes désirer et le verbe assister. Les spectateurs assistent et soutiennent la fragilité des oeuvres et ce sont les oeuvres qui à leur tour portent assistance aux spectateurs.
Le Code Civil en invoquant la propriété intellectuelle ainsi que la propriété du nom et de la voix définit les droits du sujet. L’image n’est pas traitée dans sa radicale spécificité de n’être ni un objet ni un sujet mais la figure visible et constituante d’un sens invisible. Elle ne concernera jamais le commerce des choses mais celui bien plus énigmatique qu’est le commerce des regards.
Je finirai en citant un proverbe russe que cite Enzo Corman dans sa préface à La Révolte des Anges : « Prends garde que ta tête ne se trouve entre les mains de ceux qui t’applaudissent.» Monsieur Lopez y a perdu la sienne, mais puisque le droit et la justice s’en mêlent alors c’est la nôtre qui est en jeu.
Dossier de presse - Printemps 2002
* Texte destiné au dossier de presse, printemps 2002
Je voulais situer ce film dans une région de moyenne montagne, où le climat serait rude et l’hiver difficile. Avant de choisir cette école, j’en ai contacté plus de 300, et visité une bonne centaine. Il importait de trouver une classe comportant un effectif réduit (10 à 12 élèves), de sorte que chaque enfant soit identifiable et puisse devenir un « personnage ». Je souhaitais aussi que l’éventail d’âges y soit le plus large possible – de la maternelle au CM2 – pour le charme qui émanent de ces petites communautés hétérogènes, et pour le travail si particulier qu’elles exigent de la part des enseignants.
Dès le début de mes repérages – en juin 2000 – j’avais eu un premier coup de cœur, dans un petit village de l’Aveyron. Elle s’appelait Marie-Lou. C’était une institutrice d’une certaine expérience, et dans sa classe, il y avait quelque chose de magique. Malheureusement, elle devait avoir une vingtaine d’élèves, et ça faisait vraiment trop. Par la suite, il y a eu d’autres belles rencontres, mais il y avait souvent quelque chose qui clochait… Ici, on construisait un lotissement en face de l’école, c’était hyper bruyant. Là, l’espace de la classe était minuscule, on ne pouvait pas bouger ! Là encore, l’institutrice, enceinte, ne pourrait pas rester au-delà du mois de février…
Au début, je prospectais de façon un peu aléatoire. Une institutrice m’adressait à une autre, et ainsi de suite. Mais assez vite, pour éviter de faire des kilomètres superflus, je suis passé par les services académiques. J’y ai sans doute gagné en efficacité, mais ça m’a tout de même pris beaucoup de temps. Il fallait envoyer des courriers, attendre qu’on veuille bien me répondre… Il y avait un peu de méfiance. Dix semaines de tournage dans une classe, ça ne va pas de soi. Il faut dire aussi qu’au sein de l’administration, ces écoles à classe unique n’ont plus tellement le vent en poupe. Il en existe encore beaucoup, plusieurs milliers semble-t-il, mais aujourd’hui on préfère la formule du « regroupement pédagogique » : tous les enfants de la maternelle dans un village, les CP-CE1 dans un autre, les CE2, CM1 et CM2 dans un troisième…
Naturellement, je savais que beaucoup de choses reposeraient sur le choix de l’enseignant, mais sur ce point, j’étais très ouvert. Cela pouvait être un homme, une femme, quelqu’un de jeune, de moins jeune… Je n’avais pas d’a priori. Bien sûr chacun avait son style et sa personnalité, mais la plupart des enseignants que je rencontrais me semblaient très impliqués dans ce qu’ils faisaient. Les méthodes pédagogiques n’étaient pas toujours les mêmes, mais j’ai laissé cet aspect au second plan. Je ne faisais pas un film pour spécialistes.
Alors pourquoi avoir choisi cette classe-là ? Les vacances de la Toussaint approchaient, j’avais visité un peu plus de cent écoles, ça faisait quatre mois que je prospectais, que j’étais sur les routes, et en entrant dans cette classe, j’ai eu le sentiment d’avoir trouvé. La salle était grande, lumineuse, le nombre et l’âge des enfants correspondaient à ce que je cherchais, et j’ai senti qu’avec ce maître expérimenté, un peu autoritaire, notre présence ne pèserait pas trop. Il semblait assez disponible, prêt à nous accueillir pendant 10 semaines. En même temps il avait un côté secret, mystérieux, qui en faisait un « personnage ». Enfin, le fait de choisir un homme, alors qu’aujourd’hui ce métier est exercé à 85% par des femmes, me paraissait de nature à renforcer cette dimension intrigante, propre à nourrir l’imaginaire du spectateur.
Quand je l’ai rencontré, il s’est d’abord étonné, comme beaucoup d’autres avant lui, qu’on puisse faire un film de cinéma sur un sujet aussi peu « spectaculaire ». Je lui ai parlé de mon approche, précisant qu’elle n’était fondée ni sur le pittoresque ni sur la nostalgie, mais sur le désir de suivre au plus près le travail et la progression des élèves. J’avais la conviction que filmer un enfant livrant bataille avec une soustraction pouvait devenir une véritable épopée…
Les parents ont très vite donné leur accord, sans doute en raison de la confiance et du respect qu’il avaient envers ce maître installé parmi eux depuis 20 ans. Pour autant, il m’a paru indispensable de leur dire d’entrée de jeu que leurs enfants ne seraient pas filmés à part égale, ni toujours montrés dans les situations les plus gratifiantes, sans quoi il n’y aurait pas de film, du moins pas d’histoire. J’ai également anticipé sur la question du montage, pour dire qu’il faudrait éliminer des heures de rushes, sacrifier sans doute de belles scènes, sachant qu’un montage n’est pas un « best-off » mais une construction, qui obéit tant à ses propres lois qu’aux désirs du réalisateur… Bref, pour écarter toute ambiguïté, je voulais affirmer d’emblée la subjectivité de mon regard. À partir de là, chacun était en droit d’accepter ou non. Il aurait suffi qu’un seul parent soit réticent pour que je change d’école.
Le tournage s’est fait en plusieurs fois, de décembre 2000 à juin 2001. Le premier jour, nous avons pris tout le temps d’expliquer aux enfants comment nous allions travailler, à quoi servaient tous nos appareils, etc. Chacun a collé son oeil dans la caméra, mis le casque sur ses oreilles… Puis le maître a repris la classe en main, ils se sont mis au travail, nous aussi, et au bout de trois jours, nous faisions presque partie des meubles.
Nous étions quatre : un chef opérateur, un ingénieur du son, un assistant caméra et moi. On m’a souvent demandé comment nous faisions pour nous faire oublier… Mais il ne s’agit pas de ça. Bien entendu nous étions aussi discrets que possible, pour ne pas freiner le cours des choses, mais la question n’est pas « de se faire oublier ». Ce qui compte, c’est de se faire accepter. J’essaie toujours de faire comprendre à ceux que je filme que je ne suis là ni pour les juger ni pour les filmer à tout prix. Il faut savoir renoncer, poser la caméra. Ne pas forcer les portes. La caméra vous donne un pouvoir considérable, surtout si on filme des enfants. Un enfant n’osera pas forcément dire devant les autres qu’il ne veut pas être filmé. Il faut être attentif. On n’y arrive pas toujours. Dans le feu de l’action, on peut se laisser emporter.
Le moment où l’instituteur questionne Olivier sur la santé de son père est arrivé de façon très inattendue. Au début, quand j’ai commencé à filmer leur conversation, il n’était question, entre eux, que de travail. L’instituteur essayait d’encourager Olivier : s’il ne voulait pas redoubler, il allait falloir qu’il s’accroche. Et soudain il a changé de sujet, lui a demandé des nouvelles de son père, et Olivier a éclaté en sanglots ! Derrière la caméra, je n’en menais pas large ! Au montage, j’ai beaucoup hésité à garder ce passage. Même chose pour la conversation entre le maître et Nathalie, que j’ai gardée elle aussi après beaucoup d’hésitation. Mais j’ai pensé que le moment venu, quand ils découvriraient le film, l’un et l’autre seraient assez forts pour affronter ces images.
Les saisons, le temps qui passe… c’était pour moi essentiel. Souvent, après la classe, on partait dans les chemins, on allait filmer le paysage. Je voulais filmer la nature dans sa beauté et aussi dans ce qu’elle peut avoir d’inquiétant. D’ailleurs, si le film a quelque chose d’un conte, c’est d’abord à ces plans qu’il le doit : à ces arbres un peu fantomatiques agités par le vent, au silence qui pèse sur ces grands espaces, à cette solitude, ces champs d’orge où on cherche Alizé…
Le film joue souvent de cette opposition entre l’intérieur et l’extérieur, le chaud et le froid. D’un côté l’école, la chaleur du poêle, le fait d’être tous ensemble, dans une sorte de cocon protecteur ; de l’autre, le vaste monde, sa violence, les éléments qui se déchaînent, la neige, le vent, la tempête, ce troupeau de vaches que les paysans essaient de rassembler…
En m’attachant aux « personnages » de cette classe, j’ai voulu faire partager leurs épreuves, leurs bonheurs, leurs petits drames. C’est un film très ouvert. En ce qui me concerne, j’y vois une certaine gravité, voire une certaine violence, même si celle-ci reste contenue. Avant le tournage, je crois que j’avais oublié à quel point il est difficile d’apprendre, mais aussi de grandir. Cette plongée à l’école me l’a rappelé avec force. C’est peut-être le vrai sujet du film.
El País - 2 de enero de 2004
El cineasta francés Nicolas Philibert fabula en Ser y tener la vida de una escuela rural
Un grupo de niños aprende a aprender. Es el tema que centra Ser y tener, el documental de Nicolas Philibert (Nancy, Francia, 1951), que se estrena hoy en las pantallas españolas precedido de un enorme éxito en Francia después de haber figurado en la sección oficial de Cannes 2002. El director del filme visitó Madrid para presentar su trabajo y lo explicó ante un grupo de periodistas. «El éxito del documental se puede deber al tema que aborda, porque es algo que nos concierne a todos. Todo el mundo ha ido a la escuela, todo el mundo tiene recuerdos. Nos afecta a todos. La escuela es un lugar al que uno va cuando es niño y al que no podemos ir cuando somos adultos, y ello suscita curiosidad a los adultos. Las escuelas representan las inquietudes de la sociedad». Philibert cree que su trabajo demuestra que «todavía se puede hacer algo en las escuelas, y eso tranquiliza a los adultos».
El documental se rodó en uno de los centros escolares unitarios de Francia, centros que reúnen a los niños de un pueblo o zona, desde preescolar hasta el final de la enseñanza primaria, a cargo de un solo profesor. Ser y tener, muestra la relación entre un profesor y sus alumnos. Su personaje principal es un maestro rural, un veterano profesor que lleva 35 años impartiendo clases a los niños y niñas de la zona de Auvergne.
El realizador, autor de varios documentales a lo largo de su vida profesional, cree que la explicación del relanzamiento de los documentales en salas se debe a que «el espectador se ha dado cuenta de que el documental no sólo está relegado a la televisión, sino que es un género cinematográfico por sí mismo». Pese al reciente éxito de este tipo de trabajos cinematográficos, desea ser prudente, porque, según dice, «el documental siempre ha sido víctima de muchos malentendidos. El espectador siente que lo que ve es realidad bruta y hay que tener en cuenta que es una visión subjetiva del realizador. No es real, sino una interpretación de la realidad».
Nicolas Philibert empleó el mismo tiempo en rodar Ser y tener que el que se utiliza en el rodaje de un largometraje de ficción, «lo único que varió fue que se hizo en varios periodos diferentes para poder filmar los cambios de las estaciones». El realizador visitó cien escuelas antes de decidirse por la de Auvergne. «El abanico de edades tenía que ser lo más amplio posible. Había que encontrar una clase grande y luminosa y el maestro tenía que ser un personaje complejo, abierto y secreto, paciente y misterioso».
Ser y tener, según su autor, «no es un estudio sociológico de la enseñanza primaria en Francia. Se trata más bien de un cuento, de una fábula, de un western». Philibert cree que el resultado hubiese sido el mismo si se hubiese rodado en Madrid o en Alemania. «No es una película sobre la escuela rural. No se puede leer sociológicamente, y así, aunque el contexto fuera diferente, por ejemplo, si la rodáramos en Madrid, la lectura sería la misma, porque se trata de narrar cómo aprendemos a aprender, cómo aprendemos a crecer, a encontrar nuestro camino, nuestro futuro. El filme habla de la relación entre el maestro y los niños y de la confianza entre ambos».
El director de cine, autor de Qui sait?, La Moindre des choses, Un animal, des animaux, cree que todos sus trabajos rondan una misma cuestión y es «cómo aprender a vivir con los demás y cómo respetar al prójimo. Es el tema que centra mis películas. La escuela es el primer lugar en el que aprendemos a ser sociables, a componer nuestra vida en función de los deseos de los demás».
Por eso, Philibert encuentra una diferencia esencial entre su forma de trabajar y la de otro gran documentalista, Michael Moore, el autor de Bowling for Columbine. «Yo, cuando empiezo un rodaje, no tengo guión, apenas dos o tres ideas, pero sin una elaboración teórica. Pero Moore es un militante del cine de denuncia y lo que le interesa es demostrar algo, por eso necesita prepararlo todo antes para que llegue esa demostración. Yo al espectador no le digo lo que tiene que pensar, le doy cosas para que piense. Yo soy un militante de la esperanza».
El director explica el proceso de su trabajo y dice que cuando se decide a rodar una película «es algo táctil, intuitivo, nada cerebral. Soy incapaz de construir partiendo de una elaboración teórica. Cuando empiezo una película no tengo plan de trabajo ni guión. No hay nada preescrito ni predeterminado. Sólo bullen en mi cabeza dos o tres ideas. Afortunadamente, no hay elaboración teórica. Ésa es la razón por la que siempre me he dedicado a los documentales, porque me gusta inventar la película día a día, que se vaya haciendo poco a poco. Michael Moore, al que admiro mucho, prepara sus películas, porque lo que pretende es demostrar algo».
La imagen idílica del maestro, George López, que aparece en el documental, choca con la demanda que éste ha presentado a la productora por haber utilizado su imagen sin su consentimiento y por no haber recibido una compensación económica acorde con ello. El cineasta lamenta la postura adoptada por López y dice al respecto: «Cuando empecé esta película no me di cuenta de todas las caras de su personalidad. Es una historia bastante triste para todos aquellos que han visto la película, porque actualmente el maestro se ha convertido en lo contrario de la imagen que ha dado de él la película. Cuando se hace una elección, tratas de obtener los lados buenos del ser humano».
El País - 2 de enero de 2004
Hay en Francia viejas escuelas rurales de clase única, donde niñas y niños de una comarca -desde críos de parvulario hasta chicos y muchachas en el umbral de la pubertad- hacen girar su vida alrededor de un maestro o una maestra que les somete al lento y quebradizo esfuerzo de abrir su inteligencia y dar sus primeros pasos en la aventura del conocimiento.
En una escuelita del Auvergne, la vida de un par de decenas de chicos y chicas, de entre cuatro y diez años, discurre alrededor de la calmosa e inagotable pasión pedagógica de un maestro llamado Georges López, hijo de andaluces emigrantes. La cámara de Nicolas Philibert entra en este pequeño ámbito y, de otoño a primavera, va poco a poco dejando de ser una intrusa y desvela que la pequeñez del escenario en que se mueve es una pequeñez ilimitada.
El diálogo de los niños y el maestro es un murmullo incesante, eco sonoro de una tarea igualmente incesante, una laboriosidad suave y obstinada, cuya monotonía es rota por brotes de imaginación y gracia en estado puro: el arte de romper un huevo y convertirlo en tortilla; el debate sobre las pesadillas; la busca de una definición del trabajo. Los niños cuchichean, dibujan, pelean, inventan, debaten, laboran infatigables. Suyo es el sublime monólogo coral del aprendizaje de ser.
La cámara de Philibert es porosa, libre, no tiene prisa, sabe esperar, se mueve en un tiempo sin rupturas ni elevaciones dramáticas, tiene sed de espontaneidad y absorbe delicadamente el hormigueo de los rostros y los comportamientos de los niños galvanizados por su maestro. La cámara de Philibert acecha en busca de signos y gestos. No acumula planos, sino que los funde en una sola toma, lo que crea la impresión de que el filme es todo él un único plano, una única mirada que logra hacernos ver algo tan invisible como el crecimiento: esa mínima niñita subida en una silla haciendo fotocopias; la rara capacidad de los niños para distinguir lo masculino de lo femenino; el prodigio de la captura del flujo de mentes abiertas; la busca de la niña perdida en un trigal; la conmovedora despedida del maestro.
Se ve materialmente crecer a los niños en el milagro documental de Ser y tener. Un pequeñín llora al sentirse abandonado en la escuela mientras otro niño, ya crecido, llora al ver que la escuela lo abandona. El gozoso y doloroso círculo de la conquista del ser y del saber se cierra; y se abre de nuevo el viejo caudal inagotable del poema pedagógico, una de las fuentes esenciales del cine.
Un pequeñín llora al sentirse abandonado en la escuela mientras otro niño, ya crecido, llora al ver que la escuela lo abandona. El gozoso y doloroso círculo de la conquista del ser y del saber se cierra; y se abre de nuevo el viejo caudal inagotable del poema pedagógico, una de las fuentes esenciales del cine.
La Nación (Buenos Aires) y Fotograma.com - 30 de octubre de 2003
Ser y tener transcurre en una escuela y sus protagonistas son un maestro y sus alumnos, pero no se trata de un testimonio sobre el estado de la educación en Francia ni de un examen del proceso de la enseñanza. Es sólo el registro -sereno, minucioso, sensible- de unos cuantos episodios sucedidos en el transcurso de un ciclo escolar. Nada más. Nada menos.
Ni el propio Georges Lopez, el maestro del caso, ni los padres y vecinos del remoto paraje de la región de Auvernia donde se filmó el documental podían creer que pudiera hacerse un film con un asunto «tan frágil, tan poco espectacular». No veían, como el realizador Nicolas Philibert, cuánto drama, cuánta comedia, cuánta vida cabe en cualquier rinconcito donde un maestro y un grupo de chicos renuevan el eterno fenómeno del aprendizaje.
Un deber de matemática que compromete a toda una familia en torno del escolar puede ser toda una epopeya; el lento entrenamiento en la convivencia con el compañero al que se detesta (o se teme), un arduo paso en la distinción entre las propias fronteras y el respeto hacia el otro; la primera aproximación de un chiquitín a la noción de infinito, una aventura fascinante; la perspectiva de abandonar la acogedora intimidad de la pequeña escuela de aula única para ingresar en el colegio secundario, institución grande, anónima y burocrática, un ensayo de la incorporación al mundo adulto, siempre ancho y ajeno.
Philibert eligió una escuela de campo, una de las últimas de clase única que aún quedan en Francia, con un maestro, estricto pero sereno y paternal, y su heterogéneo alumnado, que abarca desde los chicos de preescolar hasta los que están cursando el último año de primaria. Pasó allí el tiempo necesario para que todos se familiarizaran con la cámara y el pequeño equipo y para poder registrar la actividad cotidiana tal como iba desarrollándose y con muy pocas interferencias: apenas una breve entrevista al maestro y un par de situaciones sugeridas o provocadas. Del resultado de su paciente tarea extrajo estas dos horas de pura emoción.
No siempre se tiene conciencia (a veces ni siquiera la tienen los propios maestros) de que la experiencia escolar supone bastante más que aprender a leer, escribir y hacer cuentas. Philibert no lo ignora y por eso su film está atento a todos los sucesos que revelan el hecho educativo, ya se trate tanto de aprender a contar, a cocinar o a escribir al dictado como a compartir juegos, a respetarse a sí mismos y a los demás y a expresar miedos y preocupaciones. Por supuesto, se observa el progreso de la relación que el maestro establece con sus alumnos, parte fundamental del fenómeno, y se va un poco más allá, al encuentro de las familias de esa comunidad de agricultores comprometidos con la formación de sus hijos. Para que puedan desarrollarse y ser felices, como le dice al maestro la madre de una de las chicas.
El compromiso afectivo con el tema elegido, la delicadeza y la sensibilidad de Philibert se manifiestan de muchas maneras: en la distancia justa y la mirada respetuosa con que se aproxima a la realidad que quiere retratar; en su sutil registro del ambiente (es espléndida la metafórica escena inicial en medio de la nieve) y del paso del tiempo; en el montaje que atiende a la emoción pero soslaya la sensiblería; en su discreta mediación para ingresar en la historia personal del maestro, que se encuentra próximo al retiro y cuyo estado interior emerge casi sin querer en medio de un dictado, cuando interrumpe una frase para preguntarse cuántos momentos similares habrá vivido a lo largo de su carrera.
Por muchos caminos diferentes y sin recurrir nunca al discurso, Philibert se aproxima a la esencia del fenómeno educativo, al acto amoroso que supone prestar ayuda en el dificultoso proceso de aprender y crecer. Lo admirable es que lo logra a través de un trabajo de naturaleza documental al que se asiste con el mismo compromiso y la misma adhesión emotiva que suscita una historia de ficción. Y aunque no se pierde la noción de que se trata de seres reales, el maestro que está por jubilarse y los chicos que forman su última clase terminan por convertirse en personajes de una historia enternecedora, risueña y vital, la historia de un ciclo escolar que conmueve por lo que narra y por los ecos que su alcance universal sabe despertar en el ánimo de cada uno. Esa singular propiedad y la encantadora transparencia de los chicos (Jojo, en especial) deben de haber sido determinantes del formidable éxito que el film obtuvo en Francia. Por cierto, muy merecidamente.
Refoworld - Abril de 2005
El documentalista Nicolas Philibert otorga al género un emotivo y espléndido filme sobre la vida en una escuela única situada en un entorno rural.
Lo extraño y meritorio en el cine de Nicolas Philibert es una insólita autenticidad en su diáfana mirada para crear documentales con auténtica maestría. Su concienzudo metodismo a la hora de abordar el género recuerda en sus raíces a maestros como Agnés Vardá, Jose Luis Guerín o Basilio Martín Patino, versados artistas de un tipo de cine que desgraciadamente es difícil disfrutar tan a menudo como se debería. Pero hay una diferencia que separa el cosmos visual y temático de Philibert de estos virtuosos de la representación del realismo en imagen y es la tendencia a admirar con una portentosa sutilidad y sencillez las pequeñas cosas de la vida que hacen reflexionar al espectador sobre nuestra propia naturaleza, basada siempre en la hermosura de la aparente y aburrida cotidianidad, haciendo de ésta un universo de trascendencia vital.
Desde su primer trabajo, La ciudad Louvre, inclusión en el universo del silencio, la vida secreta y eterna del mítico museo francés, su excepcional El país de los sordos, visión del mundo a través de los ojos de millones de personas que desde su nacimiento viven en silencio y sobre todo Lo de menos, entusiasta viaje a la clínica psiquiátrica La Borde, donde se presenciaba la preparación por parte de personal sanitario y pacientes de una obra teatral anual, la obra documentalista de Philibert es definitoria de la idea fundamental del género: exponer temas que aviven el interés del espectador por la realidad que le rodea y le ayude a generar una propia opinión sobre el mundo en el que vive. El realizador francés explora así, recibiendo por los expertos el calificativo de ‘maestro de lo invisible’, los valores humanos que nos rodean, el análisis de lo más intrascendente de la comunidad y la sociedad que potencia el verdadero sentido de la vida.
En Ser y tener, los valores más esenciales para el ser humano encuentran su verdadero protagonismo cuando menos nos damos cuenta de adoptarlos, cuando se conciben y aprecian. Es decir, durante la niñez. Inscritos en la educación que todos recibimos. Como apreciación, cabe resaltar que esta magna obra genérica surgió mientras el director investigaba el mundo rural para realizar un documental ajeno a la hermosa temática que rodea el filme. El documento que propone Philibert se centra en la pequeña localidad francesa de Saint-Etienne sur Usson (Puy-de-Dôme), en un pequeño centro escolar de las llamadas ‘clases únicas’, donde el preescolar y la escuela primaria comparten el mismo recinto. En un entorno rural de pobreza y aislamiento de las grandes urbes, el documental se acerca a un curso completo en la clase de Georges López, un maestro con unas innegables dotes pedagógicas a punto de jubilarse y de sus alumnos, pequeños con edades que van desde los cuatro a los diez años. Sin efectismos, directamente encauzado a lo que Philibert quiere mostrar, Ser y tener aborda los pormenores que afectan a las personas que son estudiadas por la cámara, de su humildad y humanidad, en los pilares que confluyen en la educación infantil: el maestro, los alumnos y los padres. Todo ello en un clima rural, frío y pobre, que no impide mostrar a pesar de las limitaciones de los campesinos la implicación en el proceso educativo de sus hijos (descubierto en la familia que intenta resolver un problema matemático sin llegar a resolverlo).
Dejando a un lado cualquier atisbo de protesta testimonial sobre el estado de la educación en Francia, la base de la historia está en la vida diaria de los niños y el profesor López, deteniéndose en la vida de cada uno (sobre todo en los chicos más inseguros). A lo largo de un documental convertido en historia de ‘semi-ficción’ (con personajes) gracias a la cercanía y ternura que desprenden los niños y el educador, cada momento, cada pequeña historia que se desenvuelve en esta preciosa película, tiene ese imposible factor de humanidad, de emoción gratificante que coloca al espectador ante la realidad de una situación que conmueve, la de la enseñanza pedagógica impartida por un maestro modélico. A pesar de lo que parezca, la gran virtud de este magnífico trabajo no se encuentra en el profesor López, ni en los sacrificados padres, ni en los propios niños (atención al pequeño Jojo y a la asiática Mariè), ni siquiera a las metafóricas estaciones del año que rodean a la región de Auvernia, si no que la importancia radica en las propias situaciones suscitadas por el día a día de todos ellos; en las pequeñas excursiones a la nieve, en las disputas de dos compañeros que se pelean, en la tristeza de un chico con su padre enfermo, en el aislamiento de una niña poco sociable o las primeras nociones morales y vitales que va aprendiendo el más pequeño y más rebelde de todos ellos. Un recorrido por la importancia de enseñar, inquiriendo en la esencia del fenómeno educativo, una oda al acto de amor que es iniciar al más pequeño en el proceso de aprender y crecer. Ése compromiso es tratado en todo momento con delicadeza y sensibilidad, mostrado con un perfecto montaje que se compromete con la emoción, pero que elude por completo la sensiblería.
Es Ser y tener una galería de pequeños fragmentos de vida, narrada de forma magistral por una mirada que se sitúa con bastante distancia para resultar cercano, paradoja ésta que le permite a Philibert explorar y contemplar al profesor y a los niños desde un prisma realista y a su vez nada complaciente. La cámara se mantiene respetuosa con en la distancia al niño, sin abusar de su fragilidad, manteniéndose alejada cuando el dramatismo se apodera de los chavales al confesar alguno de sus problemas y miedos. Es en esa actitud, sólo rota por una pequeña entrevista a López y un par de secuencias preparadas para dar ritmo, dónde figura el éxito de un resultado que es la pura emoción. Aquí no se trata de demostrar, sino de mostrar. Lejos de cualquier posición militante, el cineasta galo deja al espectador que salga con su propia reflexión de una cinta conmovedora, sugestiva y reconfortante.
Estéticamente llena de fuerza, Philibert consigue una visión de la realidad que destila sensibilidad, poesía, belleza y ternura, que propone un tipo de cine alternativo con un documental estimulante y espontáneo que acapara en su final un regusto nostálgico de tristeza en el fin del curso escolar, con el profesor López despidiéndose hasta el próximo curso de sus alumnos. Algunos para siempre, debido a su inmediata incursión al burocrático mundo de la secundaria. Un final cargado de sentimientos y de ideas que enriquece la comprensión y aflige el corazón de un profesor que nunca prepara sus propias emociones. De obligada visión para padres, hijos y cualquier espectador con ganas de aprender a ver la vida con pureza, Ser y tener es uno de los mejores documentales vistos en los últimos años. Un verdadero ejemplo a seguir y una obra de trascendental calidad.
Tren de sombras / revista de análisis cinematográfico – # 6 - Verano 2006
« E sente saudade de si ante aquêle lugar-outono… » Fernando Pessoa, Hora absurda (Cancionero)
Ser y tener. Dos verbos que han sido conjugados en multitud de lenguas y han llenado innumerables cuadernos y pizarras a lo largo de los años. Dos verbos elegidos, probablemente, al azar y que en alguna ocasión habrán sido escritos en la pizarra de la escuela de clase única de St.-Etienne-sur-Osson, un pequeño pueblo de doscientos habitantes en la región de Auvergne al que un día de otoño llegaron Nicolas Philibert y su reducido equipo de rodaje. Hoy en día, todavía es posible encontrar en Francia este tipo de escuelas —que tampoco fueron extrañas hasta hace unas décadas en la España rural— en las que un único maestro se hace cargo de la educación de todos los niños del pueblo. El profesor de St. Etienne, un hombre de suave decir e infinito mirar llamado Georges Lopez —monsieur López para sus alumnos—, tiene bajo su tutela a trece niños de entre cuatro y once años separados en tres grandes mesas: les grands, les moyens y les petits.
Ser y tener comienza con un rebaño de vacas que pastan a la intemperie en medio de una confusión de nieve y viento. Un coqueto edificio de piedra es golpeado por la ventisca: es la escuela. En su interior unos inesperados habitantes, un par de tortugas, se deslizan sobre el deslustrado suelo de madera de una clase vacía y silenciosa. Pocas estancias se muestran más desorientadas y solitarias que un aula privada de su infantil rebumbio de gritos y carreras. En el exterior, una marea de ramas oscila al vaivén del viento. Estas concisas escenas de introducción cumplen la función dramática, en palabras del propio director, de situar la escuela en el mundo, en un contexto y un tiempo concreto. Con ellas, además, Philibert plantea el contraste —tema recurrente en su filmografía— entre el inhóspito mundo exterior y la protección de las comunidades en las que los hombres tendemos a agruparnos. En el cálido interior de esta pequeña clase, entre tablas de multiplicar, dictados y ejercicios varios, surgirán los pequeños dramas provocados por la convivencia cotidiana: deberes inatendidos, roces con los compañeros o con los padres, problemas de adaptación, de timidez, etc., un rico anecdotario cotidiano al que el profesor Lopez responde de manera estricta pero conmovedoramente paciente.
El efecto cámara
En Ser y tener adquiere especial relevancia el viejo debate sobre la presencia de la cámara y su decisiva influencia en las personas que a ella se enfrentan. El principal problema al que hubo de enfrentarse Philibert fue el de captar las reacciones de este reducido grupo humano en el limitado espacio del aula sin interferir en su transcurso natural. Gran parte del metraje de Ser y tener transcurre en el interior de la pequeña clase de St. Etienne – nada que ver con las amplias salas de La ciudad Louvre, los vastos jardines de la clínica de La Borde en Lo de menos o las dispares localizaciones de En El país de los sordos – lo que provocó que las cuatro personas del equipo de rodaje nunca pudieran refugiarse en una discreta distancia o en un recodo tranquilo y apartado. Philibert ha afirmado que la confianza fue determinante para filmar como si no hubiera extraños presentes: «Viendo la película, tenemos la impresión que los niños olvidan muy pronto la presencia [de la cámara]. […] Al cabo de tres dias, eramos casi parte del mobiliario. Naturalmente, desde el primer al último día, fuimos lo más discretos posible, para no frenar el desarrollo normal del grupo […]. De hecho, que un niño mirara a cámara no me molestaba. Durante todo el rodaje traté de guardar una especie de «neutralidad bonachona»»(1).
Su intención era, por tanto, tratar de recoger de manera neutral la espontaneidad de lo cotidiano evitando adulterar lo filmado. Pero ¿lo ha conseguido? Mientras veía esta película jamás dudé de la naturalidad y sinceridad de lo que ocurría en pantalla. Ahora bien, he de reconocer que me encuentro entre aquéllos que opinan, siguiendo a Bill Nichols, que no se puede amar el documental si se busca la verdad como idea platónica puesto que hoy en día no es posible percibir la realidad si no es a través de su simulacro. No pretendo volver sobre este tema ya esbozado en la introducción pues me parece evidente y universalmente aceptado que cualquier respuesta de un sujeto ante la cámara estará siempre condicionada por ésta. Por ello considero perfectamente válido el término “actuación” para denominar el comportamiento de estas personas que representan su vida cotidiana ante la cámara. Al fin y al cabo, todos nosotros actuamos constantemente en nuestra vida diaria bajo múltiples máscaras por lo que, con mayor motivo, lo haremos ante una cámara. Sólamente en soledad, alejados del “gran ojo” social, parecemos ser capaces de abstraernos del entorno y poder ser la suma de fragmentos de otros que por mera convención hemos dado en llamar “yo”.
A pesar de esta decisiva influencia de la cámara sí creo posible un variable grado de habituación, una trabajada confianza, una complicidad —términos bien conocidos por la antropología— que permitan obtener respuestas válidas y sinceras, en tanto que no fingidas; aunque siempre actuadas y diferentes a las que se obtendrían si no hubiera una cámara presente. Se podría poner el ejemplo de las cámaras ocultas pero, aún así, las respuestas ante la presencia y las preguntas del cineasta/investigador no serían del todo verdaderas pues, retomando la frase de Rouch citada en la introducción, «se distorsiona la pregunta con el sólo hecho de preguntar». Philibert acepta, por lo tanto, el “efecto cámara” para ofrecerle a los espectadores la posibilidad de realizar de manera activa lo que de Javier Maqua describe como «una operación de restado que permita abstraer del conjunto lo que queda sin modificar del sujeto filmado »(2).
Narración
Del otoño al verano, el discurrir de las estaciones durante un año escolar marcará el ritmo lento y pausado, necesario, del filme. Durante siete meses Philibert rodó más de 60 horas de metraje que quedaron condensadas en un —brillante— montaje final de 104 minutos. Al igual que en sus anteriores películas, Ser y tener mantiene el gusto de Philibert por rodar sin guión previo y se construye en base a pequeños fragmentos dramáticos que el cineasta va incorporando a la historia, pero a la vez presenta una narración más ambiciosa. Puede ser que Philibert buscara conscientemente nuevas soluciones para esta película pero también es muy posible que sea el resultado de su natural maduración como cineasta. En este sentido, Ser y tener tiene un discurso más cinematográfico que sus predecesoras y construye una historia —en el sentido más clásico del término— que discurre por unos cauces narrativos bien definidos y acotados temporal y argumentalmente por la duración del curso escolar.
Philibert ha logrado su película más compacta hasta la fecha, sin abandonar el territorio documental que ha hecho suyo pero incorporando a su discurso elementos de marcado carácter ficcional, puede que en parte obligado por su intencionada renuncia a la fórmula (típicamente documental) de la entrevista, usada intensivamente en películas anteriores. Elementos como el uso clásico de los contracampos para dotar de mayor espacialidad a las conversaciones (que en determinados momentos me hizo dudar de que se hubiera rodado con un sola cámara); o las pequeñas subtramas que contribuyen a dotar de un cierto suspense al filme, por ejemplo la expectación por las notas de los exámenes de acceso de los alumnos de último año o la momentánea desaparición de una alumna durante una excursión por el campo. Esta acumulación de recursos recuerda a otros acercamientos documentales promiscuamente ficcionales como En construcción (José Luis Guerín, 2001) o Nanook el esquimal (Nanook of the North, 1922) a la que su director, Robert J. Flaherty, definió como «una combinación de cine dramático, educativo y de inspiración»(3), una frase a la que Ser y tener podría amoldarse sin dificultad.
Pero el elemento que mejor define este nuevo carácter es el uso de escenas de transición en las que los alumnos se dirigen de la escuela a casa y viceversa a través de la potente y cambiante naturaleza de St. Etienne. Estos interludios actúan de engarce entre los dos ámbitos fundamentales en la vida infantil, el escolar y el doméstico, y le sirven a Philibert, además, para dejar bellamente reflejado el tránsito estacional como reflejo del paso del tiempo y de la propia evolución, más íntima y modesta, que viven los niños. Philibert matiza estas escenas con una hermosa música (las Canciones de los niños muertos [Kindertotenlieder, 1902] de Mahler, principalmente), un acompañamiento que redunda en su orientación ficcional. En otra de esas típicas (y arriesgadas) analogías en las que el observador de cine suele embarcarse, este uso de la música y de personas que caminan me recordó a una de las marcas de estilo más reconocibles de Kitano Takeshi. En el cine del japonés, estos desplazamientos no se limitan al plano físico del movimiento sino que sugieren el tránsito vital de los personajes, una sensación de pausadas reflexión y expectación, un mayor interés por el viaje en sí que por la llegada. Son, por lo tanto y aunque no lo parezcan, plenamente narrativos. Los engarces kitanianos también suelen ser acompañados por música, normalmente compuesta por el gran Joe Hisaishi, excepto Zatoichi (Zatôichi, 2003), primera colaboración de Kitano con el compositor Keiichi Suzuki tras muchos años de inolvidable unión creativa con Hisaishi.
Un tiempo en fuga
En algunas ocasiones, y sin previo aviso, sentimos una extraña lejanía del tiempo presente, como proyectados en un tiempo blando donde sólo somos el antes de un después que no es sino ahora distante. El aparato cinematográfico es, en cierto modo, un dispositivo sin presente marcado por la fugacidad de sus fotogramas en tránsito, que nos obligan a sentir en pasado presos en un flujo continuo de fugas. Ser y tener maneja en sus 104 minutos toda la gama cromática de los ocres: el discurrir del tiempo, el desasosiego, un ambiente de pasado constante…, unos colores que parecen aflorar en los ojos del profesor Lopez ante el profundo cambio que está a punto de producirse en su vida.
En sus dos películas anteriores centradas en comunidades – Lo de menos y El país de los sordos -, Philibert hacía un uso intensivo de la entrevista pero en Ser y tener sólo la utiliza en una ocasión, lo cual le otorga relevancia a su elección. El cineasta entrevista a Lopez, pero no lo hace en la escuela sino en el jardín de su casa donde, por primera vez, le vemos fuera del espacio comunitario donde realiza su trabajo. Y es este ambiente íntimo y recogido donde el maduro profesor enfrenta por primera vez con su mirada la cámara de Philibert y relata como la influencia de su padre agricultor, un emigrante español que no desea el mismo destino para su hijo, fue la que le llevó a hacerse maestro y como ahora —tras treinta y cinco años de profesión, veinte de ellos en esta misma escuela en Auvergne— ha de afrontar la inminencia de su jubilación. Puede que este sea el primer punto que nos ayude a entender esa capa de melancolía que recubre el filme de Philibert, pero no es el único. Algunos de los conflictos con los que ha de lidiar Lopez nacen del miedo de los niños de último año ante su paso a secundaria. Al igual que su profesor, están a punto de afrontar un cambio capaz de trastocar su pequeño mundo: una nueva escuela, nuevos compañeros, nuevos maestros… Aunque no es posible evitar la sensación de que, terminen o no su escolarización, nada cambiará en el futuro de muchos de estos niños. Una certeza que hace aún más admirable la dedicación del maestro.
En la última escena del filme, llegado el final del curso, Lopez se despide uno a uno de sus alumnos en la puerta del aula mientras la cámara observa respetuosamente desde el exterior. El cariño que le demuestran muchos de los niños y la lucha del profesor por contener las lágrimas convierten en certeza lo que ya se había sugerido durante toda la película: Ser y tener no trata sobre la educación, ni siquiera sobre el mundo escolar; es, más bien, una película sobre el aprendizaje como proceso vital de descubrimiento y la enseñanza como acto de amor; una película que acaba convirtiéndose en una rendida oda al profesor Lopez, un héroe cotidiano armado con un lápiz, una mirada tranquila y una paciencia infinita. Si en Los 400 golpes (Les 400 coups, 1959) Truffaut se servía del despótico y amargado maestro de Antoine para darnos una visión devastada (aunque optimista, baste recordar ese congelado y libre plano final a pie de playa) de un país sin referentes en parte debido a un sistema educativo corrupto, Philibert le otorga a Lopez —maestro vocacional y entregado— parte del poder necesario si no para mejorar el mundo sí, al menos, para mantenerlo en marcha.
Porque Ser y tener no es en una película triste —¿quién ha dicho que la melancolía deba ser lo contrario de la alegría?— sino que se ofrece luminosa y sincera al público al tiempo que reflota el asombro que dejó en nosotros « El país de los sordos ». Un asombro, ciertamente, infantil que bien puede surgir de los ojos traviesos y curiosos de Jojo —el niño que en seguida se convierte en el favorito de Philibert por su desparpajo y naturalidad— o en los limpios y redondos de Ahmed, el niño iraní de ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Khane-ye doust kodjast?, Abbas Kiarostami. 1987), con la que Ser y tener establece fuertes lazos. El primero y quizá más importante en este punto, es que tanto Philibert como Kiarostami —otro cineasta apegado al mundo de la escuela y los niños(4)— han sabido reconocer en ambos filmes la pureza documental de la infancia y su mirada limpia de ciertas ficciones que el tiempo trae siempre consigo.
NOTAS: (1) Declaraciones extraídas del dossier de prensa de Ser y tener . (2) Javier Maqua El estado de la ficción: ¿nuevas ficciones audiovisuales? En VV.AA. Hª general del cine. Madrid: Cátedra, 1995, tomo XII
(3) Del dossier de prensa de Nanook el esquimal difundido por el portavoz de La Sociedad de Asia, en el año 1932 (Citado en Documental y falso documental: las ficciones de la no ficción, Jurgen Ureña. Enlace)
(4) Ambos elementos, escuela y infancia, recorren la filmografía de Kiarostami: de los cortometrajes educativos que realizó en los años 70-80 a ¿Dónde está la casa de mi amigo? o Los deberes (Mashgh-e Shab,1989). Para un completo recorrido por la vida y obra del cineasta iraní, la revista española Letras de Cine le dedica un extensivo monográfico en su número 7 (año 2003).
rtve.doc
Estaba yo mirando sobre ese momento dulce que dicen que vive el documental cinematográfico y me metí en el cine, en el último documental de Nicolas Philibert, Ser y Tener, que ya había visto el año pasado, en La semana de cine de Valladolid a instancias de mi querido amigo Fabricio Caivano, coordinador reponsable de Tiempo de Historia. “No te pierdas –recuerdo que me dijo Fabricio” – Etre et avoir. Y no le faltaba razón. Nicolas es un director francés, auténtico maestro del cine documental europeo. Pero, claro, decir cine documental (no es decir mucho) este género abarca escuelas, métodos, líneas muy diferentes que van desde Agnés Vardá hasta Jose Luis Guerín o Jaime Camino, Victor Erice o incluso Basilio Martín Patino. No, el cine de Nicolás Philibert atiende y está atento al mundo de las pequeñas cosas. Philibert, rueda, rueda, como un maestro de lo invisible y no te ofrece el resultado domesticado y digerido como un Michael Moore cualquiera. Philibert logra poner de relieve lo mágico, lo hermoso y lo misterioso de lo cotidiano. Su primer trabajo data de 1990, La ciudad Louvre, en ese trabajo eludió lo conocido del museo francés para adentrarse en el universo del silencio, la vida secreta y eterna del Louvre. En ochenta y cinco minutos aprendí y me metí más en los rincones del Louvre que en todas mis visitas anteriores. Este documental ganó el Premio Europa de 1990 “Al mejor documental europeo”. Vino después El país de los sordos, año 1992. La imagen que tienen del mundo millones de personas que desde su nacimiento viven en silencio. Un mundo que al resto de los mortales nos resulta absolutamente ajeno y distante. Una sociedad estructurada a través de sistemas de comunicación específicos donde todo ocurre a través de la mirada y del tacto… Recuerdo que este documental arrasó, sorprendió y fascinó aquel año en Valladolid, en Tiempo de Historia. En el 95, este director nuos muestra con el documental titulado Un animal, animales un munso tan expresamente curioso como el representado por la Galeria Zoológica del Museo de Historia Naturalo, una galeria que permaneció cerrada durante 28 años y durante ese tiempo únicamente tuvieron acceso los científicos y durante très años Nicolas Philibert. Emocionante el trabajo de este cineasta. En 1996, Nicholas Philibert volvería a sorprendernos con su control, dominio y pericia del documental: Lo de menos, un viaje a las profundidades y los sotanos de La Borde, Clínica psiquiatrica francesa que entre personal sanitario y pacientes preparan para cada 15 de agosto la presentación de una obra teatral. A través de esa excusa y de ese recorrido se inicia el viaje: un viaje a la vida cotidiana de la clínica: el pasaje del tiempo, la soledad y el cansancio así como los momentos de alegria y de risas, concentrándose en aquellas personas que –desde la medicina mental y desde la enfermedad mental- ayuda a que el espectador genere su propia opinión sobre el mundo que tienen algunos locos. Su último trabajo podéis disfrutarlo en las carteleras españolas: Etre et Avoir (Ser y tener), ser conscientes de la voluntad y del tremendo valor de educar y tener la comunidad y la sociedad que -lejos de potenciar especulaciones inmobiliarias, televisiones basuras e hipotecas varias- potencia los valores más esenciales del ser humano; precisamente cuando estos valores cuajan: en la niñez. En el corazón de la Auvergne, una pequeña escuela acoge a alumnos de diferentes edades y todos ellos con el mismo maestro: otoño, invierno, primavera y comienzos del verano para aprender a escuchar, a trabajar desde el dialogo, la conversación, el silencio y la naturaleza. Una película que al margen de premios y galardones…. es una galería de las lagunas en las escuelas españolas de hoy y en el sistema social que estamos construyendo entre todos. Nicholas Philibert, el mundo del detalle en la escuela: aprender a escribir a la sombra de una higuera, a dibujar junto a la chimenea de la escuela, la responsabilidad mientras caen copos de nieve en el jardín. ¿Por qué el poder tiene tanto miedo a la escuela?