Distribución en Francia & Ventas internationales : Les Films du Losange
Naissance d’un triptyque
Avant de me lancer dans le tournage de Sur l’Adamant, je m’étais raconté que ce centre de jour pour le moins original – il est construit sur l’eau – était une sorte d’îlot autonome, non pas replié sur lui-même mais disons, un peu autarcique. Je n’ignorais évidemment pas que l’Adamant faisait partie d’un ensemble plus vaste, le pôle Paris-centre, lequel compte également deux CMP, une équipe mobile et deux unités de soin, les bien nommées Averroès et Rosa Parks au sein de l’hôpital Esquirol – autrefois connu sous le nom d'» Asile de Charenton » – mais c’était comme si, de peur de me disperser, je ne voulais pas voir à quel point ces différentes structures étaient complémentaires, interdépendantes, qu’elles formaient avec lui un maillage au sein duquel patients et soignants étaient constamment appelés à circuler, chacun pouvant » construire sa propre cartographie entre les différents points d’appui proposés «. Inconsciemment peut-être, j’avais eu besoin de détacher l’Adamant de son contexte, comme pour mieux le distinguer.
Une fois sur place, j’ai vite compris que ce hors champ, il faudrait le faire exister, ne serait-ce que par allusion, sous peine de falsifier la réalité. Les images sont toujours trompeuses, me direz-vous, et raconter ce que l’on voit n’est jamais qu’une lecture parmi d’autres, une interprétation, mais tout de même, occulter totalement cette dimension plurielle aurait été un contresens. Si l’Adamant pouvait attirer l’œil, les autres structures, plus classiques, n’en étaient pas moins essentielles. Les deux centres médico-psychologiques croulaient sous les demandes, il fallait patienter des mois pour y décrocher un entretien. À Esquirol, Averroès et Rosa Parks ne désemplissaient pas. Du reste, plusieurs » passagers » de l’Adamant avec lesquels j’avais un bon lien y séjournaient. Je pense notamment à Olivier, avec qui j’avais tourné une séquence qui m’avait chaviré à l’atelier dessin, ou à François, cet homme qui ouvrira le film – celui-ci une fois monté – en chantant La Bombe humaine. S’arracher à l’hôpital leur demandait un effort considérable. Se lever, s’habiller, traverser le parc, aller jusqu’au métro leur était parfois insurmontable.
Je décide un jour d’aller leur rendre visite. Les unités Averroès et Rosa Parks se partagent un même bâtiment autour d’un patio arboré. Averroès est au rez-de-chaussée, Rosa Parks à l’étage. Des couloirs éclairés aux néons, des portes équipées de hublots, de petites chambres individuelles ou pour deux, une salle de télévision par étage, quelques pièces dédiées aux réunions, des chaises dépareillées, un self. Dans la diagonale du patio, une serre chaleureusement aménagée où ont lieu la réunion » soignants-soignés » du mardi, la » buvette » les mercredis matin et les quelques ateliers qui existent encore. Ce jour-là Olivier est affairé mais je passe deux heures à discuter avec François. La clairvoyance avec laquelle il raconte son parcours de plus de trente ans en psychiatrie me laisse une forte impression.
J’y retourne les semaines suivantes et croise d’autres patients. Certains semblent au bord de l’abîme et ne se laissent pas approcher. D’autres sont heureux de trouver quelqu’un à qui parler. Romain, la trentaine, occupe ses journées » à regarder pousser les plantes et à faire de la magie «. Chiche ? Il sort de sa poche un jeu de cartes et me fait plusieurs tours qui ratent les uns après les autres. Il est un peu vexé mais finit par en rire. Eva a été hospitalisée » à la demande d’un tiers «. Ce n’est pas la première fois : » Je fais des obsessions… Quand je m’attache à quelqu’un j’ai du mal à lâcher, et ça devient du harcèlement. » Myriam ne veut pas que les autres entendent son histoire. Nous nous installons dans la salle de télévision. Dans le cadre d’une thérapie, elle vient d’avoir accès à un trauma refoulé depuis quarante ans. Placée chez son oncle et sa tante à la naissance, elle a été abusée par son oncle jusqu’à l’âge de cinq ans. Si je reviens avec la caméra, elle témoignera : » Ça pourra m’aider » assure-t-elle. Mais elle quittera l’hôpital quelques jours plus tard.
Chacun semble emmuré dans une solitude abyssale. D’une fois sur l’autre, je remarque de nouvelles têtes. Des absents aussi. Le mouvement de rotation est incessant. Certaines semaines, le manque de lits est tel qu’il arrive que l’admission d’un nouveau malade impose le départ d’un autre. Mais lequel ? Casse-tête. Je rencontre les infirmiers, les aides-soignants, les psychiatres, les psychologues, les assistantes sociales, le personnel administratif. Chez les infirmiers et les aides-soignants, beaucoup d’intérimaires. Tout le monde est sous tension. Prudemment, j’évoque mon souhait de venir tourner » quelques plans complémentaires » qui permettront de faire le lien entre l’Adamant et l’hôpital. L’idée est bien accueillie. Presque tous ont entendu parler du tournage qui se déroule au centre de jour, et manifestement ils en ont de bons échos. On m’invite à me glisser dans une réunion. Puis au staff du matin. Puis aux réunions » soignants-soignés » du mardi. Parfois houleuses, toujours hautes en couleur, il n’est pas rare qu’un patient y rue dans les brancards, invective l’équipe médicale, se mette à tempêter contre la psychiatrie, les médicaments, les conditions de vie à l’hôpital, la République, le Vatican, la nourriture, le café… Des plans complémentaires ? Au fond de moi, je n’en suis plus là. La perspective d’un second film me trotte dans la tête. J’aimerais y mettre l’accent sur les consultations, ces entretiens individuels entre patients et soignants. Un axe que j’ai laissé de côté sur l’Adamant. Il est vrai que les entretiens en face à face y sont moins fréquents.
Mais déjà, les contours d’un troisième film ont commencé à s’esquisser. Quelques jours plus tôt, l’occasion m’a été donnée d’accompagner et de filmer deux membres éminents de L’orchestre chez Patrice, au motif que la machine à écrire de ce dernier faisait des siennes. L’Orchestre est un petit groupe de soignants bricoleurs qui, non contents de restaurer les âmes sur l’Adamant, se rendent parfois chez un patient pour y accomplir de menus travaux : fixer une étagère, déboucher un lavabo, réparer une prise, monter un meuble, etc. Patrice est une figure emblématique du centre de jour. Hiver comme été, ce septuagénaire s’y rend chaque matin dès l’ouverture des portes, va s’assoir à » sa » table, avale un café et se lance sans tarder dans la rédaction d’un poème en alexandrins. De retour chez lui, il s’installe devant sa machine à écrire et retranscrit le poème du jour. Cette pratique fortement ritualisée semble être ce qui le tient depuis des années. Sa machine brusquement en panne, le voilà dans tous ses états. Walid et Goulven ont proposé de faire un saut chez lui, sans garantie de réussite. Trentenaires l’un et l’autre, ils n’ont jamais vu de machines à écrire… qu’au cinéma. Les voilà à l’œuvre. Je filme et engrange une belle séquence.
Ce premier pas de côté en appelle d’autres. Les membres de L’Orchestre sont régulièrement sollicités, d’autres visites à domicile les attendent. Des » VAD » comme ils disent. Pourquoi ne pas continuer à les suivre ? Restaurer les âmes, réparer les objets. Un troisième film ? Bien sûr il va falloir chercher des financements complémentaires, mais pour le reste, si je m’organise… Je me prends à y croire. Les trois films formeraient un ensemble tout en demeurant indépendants les uns des autres : on ne serait pas obligé de voir l’un pour voir les autres. Trois films au sein du même secteur psychiatrique, dont chacun lèverait le voile sur un aspect particulier de cette psychiatrie qui s’efforce encore, dans un paysage dévasté, de privilégier la relation. On y retrouverait certains visages, on en découvrirait d’autres.






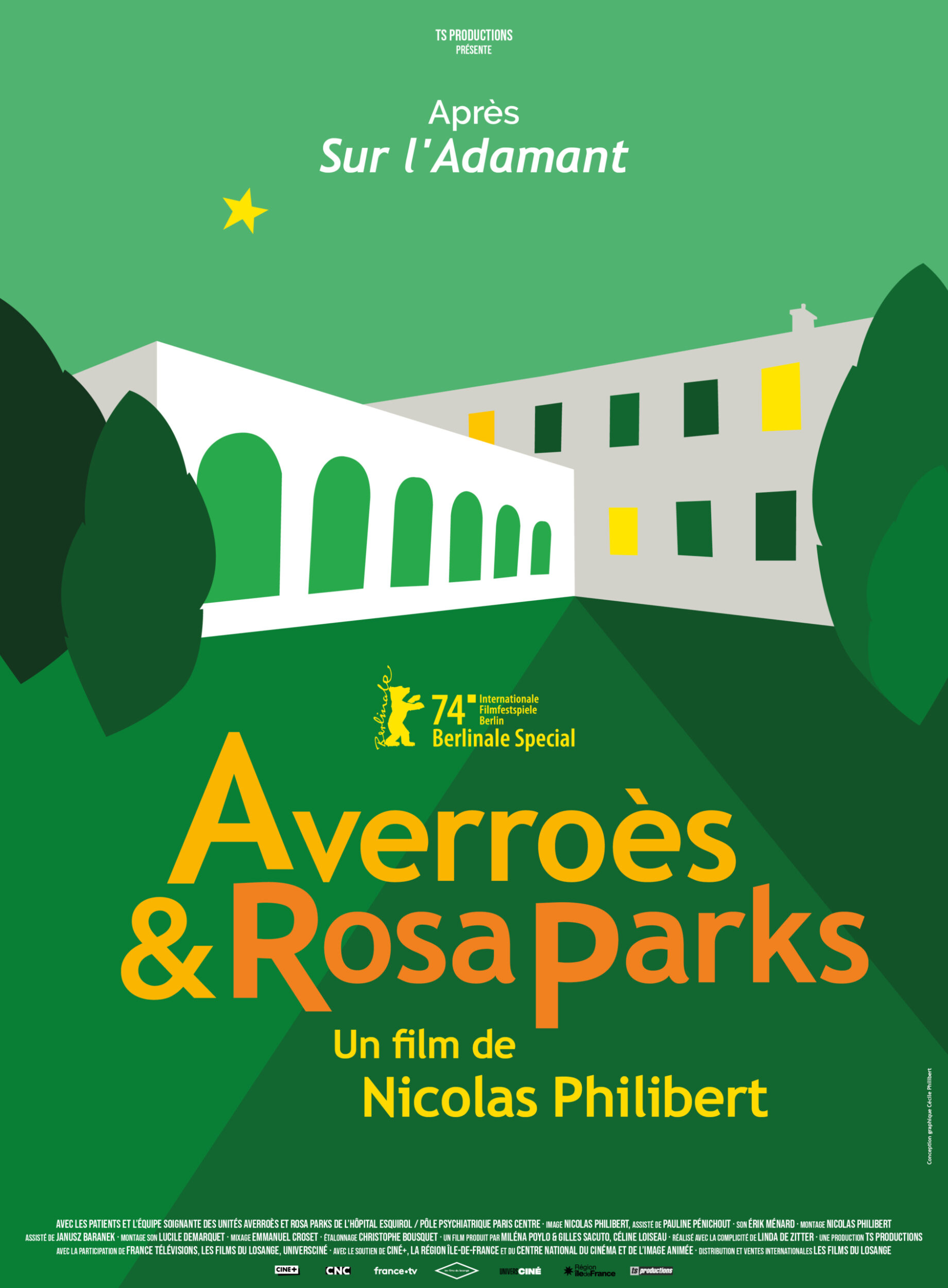
Dossier de presse
Le film est donc le second volet de ce qui formera un triptyque. Comment s’articule-t-il avec Sur l’Adamant ?
Averroès & Rosa Parks en est un prolongement. C’est un peu comme si, après avoir filmé ce qui est sur le devant de la scène, je montrais cette fois les coulisses, les soubassements. L’ambiance de l’hôpital n’est évidemment pas la même, le lieu est plus sévère, et les patients qui ont échoué là traversent un moment dans lequel ils sont plus vulnérables, plus chancelants. La tonalité du film s’en ressent, mais il s’agit de la même psychiatrie, ou plutôt de ce qu’il en reste : cette psychiatrie qui s’efforce encore de prendre en considération la parole quand tout le système, de plus en plus colonisé par les neurosciences, les protocoles, les experts et les échelles d’évaluation tend à l’écraser en misant sur le seul recours aux médicaments. Aujourd’hui, l’hôpital est aux mains des gestionnaires, tout le monde le sait. Il faut faire du chiffre, réduire le nombre de lits, écourter le plus possible la durée d’hospitalisation et supprimer des postes… quand nombre de professionnels ne partent pas d’eux-mêmes, faute de trouver encore du sens dans ce qu’ils font. Le film fait plusieurs fois allusion à cette situation : une jeune patiente en parle, la question resurgit dans une réunion ; c’est là, en toile de fond, mais cela n’en fait pas pour autant ce qu’on appelle un film » militant «. Ou s’il milite, c’est en faveur d’une certaine dignité.
Introduire une caméra au sein d’un hôpital psychiatrique ne va pas de soi. Comment avez-vous procédé ?
Je ne partais pas de rien. Dans la mesure où le tournage sur l’Adamant s’était bien passé, je bénéficiais d’un a priori favorable. Les soignants en avaient eu de bons échos par ceux d’entre eux qui naviguent entre les deux lieux et par les patients qui le fréquentaient. Certains connaissaient mes films, notamment La moindre des choses, le film que j’ai tourné à La Borde en 1995.
J’ai commencé par filmer un peu » la buvette «, la bibliothèque et l’atelier journal, trois rendez-vous qui scandent la semaine. Je connaissais la plupart des soignants qui les animent puisque presque tous travaillent sur l’Adamant. Il n’en reste pas grand-chose mais cela m’a aidé à lancer le tournage. Certains patients acceptaient d’être filmé, d’autres non. Rien d’étonnant à cela. Un homme faisait parfois irruption dans le champ de la caméra en tenant des propos très délirants. Il voulait impérativement que je le filme, il serait bientôt célèbre, c’était sûr, on allait voir ! C’était délicat. Comment ne pas le froisser ?
Le film repose en grande partie sur des entretiens. Qu’est-ce qui vous a conduit à faire ce choix ?
Dès le début c’était mon idée. Les entretiens, et en second, les réunions » soignants-soignés «. Je voulais faire du film un champ d’interrogations. Que s’y déploie la parole des patients, leurs mots, leurs maux, des bribes de leur histoire, de ce qui les tourmente, les assaille, les enferme, les agite ou les terrorise. Cette porosité qui les expose à la violence du monde, qu’ils prennent de plein fouet. La lucidité et l’acuité avec lesquelles ils évoquent leur monde interne. L’insatiable quête de sens qui les taraude. Leurs espoirs, leurs potentialités, leur humour parfois.
Si la maladie mentale est une pathologie du lien, filmer des entretiens me semblait un bon moyen de montrer comment les soignants essaient d’accompagner ceux qui en souffrent et de forger avec eux les appuis qui pourront les aider à se relever, se relancer, renouer un lien avec le monde si ce n’est avec eux-mêmes, se réinsérer dans le tissu social. On y verrait combien accueillir la parole singulière de chacun est un travail de dentelle, toujours sur le fil, toujours à affûter.
Dans Sur l’Adamant les soignants n’étaient pas moins présents, mais leur présence était plus discrète. Elle l’était d’autant plus que le film ne les désignait pas comme tels de façon explicite. Un certain flou subsistait, qui était porteur de sens. N’avoir pas surligné la distinction entre soignants et soignés mettait le spectateur en situation de devoir se défaire de certains clichés. Ici, c’est différent. Le dispositif en face à face dit sans ambiguïté qui est qui. La visée thérapeutique y est immédiatement lisible, quand celle-ci pouvait sembler plus diffuse sur » le bateau «, du moins pour qui n’est pas de la partie.
Les entretiens que j’ai filmés présentent une grande diversité. J’en ai beaucoup joué au montage, dans la construction et la rythmique du film. Tantôt linéaires, tantôt décousus, heurtés, en zigzag, ils n’avancent pas tous à la même cadence, n’ont ni la même durée ni la même tonalité. Certains sont fluides quand d’autres font du surplace. La personnalité des patients et la diversité des situations qu’ils traversent y sont évidemment pour beaucoup, tout comme la manière dont les soignants se saisissent de ce qu’ils disent, chacun avec son style, ses références, ses automatismes parfois, sa façon d’être avec, de laisser venir la parole et d’orienter ou non l’échange.
Comment cette idée de filmer des entretiens a-t-elle été reçue ?
Presque tous les psychiatres ont été partants, à condition bien entendu que chaque patient le soit aussi. On en parlait avant, et je m’appuyais sur leur avis. Avec tel patient, ce n’était peut-être pas le moment. On verrait plus tard. Avec tel autre, oui, pourquoi pas. Dans la pratique, c’était souvent un peu acrobatique. Les psychiatres étaient débordés. Et voilà que tout à coup, ils avaient un petit créneau. Mais encore fallait-il que le patient soit disponible lui aussi, du moins qu’il se sente d’attaque et qu’on trouve une salle disponible où filmer l’entretien, puisque les psychiatres n’ont pas de bureau attitré. Nous avions à peine le temps de nous installer. Nous étions trois. Deux caméras, un micro sur pied, un autre au bout de la perche, et hop, c’était parti.
Du côté des patients il y a eu quelques refus mais finalement assez peu. Les personnes à qui je m’adressais étaient celles avec qui j’avais un échange, un minimum de complicité. Je n’ai pas proposé de les filmer à celles et ceux qui me semblaient traverser des situations trop aigües, dont la parole était incohérente, voire inintelligible, souvent altérée par les médicaments. C’eût été les filmer à leur insu. Et à leur détriment. Filmer quelqu’un c’est toujours l’enfermer, le figer dans le temps et dans l’espace. L’emprisonner. Il faut donc essayer d’être le moins nocif possible. Je voulais qu’ils soient à même d’accepter la situation » en toute conscience «. Mais cette notion est elle-même un peu vague. Une personne qui délire, qui a des hallucinations, qui est par exemple envahie par des voix, cela ne se voit pas forcément. Sait-on toujours ce qui se passe dans nos têtes ? On peut avoir les meilleures intentions du monde, on ne sait jamais ce que la caméra peut faire aux gens.
Le film ne dit pas quel est le statut professionnel des soignants qui font ces entretiens.
C’est vrai, mais je ne me voyais pas mettre leurs noms et professions à l’écran, comme à la télévision. Pourquoi alors ne pas mettre les noms des patients ? Toutes les personnes qui apparaissent dans le film sont au générique, mais ce n’est pas pareil. Pour vous répondre, trois d’entre eux sont des psychiatres. Un quatrième, en formation quand je tournais, l’est devenu depuis. La jeune soignante, alors interne en médecine, était en stage dans le pôle. Enfin, la femme qui est en binôme avec un premier psychiatre puis avec une autre est assistante sociale.
Habituellement, un ou une infirmière participe aux entretiens aux côtés des médecins, mais nous avons dû y renoncer tant il était compliqué de mobiliser en même temps les uns et les autres. Par ailleurs d’autres professionnels comme les psychologues en font de leur côté mais je ne pouvais pas multiplier les protagonistes, qui sont déjà nombreux. Tout le monde sait qu’un film n’est pas exhaustif.
Vous filmez aussi des réunions…
Oui je tenais beaucoup à filmer ces réunions » soignants-soignés » du mardi qui permettent d’aborder librement tous les sujets sans ordre du jour préalable. Leur côté un peu anarchique viendrait rompre et bousculer le rituel des entretiens et le montage lui-même. Ces séquences témoignent du quotidien de l’hôpital, du climat qui peut y régner, du désir qu’a l’équipe soignante de partager avec les malades des temps de réflexion, mais ce ne sont que des instantanés. D’une semaine sur l’autre, ces réunions sont très différentes. L’espace de la serre, avec ses plantes, ses fauteuils, ses rayonnages, est le poumon des deux unités.
Dans le film vous n’êtes pas exactement à la même place que sur l’Adamant. Vous y êtes plus en retrait.
Oui, c’est vrai. Dans Sur l’Adamant les patients s’adressent beaucoup à moi, alors qu’ici, à l’exception d’un entretien, ils s’adressent aux soignants. Pour autant je n’en suis pas absent. Les nombreux regards caméra témoignent de ma présence, voire même, ici ou là, d’une certaine connivence.
Je reviens à cette idée de la parole et de l’écoute. Dans vos films, quels que soient les univers qu’ils abordent, c’est une dimension très présente, que vous déclinez de multiples façons.
Mon propre rapport au langage n’est pas simple. Ma parole n’a jamais été très fluide. Il m’arrive de commencer à parler et soudain les mots ne sortent pas. Je ne sais pas si cela a un lien mais j’ai toujours aimé filmer la parole, qui est peut-être à mes yeux ce que nous avons de plus précieux. Or j’ai le sentiment que celle-ci est de plus en plus dévaluée. Cela ne vaut pas seulement pour la psychiatrie. Dans le champ du cinéma documentaire la parole filmée n’est pas très » tendance «. Drôle de monde que celui dans lequel nous vivons, où nous sommes tous » connectés «, où l’on n’a jamais autant communiqué… et aussi peu parlé ensemble.
Filmer la parole c’est filmer des visages, des regards, des mimiques, des gestes, des silences, des rires, des hésitations, des raccourcis, des associations, des extrapolations, des manières d’occuper l’espace et d’en ouvrir de nouveaux. C’est ramener au premier plan tout ce qui colore et aiguise les idées. C’est filmer cette part de fiction propre à tout récit, puisque parler ce n’est pas seulement rendre compte du réel, c’est toujours aussi le remodeler, le réinventer. Raconter, c’est ce qui permet de faire exister le non advenu. La parole est le territoire de la fiction.
Après La moindre des choses et Sur l’Adamant, ce film est le troisième que vous tournez en psychiatrie, et il y en aura bientôt un quatrième . Qu’est-ce qui vous incite à y revenir ?
La psychiatrie est une loupe, un miroir grossissant qui en dit beaucoup à la fois sur l’âme humaine et sur l’état d’une société. On y rencontre toutes sortes de gens au parcours cabossé, des fragiles, des sensibles qui avancent dans la vie comme des funambules. En parlant avec eux, il arrive qu’ils nous disent nos quatre vérités, nous poussent dans nos retranchements, nous entraînent dans des contrées où nous n’avions jamais pensé aller. J’ai mis du temps à me l’avouer, mais si ces personnes me touchent autant, c’est parce qu’elles me renvoient à moi-même, à mes propres vulnérabilités.
Le Monde - 20 mars 2024
À NE PAS MANQUER
Après « Sur L’Adamant », le documentariste s’installe dans les unités psychiatriques de l’hôpital Esquirol à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, désigné autrefois comme l’« asile de Charenton ».
Un an après avoir filmé l’espace original de L’Adamant (Sur l’adamant, 2023), une péniche abritant un hôpital de jour sur les flots de la Seine, à Paris, et obtenu pour cela l’Ours d’or de la Berlinale 2023, Nicolas Philibert persiste, ouvrant les voiles d’un triptyque documentaire consacré à la psychiatrie. Averroès & Rosa Parks en est le deuxième volet, avant La Machine à écrire et autres sources de tracas, dont la sortie est prévue pour le 17 avril, qui s’installe dans les unités de même nom à l’hôpital Esquirol, à Saint-Maurice (Val-de-Marne), désigné autrefois comme l’« asile de Charenton ».
Le film s’ouvre sur des vues au drone du site à l’architecture quadrillée, montrées à des pensionnaires qui, peinant à s’y repérer, en soulignent d’emblée l’ampleur imposante comme la parenté carcérale. On retrouvera ici, à l’occasion, certains patients déjà croisés sur L’Adamant, dans le volet précédent – dont François, qui y chantait La Bombe humaine, de Téléphone –, ces unités composant un même réseau, celui du pôle psychiatrique Paris-Centre, où chacun est amené à circuler d’une « maison » à l’autre.
Là où Sur L’Adamant brossait le portrait d’un lieu et de ceux qui s’y croisent, Averroès & Rosa Parks s’axe plus volontiers sur la parole. Bien qu’il comprenne quelques scènes d’ateliers ou des groupes de discussion, c’est néanmoins le tête-à-tête de l’entretien psychiatrique qui forme le corps principal du film. Nicolas Philibert investit cet espace privilégié de la relation soignant-soigné, à la faveur de blocs extensifs qui plongent directement dans le cours des discussions, sans autre forme de contexte.
Champ-contrechamp
Devant la caméra se succèdent différents patients, avec le temps qu’il faut, variable, pour que la souffrance soit énoncée, effleurée ou simplement située. Ici, un homme appréhende sa sortie de l’hôpital en s’inquiétant de la possibilité, à l’extérieur, d’accorder pratique religieuse et respect de la laïcité. Un second identifie ses aïeux morts à l’endroit d’autres pensionnaires bien réels. Une adolescente au crâne rasé se remet d’une tentative de suicide médicamenteuse. L’un entend expurger son sentiment de culpabilité en accédant au statut de citoyen imposable. Ce sont des personnes que le film révèle, et avec elles des parcours de vie, des pans d’expérience.
L’art de Philibert est celui du documentaire « ligne claire », où l’approche patiente se fond dans une syntaxe limpide qui semble couler de source. Ainsi, Averroès & Rosa Parks explore-t-il une figure élémentaire du cinéma, à savoir le champ-contrechamp, qui, confrontant les interlocuteurs, distribuant parole et silences, recouvre un enjeu fort de communication. Car, entre le praticien et le patient, les choses sont loin d’être évidentes : comment s’assurer que l’on parle bien des mêmes choses, reconnaître une détresse ou un besoin ?
C’est précisément par le montage que le film investit la dynamique de cette relation, mouvante, instable, semée de hiatus, ô combien susceptible de nourrir des malentendus. S’il revient au patient de se raconter, c’est au fil de l’expression que le symptôme finit par affleurer. Tel cet agrégé de philo histrionique, liant son parcours à une prolifération de références (Nietzsche, Deleuze, Krishna, Steve Jobs), qui, visiblement, l’écrasent. En face, médecins ou psychologues constituent un pôle d’écoute : il s’agit de recevoir, mais aussi de relancer par des incises stratégiques, qui désamorcent les montées d’angoisse ou de délire. Même silencieux, leurs visages concentrés, regards vissés sur le malade, participent de l’interlocution, et donc du soin.
Focalisation strictement humaine
Ce qui se joue dans Averroès & Rosa Parks tient tout du long du rapport contrarié à la norme. Philibert enregistre dans les préoccupations des pensionnaires ce qui demeure poreux au quotidien ou peut encore se reconnecter avec lui. Si bien que ce sont des morceaux de nos vies, et même de nos références − on y cite Platon, Aristote, Tagore et bien d’autres − que l’on reconnaît dans les récits de ceux-ci, dont seuls les cheminements divergent. Ainsi, qu’apprend-on de François, patient crispé à la parole précipitée ? Qu’il avait vocation à devenir footballeur professionnel, mais que ses parents communistes l’en ont toujours empêché. Histoire de tous les jours, déchirure intérieure.
La focalisation strictement humaine fera peut-être dire de Philibert qu’il en oublie les structures psychiatriques, comme leur état de déréliction, bien qu’il en perce quelque chose au détour dans certaines plaintes des patients envers le personnel (manque d’empathie, traitements rationalisés). Mais l’objet du film est à la fois plus localisé et plus vaste : le langage dans ce que ses affections (énonciation pâteuse ou heurtée, choix du silence) produisent ou révèlent.
Par ses moyens les plus simples, le documentaire façon Philibert atteint ici une force d’évocation exceptionnelle, à même de catalyser des situations, des « répliques » ou des caractères qu’aucune fiction n’aurait pu inventer. Retenons-en une : l’angoisse dévorante de cette vieille femme atteinte, depuis la mort de sa sœur, d’un délire de persécution aigu. Ses mots d’effroi ouvrent sur un monde de ténèbres dont personne, pas même le psychiatre, ne semble pouvoir la tirer. Cette voix hantée aux accents oraculaires, comme venue du fond des âges, est de celles qui résonnent longtemps après la projection.
Libération - 19 mars 2024
Pour le deuxième volet de son triptyque documentaire – après «Sur l’Adamant» –, Nicolas Philibert porte cette fois son regard attentif et humain sur deux unités psychiatriques de l’hôpital Esquirol
L’endroit est si grand qu’il faut d’abord l’envisager au drone : une impressionnante suite de cours à portiques néoclassiques, bordant le bois de Vincennes, qui se déploie à l’écran dans toute sa splendeur carcérale. En 2023, le premier volet du triptyque documentaire consacré par Nicolas Philibert à une certaine forme de psychiatrie contemporaine plutôt enthousiasmante, Sr l’Adamant, récompensé par un ours d’or à Berlin, prenait ses quartiers sur le joli bateau du même nom, centre de jour dont l’enviable situation (sur la Seine en plein Paris) et la vocation (accueillir toutes sortes d’ateliers créatifs) offraient aux patients comme aux spectateurs des lignes de fuite et échappées, réelles ou symboliques – un appel d’air.
Ni voyeurisme ni surplomb
Le deuxième chapitre, le fascinant Averroès et Rosa Parks, consacré à des unités de soin relevant elles aussi du pôle psychiatrique de Paris-Centre, où l’on retrouve certains des personnages vus sur l’Adamant, est au contraire clos sur lui-même : l’on rentre dans le dur de la clinique, et l’on n’en sort pas. Pendant plus de deux heures, se succèdent de longs face-à-face soignants-soignés, et de plus rares groupes de parole, chargés d’interroger les parcours de chacun, les motifs qui l’ont conduit, pendant des décennies parfois, à revenir dans le système psychiatrique, et interroger aussi, plus généralement, les modalités du soin. Car la psychiatrie, ce sont souvent les patients qui en parlent le mieux. «Dehors, c’est irrespirable, alors si à l’hôpital on ne peut pas respirer…»
Pas de voyeurisme, pas de surplomb, simplement un regard et une écoute attentive, le geste du cinéaste accompagnant ainsi celui du personnel hospitalier. Il nous rapproche des patients davantage qu’il nous en éloigne, les failles dévoilées semblant souvent des versions XXL d’aspérités dont chacun mesurera s’il peut les faire siennes. N’est pas donnée à voir, en revanche, la réalité d’un système psychiatrique exsangue (même si une patiente y fait allusion), c’est au contraire le temps long de la négociation, des microscopiques avancées, qui se trouve valorisé. Comment en sortir, s’en sortir ? Comment ne pas y revenir ? Tout le paradoxe du lieu est articulé par un médecin : il s’agit de voir comment l’hôpital, cet ensemble hors du monde, permettrait «de se réinscrire dans la réalité de la vie».
Fondations chancelantes
Pas que le monde extérieur se fasse oublier, qui fait irruption de manière fragmentée et multiforme : le désir d’être «un citoyen» et de payer ses impôts, le soin qui aiderait à «faire comme les autres», le quotidien vu comme un parcours d’embûches insurmontables… Et des fragments de parler administratif, de structures politiques surgissant comme un surmoi («le Conseil d’Etat est-il au courant ?»), de modes contemporaines, de noms de philosophes chargés de faire mouche sur l’interlocuteur, fragiles béquilles sur lesquelles appuyer des fondations chancelantes.
Souvent, la caméra s’arrête sur des fenêtres, dont la valeur métaphorique ne laisse jamais oublier ce qui sépare ces patients de nous, spectateurs, de l’autre côté de l’écran et de la vitre. Séparation effective certes, mais aussi mince et fragile qu’une plaque en verre, et dont le beau, le très humain travail du film, est de nous la rendre bel et bien invisible.
The Guardian - 17 July 2025
Laurence is a woman in desperate need of an act of human kindness. The grey-haired patient urges her psychiatrist for a hug, a cuddle – that, she says, is all she needs to keep at bay the nightmarish visions that haunt her. Yet on her ward at the Esquirol hospital centre in Paris, such simple gestures are impossible to come by. “When I asked for a hug,” Laurence laments, “they gave me a jar of yoghurt.”
This scene, from Nicolas Philibert’s new documentary At Averroès & Rosa Parks (two sections of the Esquirol hospital centre), is as hard to watch as anything you are likely to see on a cinema screen this year. But it is especially remarkable coming from perhaps the world’s pre-eminent maker ok humanist documentaries. The Frenchman Philibert is one of modern cinema’s great champions of kindness. Aged 74, he has built a career making award-winning observational portraits of places that excel at giving care within a hostile modern world: a southern French school for hearing-impaired people in 1992’s In the Land of the Deaf; museums and the people who dedicate their lives to maintaining the objects inside them in Louvre City (1990) and Animals and More Animals (1995); a single-teacher infant school in the rural Auvergne region in Être et Avoir, his 2001 international breakthrough film.
On the adamant, his 2023 Golden Bear-winning doc about an occupational therapy centre moored on the river Seine, was Philibertism par excellence : a film about a place that heals because it lives up to the simple ideal of treating patients as people. Yet its follow-up – which explores where some of the Adamant’s passengers go on their bad days – is a film about a place where healing never seems to take place.
“[For] On the Adamant, I filmed a lot of workshops and group meetings,” Philibert says on a video call from Paris. “In At Averroes & Rosa Parks, the atmosphere and architecture is more severe, the space is more constraining. When the patients are in the hospital, they are more vulnerable, they are more in pain, they are overwhelmed by anxieties. Life is a hell. Everyone is locked in their solitude.”
The film about the floating daycare centre became a crowdpleaser because it managed to portray a potentially forlorn place as something more akin to an elite institution for outsider artists (its name, riffing on that of the English post-punk singer who has been open about his bipolar disorder, is no coincidence). But during the filming Philibert realised: “If I didn’t show that the patients circulate between the boat and less prestigious structures, I wouldn’t be showing reality.” The result is what he calls a “triptych” of three films shot over a 12-month period between April 2021 and 2022, screening for the first time in their entirety in the UK at London’s Bertha DocHouse cinema next weekend.
The third of the three films, The Typewriter and Other Headaches (Philibert says they can be watched in any order), is still infused with its director’s typical humanism: following the Adamant’s carers as they visit their patients at home to repair broken typewriters, printers and record players, it shows how broken machines and severed links to the outside world can be fixed.
And if we do not see any repair work in At Averroès & Rosa Parks, it’s not for the carers’ lack of trying. Made up entirely of conversations between mental health patients and their psychiatrists, it shows the hospital’s staff display extraordinary empathy in their handling of people with severe conditions. We hear them engage respectfully with Olivier, who is confused about family relations and tells his carers that other people’s daughters are his, and that his grandfather is present at the hospital in the shape of other patients. We see them listen patiently to Noé, who speaks multiple languages, makes art, practises Buddhism, teaches philosophy, but also suffers from “megalomania”, a condition he believes was brought on by swallowing a handful of acid at a trance festival as a teenager.
But there is always a lurking sense that these conversations are under strain. One patient, Pascal, tells his carer that great psychiatrists are like Kylian Mbappé, the French footballer known for his clinical finishing: “They get to the point, they sense things.” But when he lists the names of psychiatrists he considers top of his league, he pointedly omits to mention the woman he is talking to, and then phases out of the conversation completely. Laurence’s psychiatrist goes to extreme lengths to assuage her fear that the carers are out to harm her and steal her cigarettes, but she snaps back: “I don’t trust you, I stopped trusting you ages ago. You’re dumb, you’re dumb as shit.” He doesn’t retaliate – there’s a camera rolling, after all – but can’t quite stop the hurt pride from showing on his face.
“I really wanted for this second film to be based almost entirely on speech and listening, because these are two things that almost becoming extinct in the psychiatric world,” says Philibert. “Public hospitals in France and elsewhere are becoming abandoned by public power. It translates as a deep lack of means, a deep lack of attractiveness. A lot of nurses who work in psychiatry end up leaving because they can carry out their work with dignity less and less.”
At the end of the film, we meet Laurence again. Her flowing locks have been trimmed short, and she has bloodied plasters on her fingers and festering burns on her face. In a moment of desperation, we learn, she set herself on fire. I wonder if that last scene comes close to violating one of the principles Philibert’s previous films adhered to: for all his interest in people with mental troubles, he usually goes to some lengths to avoid showing them in their troubled state. Yet his depiction of Laurence could be seen to be using her pain for dramatic effect.
Philibert is quick to reassert his ethical guidelines. “My films rest on trust,” he says, adding: “Even if a patient or a carer signs a written authorisation, it doesn’t mean that you’re immune or that legal pursuit isn’t possible if you tarnish the image of a person.” He’s speaking from experience: after Être et Avoir became a breakout hit, the teacher at the heart of the film (unsuccessfully) tried to sue Philibert for a share of the profits, claiming that the film’s success rested entirely on his personality.
In Laurence’s case, Philibert insists that she gave her consent before and after the filming, because she perceived his request “a proof of consideration”. “‘You want to film me? Oh, you’re interested in me. Me who is always sidelined, rejected, made invisible.’”
Still, it’s fascinating to watch a film-maker discover new emotional timbres in his 70s. When the screen cuts to black at the end, and a jazz-guitar version of Beethoven’s Ode to Joy plays over the credits, it feels like we are encountering a very unlikely emotion for a Philibert film: bitterness. And perhaps he is also allowing his beliefs to shine through more than previously. In the film’s opening scene, when staff and patients watch drone footage of the hospital, Noé comments: “It’s scary, it’s like a prison.” Philibert is fond of quoting his fellow documentarian Frederick Wiseman’s maxim: “If you need to drive home a message, send an email but don’t make a film,” but what is this if not a pointed message about the state of modern French psychiatry?
“You know, the world of psychiatry is the realm of the unexpected,” he says. “When you enter, all your certainties are shattered. The madmen reset all your counters to zero. They push you to revise all your diagrams.”
-
On the Adamant, The Typewriter and Other Headaches and At Averroes & Rosa Parks are showing at Bertha DocHouse 26-27 July (2025)
